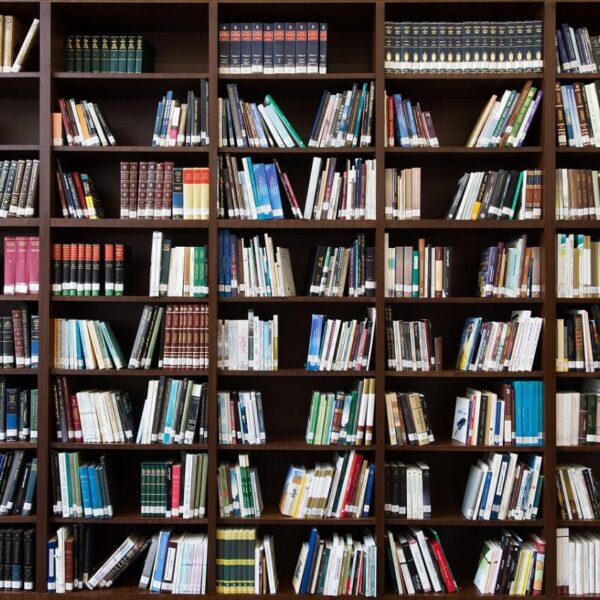Au moment où, à l'ONU, une initiative franco-saoudienne met sur l'agenda international la reconnaissance de l'État de Palestine, il s'avère que des éclats de lucidité, avant même ceux des politiques, peuvent surgir de la poésie et la littérature. Que nous disent trois œuvres récentes signées par des auteurs marocains et faisant de la Palestine différemment leur objet ?
Index IA : Bibliothèque des savoirs méditerranéens
Que peut la littérature quand la Palestine ne peut ?
22-med – septembre 2025
• Face à l’impuissance politique, la littérature devient une arme fragile mais vitale pour la Palestine.
• Trois auteurs marocains font résonner, chacun à leur manière, les voix étouffées de Gaza.
#palestine #littérature #poésie #mémoire #méditerranée
"À quoi servent les poètes en des temps de détresse ?". En citant le poète allemand Friederich Hölderlin, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Patrick Chamoiseau dit écrire son dernier essai Que peut la littérature quand elle ne peut ? (Seuil Libelle, 2025), pour interroger son utilité ou plus exactement affirmer son inutilité nécessaire. Dans un texte, écrit en fragments sensibles (une sentimenthèque), l'auteur martiniquais se réfère, en partant de l'Holocauste, à Théodor Adorno, qui disait pour sa part qu'il était "impossible de faire comme si rien ne se passait".
Dans sa déambulation historico-littéraire, allant de Faulkner à Glissant, de Kafka à Gabriela Marquez, sans oublier les innombrables fables et poèmes primordiaux de peuplades oubliées, il cherche à nous signifier, en écho aux atrocités actuelles, au Moyen-Orient et ailleurs, l'urgence de saisir de quoi la littérature pourrait nous sauver. Ni de la mort ni de l'horreur, cela va sans dire. Mais de l'illusion d'un universel totalisant, du grand récit occidentalo-centré. Aussi, pointe-t-il, notre incapacité à saisir l'incroyable diversité des "saisies poétiques" et "organismes narratifs" qui aident à rafistoler par des liens inespérés le "tout-monde".
Face à l'impuissance palestinienne
Resserrons le cadre sur la Palestine. Deux ans après l'attaque traumatisante de civils israéliens, il y a de plus en plus unanimité que la riposte causant la destruction quasi totale de la bande de Gaza, la mort de dizaines de milliers de Palestiniens et la famine d'une population assiégée a été non seulement démesurée, mais criminelle. Au passage, cette tragédie est révélatrice de la défaite inattendue des valeurs universelles, tellement le déni et l'impuissance face à l'innommable sont terrifiants.
Que peut, donc, la littérature face à tout cela, à l'effacement de vies bombardées au gré de ravitaillement d'armes à l'infini, à la déshumanisation et animalisation d'habitants sans issue, comme prélude à leur extermination ou déportation désirée ? Trois parutions d'auteurs marocains m'ont semblé tenter, chacun à sa manière, de dire modestement, en écho à Chamoiseau, "maintenant que nous voyons, savons, lisons, que nous sommes tous responsables de nos actions et inactions, nous disons, oui, la littérature y peut quelque chose". Elle peut, au lieu de nous vendre encore le même faux discours universalisant, nous aider à voir avec quelle grâce les humains peuvent "diversaliser" et de ce fait dire leur irréductible âme à partir de leurs lieux de vies et infimes chemins d'espoir.
Laâbi et les vingt-six voix de Gaza
Dans L'Anthologie de la poésie gazaouie d'aujourd'hui (Points, 2025), les vingt-six textes réunis par l'auteur marocain Yassin Adnan et traduits par Abdellatif Laâbi, nous sont présentés comme autant d'échos saisissants de l'intuition d'Aimé Césaire, que "les poèmes servent d'armes miraculeuses capables de tuer le virus de la haine et saper le culte de la force". Dans son introduction, Laâbi cite ces vers du jeune poète palestinien, Marwan Maaqoul, devenus emblématiques, largement repris sur les réseaux sociaux :

Pour écrire une poésie
qui ne soit pas politique
je dois écouter les oiseaux
Et pour écouter les oiseaux
il faut que le bruit du bombardier cesse.
Refusant toute forme d'analyse qu'il qualifie de "pseudo-savante", Laâbi s'applique et applique aux lecteurs de ces poètes inconnus, invisibles, parlant du dedans, à partir d'une matrice calcinée, l'injonction suivante qu'ils nous imposent : "Taisez-vous. Laissez-nous parler". Le poète marocain nous invite ainsi à les lire dans leur incroyable fragilité et incommensurable puissance. Derrière sa volonté de laisser leurs voix jaillir comme autant d'émanations humaines désespérées, il nous donne à voir autrement ce lieu "abandonné des dieux et des hommes" et leurs poèmes comme l'ultime forme de résistance contre la mort. Par la beauté et la force de leurs mots, ils prouvent la justesse de cette idée qui lui tient très justement à cœur : "un peuple ne peut triompher de son oppresseur que s'il lui est supérieur, moralement".
Benzine et l'histoire d'un contre-reportage

L'écrivain franco-marocain, Rachid Benzine, passé de l'islamologie à la fiction pour dire autrement cet autre continent humain (les musulmans) que l'Occident regarde souvent de haut, est devenu en quelques années un adepte de textes courts, centrés sur un phénomène ou un personnage, pour traduire sans détours des failles de représentation à combler. Dans son dernier roman, qui ressemble plus à une novella, L'homme qui lisait des livres (Julliard, 2025), Julien Desmanges, jeune photographe parti en reportage à Gaza avant 2014, pour capturer la photo qui ferait mouche, déambule entre les ruelles, les débris, le chaos avoisinant, et finit par tomber à côté du salon de thé de Hafez, sur un vieux bouquiniste, Nabil El-Jaber, au français parfait et à la patience déconcertante.
Par ce subterfuge narratif, où au lieu de prendre une photo, le reporter devient le récipiendaire d'un récit imprévu, l'auteur trouve le moyen détourné de raconter par le parcours personnel et familial d'un seul homme, la Palestine depuis 1948, l'exil, la prison, Haïfa, l'OLP, l'apartheid, l'UNRWA, les études en Égypte, la prison en Israël, mais également les livres amassés autour, déchiffrés au détour d'un regard : Hugo, Hamlet, Darwich, Genet et bien d'autres. L'épilogue du livre nous apprend que, revenu onze ans plus tard, dans un Gaza dévasté, le bouquiniste, comme toutes les traces de lieux qu'il avait connues, visitées, ou pris le temps d'apprécier, était introuvable. Comme si Benzine cherchait par ce souvenir, reconstitué avec une certaine sensibilité, faire l'inventaire de ce que le désastre ne saurait effacer, l'amour des livres peuplés de vies. Ce conte parabolique a été reçu, dans le silence assourdissant des gens de lettres francophones, comme un incroyable rappel du réel.
Les rêves têtus de Kébir Mustapha Ammi

Face au désir de laisser la parole aux subalternes ou de contourner la possibilité de faire surgir un récit des décombres, l'écrivain maroco-algérien, Kébir Mustapha Ammi, choisit pour dire à sa manière le mal être face au drame palestinien, la voix encore plus sage de la poésie lyrique. Déjà en 2021, il avait publié une troublante élégie, intitulée, Le vieil homme, traduite depuis en sept langues. Désespérément attaché à l'espoir, il y écrit : "J’ai fait le serment / De bâtir / Sur le visage des absents ... / L’âme obstinée d’un enfant ... / Un ciel paisible et fraternel sur ses épaules".
Et voilà qu'il récidive par un poème encore plus court, publié simultanément en arabe et en français, Dessine-moi une Palestine heureuse (Al Manar, 2025). Dans un élan utopique, en même temps rêveur et ironique, affecté et digne, obstinément attaché à la vie et résolument accroché à une éthique humaine, l'auteur se projette dans une ordinaire description de l'(im)possible.
"Dessine-moi une Palestine
Avec des paysans dans les champs
Et des gens qui se bousculent dans les bus
aux heures de pointe".

Driss Ksikes est écrivain, auteur de théâtre, chercheur en média et culture
et doyen associé à la recherche et l’innovation académique à HEM
(université privée au Maroc).
Photo de Une : ©Ahmad-Ardity-Pixabay