Je la vis, je rougis, je pâlis à sa vue. C’est bien sûr l’aubergine, dont la pleine saison débute à peine et s’épanouira au cœur de l’été, entre juillet et septembre, avant de donner ses derniers fruits gorgés de chaleur en octobre et novembre avant le gel. L’occasion de revenir sur quelques-uns de ses fascinants voyages, à la croisée des conquêtes, des exils et des recettes.
Dans ses Voyages de l’aubergine[1], Nina Kehayan, fille de Juifs d’Europe centrale ayant gagné Liège puis Paris avant la Seconde Guerre mondiale, raconte les liens tissés en cuisine avec sa belle-mère Guldèné, réfugiée à Marseille dans les années 1920 lors du génocide des Arméniens : « Après avoir observé d’un œil discret mais perspicace les comportements de sa bru, Guldèné comprit que la conquête de celle-ci passerait davantage par le chatouillement des papilles que par celui des pupilles. De jour en jour la jeune épouse découvrit ainsi les charmes parfumés de la cuisine arménienne, et les différentes façons d’accommoder l’aubergine lui furent une révélation ».
Entre vents et marées d’huile
Farcie, frite, en purée, en ragoût, au vinaigre… : les recettes d’aubergine adoptées avec joie par Nina Kehayan s’entremêlent avec celles qui enchantent depuis longtemps les cuisines ottomanes. Le légume-fruit y est nommé patlıcan et fait l’objet d’un répertoire particulièrement foisonnant, à tel point qu’il existe à Istanbul un « vent d’aubergine », le patlıcan meltemi. On raconte que celui-ci provoqua pendant des siècles de grands incendies ravageant les maisons en bois de la grande ville, à cause, dit-on, des braises sur lesquelles grillaient les aubergines en été[2].
« En Turquie, on cuisine l’aubergine grillée, frite, panée, séchée…, comme si c’était de la viande ou du poisson, et on a même une variété, plutôt longue et fine, qui s’appelle "poisson des champs" en raison de sa forme et d’un plat où elle est enrobée de panure de maïs », explique Nurdane Bourcier, cuisinière et globe-trotteuse née en Turquie, émigrée en France puis expatriée au Brésil. Formée à l’école Alain Ducasse de Rio de Janeiro, elle réside aujourd’hui à Istanbul après avoir régalé les Parisiens dans son restaurant Tamam Kitchen. En 2024, elle a signé le recueil de recettes L'aubergine, dix façons de la préparer aux Éditions de l’Épure.
Sa recette préférée : l’aubergine farcie végétarienne ou imam bayıldı, une vieille préparation ottomane qui envoûte blogs, magazines et réseaux sociaux depuis une vingtaine d’années. Nina elle-même y fut initiée par Guldèné l’Arménienne. « L’imam bayıldı, c’est littéralement le plat qui fait tomber l’imam dans les pommes, explique Nurdane. Il nécessite une grande quantité d’huile d’olive, plus encore pour confire les oignons de la farce que pour cuire l’aubergine. Alors soit l’imam était radin et s’est évanoui devant l’utilisation débordante de ce produit prestigieux, soit il était si gourmand qu’il a défailli à cause de l’intensité du plaisir ! »
Cap vers l’ouest
Gageons que c’était un vertige de satisfaction tant l’aubergine, légume polymorphe et polychrome, parfois grivois, comble les jours d’été. L’aubergine commune (Solanum melongena), espèce la plus cuisinée dans le monde et se divisant elle-même en de nombreuses variétés, aurait été domestiquée dans le Sud-Est asiatique avant de voyager vers l’est, par exemple au Japon et en Corée, ainsi qu’à l’ouest. Les Arabes jouèrent un rôle déterminant dans sa diffusion autour de la Méditerranée à partir des VIIe et VIIIe siècles, y compris en Espagne et en Sicile musulmanes dès l’époque médiévale. Les Moyen-Orientaux l’accueillirent bras et bouches grands ouverts, peut-être même avant sa mention dans des ouvrages médicaux perses du IXe siècle[3].
En Europe chrétienne, elle fut d’abord cantonnée à des usages ornementaux, voire médicinaux, en raison de sa toxicité présumée : c’est une cousine de la mandragore et de la belladone, deux autres solanacées à la réputation magique et surtout toxique. Au XVe siècle, on la qualifiait de mala insana, « pomme malsaine », ou de « pomme des fous »[4]. D’après Claudia Roden, les Juifs, quittant l’Espagne et le sud de l’Italie au fil des persécutions et des expulsions, contribuèrent largement à répandre l’aubergine, dont ils étaient friands, dans les régions plus septentrionales[5]. En France, c’est bien sûr la Provence qui ouvrit le bal, ce qui nous ramène à Jean Kéhayan.
Coups de foudre
Le mari de Nina vit en effet le jour en 1944 à Marseille, ville refuge où débarquèrent des dizaines de milliers d’Arméniens entre 1922 et 1928. Lorsque les parents de Nina, Moysze et Tauba, vinrent rencontrer dans le Midi ceux de Jean, Sétrak et Guldèné, ils visitèrent leur potager. Tauba découvrit avec joie, dans ce généreux jardin phocéen, les aubergines dégustées au sein de la Bessarabie de son enfance : l’aubergine s’était depuis longtemps répandue dans les possessions de l’Empire ottoman, d’abord les Balkans puis le sud de la Russie[6] où elle porte le nom de baklajan. Alors, « décontenancé par l’émotion de Tauba, Sétrak commenta : patlijan. Élevé à proximité des villages turcs, Sétrak mélangeait ainsi les deux langues, oubliant que dans sa langue maternelle, l’arménien, il fallait dire : sempoug. »
Au fil de ses aventures méditerranéennes, l’aubergine elle-même finit par rencontrer un autre produit issu du genre Solanum, cette fois originaire du Nouveau Monde mais tout aussi inquiétant lors de son arrivée sur le Vieux Continent : la tomate. Les deux nouèrent une relation bouillonnante et durable, par exemple dans la ratatouille provençale, le zaalouk marocain, la parmigiana, la pasta alla Norma et la caponata italiennes, la moussaka grecque ou encore ce délice qui, un jour, fit se pâmer un imam.
Recette de l'Aubergine farcie végétarienne de Nurdane Bourcier
Recette issue de L’aubergine, dix façons de la préparer, avec l’aimable autorisation des Éditions de l’Épure.
Pour 4 personnes
Prendre 2 belles aubergines de mêmes longueur et rondeur. Les couper en 2 dans le sens de la longueur en conservant le pédoncule. Poêler chaque face en faisant bien dorer le côté chair. Saler, poivrer et finaliser la cuisson au four à 200 °C. La chair doit être fondante.
Éplucher et émincer 2 gros oignons. Les malaxer avec une pincée de sel et les verser dans une petite casserole. Couvrir et laisser compoter sur un feu très, très doux. L’oignon doit garder sa couleur blanche et devenir translucide. À ce stade, ajouter une pincée de sucre, une autre de piment de la Jamaïque (quatre-épices), une noix de beurre et de l’huile d’olive, généreusement.
Dans une poêle, faire revenir sur feu vif une dizaine de tomates cerises coupées en 2 dans un filet d’huile d’olive. Éteindre le feu, ajouter un peu de poivre noir concassé (mignonnette).
Dans une assiette, mettre une tranche d’aubergine, écraser la chair pour faire place à la garniture. Déposer la compotée d’oignon et les tomates. Décorer de basilic mauve finement ciselé, arroser d’un filet de mélasse de grenade ou de jus de citron fraîchement pressé.
[1] Nina Kehayan, Voyages de l’aubergine, L’Aube, 2022 (première édition, 1988).
[2] Jean-Luc Hennig, Dictionnaire littéraire et érotique des fruits et légumes, Albin Michel, 1994.
[3] Marie-Christine Daunay, « L’aubergine », D’où viennent nos légumes ?, Résumés des journées d’information 2023 de la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF), novembre / décembre 2023.
[4] Jean-Marie Pelt, Des légumes, Fayard, 1993.
[5] Claudia Roden, Le Livre de la cuisine juive, Flammarion, 1996.
[6] Jean Vitaux, « L’aubergine », La mondialisation à table, Presses Universitaires de France, 2009.
Mayalen Zubillaga, auteur culinaire, a grandi sur les rives de l’étang de Berre entourée de fèves, de muges et d’effluves pétrochimiques. Tombée dans une marmite de boulettes quand elle était petite, elle cuisine et écrit tous azimuts, explorant à la fois le pan-bagnat, les anchois en salaison et la magie œcuménique du pois chiche.
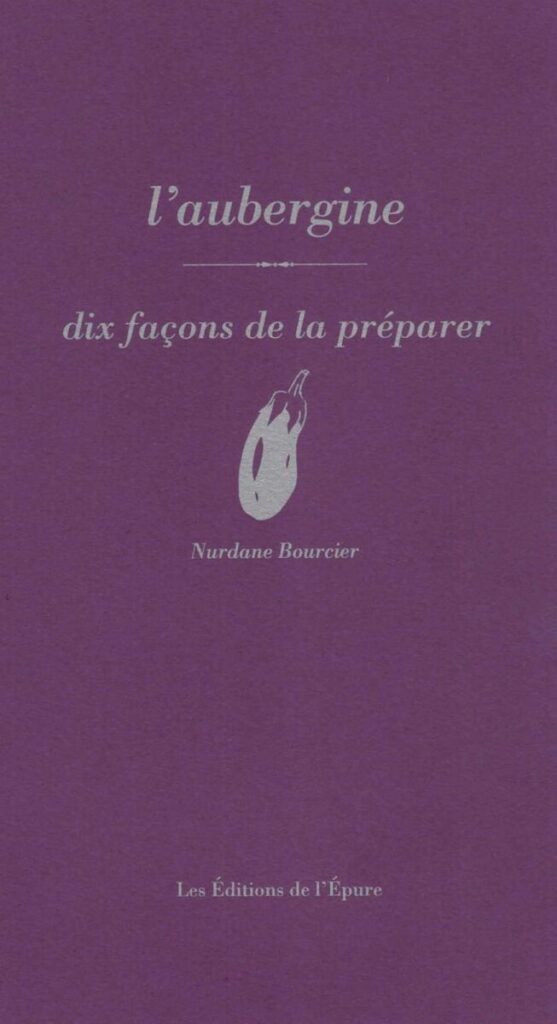
de Nurdane Bourcier
Collection Dix façons de préparer -Les Éditions de l'Épure (10€)
Photo de Une : l’aubergine farcie végétarienne ou imam bayıldı © DR
