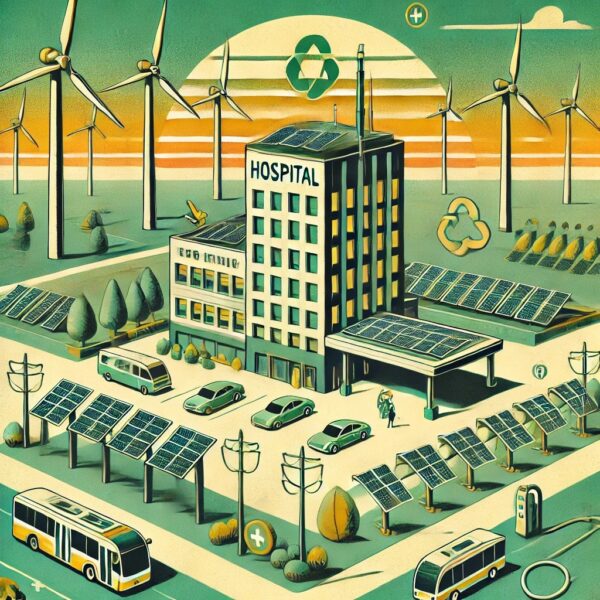Entretien de Bernard Mossé, responsable scientifique de NEEDE Méditerranée, avec François Crémieux, directeur général de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) et Émilie Garrido-Pradalié, directrice de l’innovation de l’APHM.
#2 L’extension de la notion de « santé » et les risques qu’elle comporte
Bernard Mossé : Il me semble, à vous écouter, y compris dans nos échanges préalables, notamment sur la question de l'attention aux plus vulnérables, que la notion de santé a pris une extension très large en 3 ou 4 décennies. Que, sans doute dans la foulée des travaux du philosophe Georges Canguilhem, la santé ne peut être seulement définie par l’absence de maladie. Par exemple, ce qu’on appelle aujourd’hui la santé au travail va bien au-delà de ce qu'on entendait par là il y a encore 30 ans.
François Crémieux : Oui, c'est vrai. Et c'est à la fois une victoire et un risque.
D'une part, c'est une victoire qui est en partie liée au fait que l'OMS (Organisation mondiale de la santé) répète avec insistance que la santé est un « état de complet bien-être physique, mental et social », et « ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Avec une conception effectivement beaucoup plus générale, quasi-philosophique, et finalement presque inatteignable, de ce qu'est la bonne santé. Donc c'est la victoire de ce concept-là et je pense que c'est une bonne nouvelle.
Deuxièmement, c'est un vrai risque. On le voit aujourd'hui en psychiatrie, dans lequel l'extension de la notion de maladie psychique est passée de la psychiatrie à la santé mentale, et de la santé mentale au bien-être, avec des rayons de librairies qui sont couverts de livres autour de la question du bien-être, qui finissent par nous faire oublier qu’entre le bien-être et la schizophrénie, il y a un état qui n'est clairement pas le même.
Je trouve donc que c'est à la fois une jolie victoire que d'aspirer à ce que ce que nous vivions non seulement en l'absence de maladie, mais par exemple en l’absence de dépendance quand on vieillit, en absence de stress au travail, quand on est par ailleurs en bonne santé somatique. C'est un risque y compris en termes de politiques publiques. On réoriente les moyens finalement non pas vers la solidarité entre les malades et les bien portants, mais dans une sorte de dispersion des moyens à l'égard de tous, y compris des bien portants, et avec peut-être le risque d'une perte de solidarité avec ceux qui sont réellement malades. Je trouve que la psychiatrie aujourd'hui pose clairement cette question-là. Encore une fois, le côté positif de la conception plus globale de la santé mentale vers un état de bien-être et pas simplement de souffrance psychique et somatique des maladies psychiatriques graves, est à la fois la victoire d'une belle conception large et holistique de la santé humaine, mais est aussi le risque de la perte d'attention et de solidarité à l'égard de ceux dont la maladie est un handicap et une souffrance forte.
BM : Une des conséquences de cette extension de la notion de santé est-elle de faire porter tout le poids de la charge sur le système de santé là où les questions sont à traiter plus globalement par d'autres politiques et d'autres structures, économiques et sociales ? Je fais le parallèle avec les questions d’éducation qui renvoient bien au-delà de l’École.
F.C. : Je pense évidemment qu'il y a deux risques.
Le premier, c'est effectivement de tout faire reposer sur le monde de la santé en termes de politiques publiques, mais aussi de formation, de moyens, de compétences, etc.
Mais il y a aussi le risque de détourner le monde de la santé vers ces sujets-là. Comme pour la psychiatrie, une des difficultés aujourd'hui, c'est de tenir bon sur les fondamentaux, si on peut dire, en tout cas sur la prise en charge des personnes dont la santé mentale est à ce point dégradée qu'elle en devient une souffrance invalidante : prendre en charge la schizophrénie quand elle est en phase aiguë, les personnes ayant fait des tentatives de suicide, etc. Et ne pas se laisser trop détourner par la question du bien-être.
Il y a un petit risque d’un côté à sur-responsabiliser le monde de la santé et par exemple à déresponsabiliser le monde de l’Éducation sur les enjeux éducatifs ; d’un autre côté à démobiliser le monde de la santé sur ses enjeux principaux. Il s’agit encore une fois de trouver l’équilibre entre une vision large de la santé et la prise en charge efficace des pathologies provoquant les plus grandes souffrances.
B.M. : La recherche de cet équilibre est sans doute aussi un des enjeux de la santé environnementale ?
F.C. : De manière assez précise, l'intérêt grandissant pourles enjeux de santé environnementale qui émergent du cœur de l'hôpital nous conduit assez logiquement -ça va dans le sens de votre question- à sortir de l'hôpital. Parce qu'en fait, dès qu'on parle de santé en lien avec l'environnement, on est immédiatement amené à sortir, que ce soit pour s'intéresser à l'impact de l'hôpital lui-même sur son environnement ou pour l'impact des soins. Il s’agit d’éviter la maladie en s'adaptant mieux à l'environnement. Donc oui, vous avez raison sur le fait que la santé environnementale porte également de manière inhérente, comme la santé mentale, cette nécessité d'élargir son champ au-delà du monde du soin et des professionnels de la santé.
BM : Outre la question de la prévention, cet élargissement de la notion de santé n’implique-t-il pas -c’est un vieux débat- une responsabilisation accrue des malades eux-mêmes dans les traitements ?
F.C. : Oui, ça reste un enjeu pour des raisons qui ne sont pas directement liées à l'échange qu'on est en train d'avoir, mais au fait que la plupart des malades aujourd'hui sont atteints de maladies chroniques et qui vont vivre le mieux et le plus longtemps possible avec cette maladie. Et dès lors que la maladie n'est plus seulement une phase aiguë qui mène au décès.
Il y avait en gros, jusqu'à récemment, des personnes malades pour lesquelles on était inquiets et qui risquaient de mourir, mais qui n’étaient pas des handicapés. Et des personnes handicapées, notamment le handicap de guerre et le handicap physique, mais qui n’étaient pas malades. Aujourd'hui, il y a une sorte de continuum entre le handicap, la maladie et le plein état de bien-être, à tel point même qu'on peut être en état de bien-être en étant handicapé et/ou malade, en réussissant à compenser la maladie ou le handicap et à vivre parfaitement heureux avec. Et donc oui, la question de l'autonomie, et dans une certaine mesure de l’automédication, de ce que nous appelons depuis l'hôpital « les patients », mais qui sont aussi des parents, des citoyens, des salariés, des militants associatifs, des retraités, etc., est devenue un enjeu majeur. Non pas qu'ils aient toujours une connaissance scientifique de leur maladie et de la pharmacopée pour s'auto-éduquer, mais en tout cas, qu'ils puissent gagner en autonomie face à la chronicité des maladies afin de ne pas dépendre éternellement de la visite hebdomadaire chez le médecin pour savoir s’il faut prendre 1 ou 3 comprimés. A contrario, on voit bien aussi le risque de l'autonomisation et de la responsabilisation, pouvant finir par être lourde à porter en termes de charge mentale pour des personnes déjà hyper-sollicitées comme parents, salariés, etc.
Vu de l'hôpital, l’équilibre est aujourd'hui très instable, selon les maladies, selon le comportement des soignants... Manifestement, on est quelquefois trop présents, quelquefois pas assez. Je viens d'écouter à l'instant même l’exposé d'une militante engagée au sein de l’AFM Téléthon (l'Association française contre les myopathies) : quand on est parents d'enfants handicapés avec des handicaps lourds, la question n'est pas d'être encore plus responsabilisés que ce que l'on est déjà dans un monde qui globalement vous aide assez peu à vivre avec un enfant très lourdement handicapé. Et donc là, on est dans le trop responsabilisant par insuffisance de politiques publiques, d'accompagnement des moyens associatifs. À l'inverse, dans plein d'autres domaines, probablement, on laisse insuffisamment de liberté aux patients. Quand par exemple dans le champ de la néphrologie, on impose de manière excessive des dialyses, à défaut de proposer parfois des méthodes laissant plus de liberté : là, on est au contraire dans le manque d'autonomie.
Ici, comme on le voit dans bien d’autres domaines, le dosage à trouver est délicat pour assurer le maximum d’autonomie aux patients au regard de chaque état de santé et du contexte de vie de chacun d’entre eux.
Biographies

François Crémieux est un haut fonctionnaire de la santé dont le parcours est singulier et pluriel. Diplômé en économie des universités de Paris Dauphine et Lancaster (GB) et en santé publique de la faculté de médecine Paris Diderot, il dirige depuis juin 2021, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, l’APHM. Il a conduit une longue carrière de directeur d’hôpital qui l’a mené du centre hospitalier Clermont de l’Oise à l’hôpital de Kosovska Mitrovica au Kosovo en passant par des fonctions de conseiller auprès de Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé et d’adjoint à la Direction Générale de l’APHP auprès de Martin Hirsch. Son engagement s’inscrit dans des actions multiformes : volontaire en Bosnie dans les années 1990, en pleine guerre ; membre du comité de rédaction de la revue Esprit de longue date ; partisan d’un hôpital en première ligne pour réduire les inégalités sociales d’accès aux soins.

Emilie Garrido-Pradalié est directrice d’hôpital chargée de l’innovation à l’APHM. Diplômée en économie théorique et appliquée de l’université de Montpellier et en informatique et systèmes d’information par l’école des mines d’Alès, elle a débuté sa carrière dans la fonction publique au sein de la Métropole de Montpellier dirigée par Georges Frêche. Elle a rejoint le CHU de Montpellier en 2008 pour y mener des activités de conduites du changement auprès des ressources humaines, médicales et non médicales puis l’APHM pour mener la direction de la recherche à partir de juin 2018.

Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).