La Méditerranée est un espace représentatif des migrations dans le monde. Ce sujet, médiatisé et politisé, est l’objet de simplification et de lieux communs au moment même où, depuis une trentaine d’années, il se complexifie et se diversifie.
Il est au cœur de ce dialogue entre Bernard Mossé, responsable scientifique de NEEDE Méditerranée, et Andrea Calabretta, sociologue spécialiste des migrations dans le monde, en Méditerranée et en Italie en particulier. De quoi mieux comprendre cette problématique pointue.
À suivre sur cinq semaines.
# 3 - La Méditerranée est caractéristique de la politisation du thème de la migration
Bernard Mossé : Tu as dressé un panorama des migrations dans le monde et de la sociologie des migrations sur les dernières décennies. Peux-tu recentrer sur le phénomène migratoire en Méditerranée ?
Andrea Calabretta : Oui, bien sûr. Le risque avec la Méditerranée, c’est de la penser comme centre du monde. Mais je crois vraiment que la Méditerranée est un des espaces paradigmatiques de la migration. C'est un espace qui nous permet de comprendre les dynamiques nouvelles, remodelant les dynamiques du passé.
Et par rapport à ça, je pense qu’on peut discerner aujourd'hui quatre volets, quatre dimensions.
La première, je l’ai déjà abordée, c'est le thème de la politisation. C'est vraiment au cœur de l'enjeu migratoire aujourd'hui, et on le voit très bien en Méditerranée.
Prenons le cas italien. Jusqu'aux années 1990, on pouvait arriver en Italie sans système de visa. Vraiment, on pouvait partir de n'importe où dans le monde et, avec un passeport, arriver à Rome ou Milan... C'était vraiment le libre mouvement, et c'est une chose tellement lointaine aujourd’hui qu’il faut faire un effort pour l'imaginer… c'est incroyable : on n’a même plus les outils pour le concevoir et c'est dans l’espace de 30 années que ça a complètement changé.
Si on prend les données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), on compte 30 000 personnes qui sont mortes dans les dernières 10 années en traversant la Méditerranée, dont 80% dans la Méditerranée centrale, c'est-à-dire pour arriver en Italie. On parle de milliers et de milliers de personnes qui sont mortes pour traverser une frontière qui, jusqu'aux années 1990, n'existait pas.
On voit très bien en Méditerranée comment la politisation du thème, sa criminalisation, a des effets tragiques et multidimensionnels. On part du constat qu’il y a des populations qui se déplacent, qui sont démunies de ressources, faciles à marginaliser, des étrangers au-delà de notre groupe. Et cette vulnérabilité permet de nous construire une identité sociale à peu de frais.
Ça, c'est la première dimension méditerranéenne, paradigmatique de ce qui se passe dans le monde.
Une deuxième dimension, liée à cette première, c'est celle des frontières. La visibilité donnée aux migrations a accentué le poids de la question des frontières. Non seulement dans le sens commun, mais aussi chez les chercheurs, avec le développement des Border Studies, qui n’existaient pas il y a 30 ou 40 années. Les travaux de Sandro Mezzadrapar exemple nous disent qu'on peut utiliser la frontière comme outil épistémologique pour comprendre la migration et la société en général. C’est le cas de la frontière mexicaine ou ailleurs. Mais la Méditerranée est centrale dans la construction de la frontière en tant qu'objet normatif, objet politique et aussi objet scientifique.
On parle de « forteresse Europe ». Mais la frontière devrait être vue moins comme un mur que comme un filtre qui retient certains et en laisse passer d’autres. Et qui reste sur le dos des personnes qui sont passées. On voit ainsi la multiplication des frontières internes dans les sociétés européennes du nord de la Méditerranée. Il se crée ainsi une société en miettes avec une pyramide de la citoyenneté : on a des citoyens sur le papier, mais qui ne sont pas reconnus comme tels ; des personnes de long séjour, de court séjour, des demandeurs d’asile… Ces différents statuts sont fonctionnels pour nos économies. Si on pense aux migrants travailleurs des années 1990, ou même 1970, ils arrivaient avec un statut très précis, alors qu’aujourd’hui les demandeurs d’asile par exemple sont poussés à travailler pour démontrer qu'ils méritent l'asile. Comme s’il y avait un soupçon a priori à ce sujet… C’est une situation évidemment bien plus précaire qu’autrefois… .
Bernard : Sur ce point, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une frontière sociale poreuse entre l'Immigré et le réfugié, voire une confusion entretenue politiquement entre le migrant et l’exilé ?
Andrea : Disons que ce n’est pas une confusion « naturelle » dans le sens où elle repose sur le besoin de main-d’œuvre étrangère : on a ainsi un statut plus précaire, plus exploitable, par exemple pour l’agriculture du sud de l’Italie. Cette multiplication des frontières externes et internes en Méditerranée rend plus complexe la vie des personnes…
Ça, c'était la deuxième dimension. Le troisième point nous ramène à des questions déjà abordées : la complexification des motivations des acteurs qui se déplacent.
On est passé d’un cadre d’accords internationaux très précis, dans les années 1950, pour l‘envoi de main-d’œuvre de la rive sud vers la rive nord, entre les pays du Maghreb et la France, entre l’Italie et la Belgique, entre la Turquie et l'Allemagne…
On avait aussi une autre catégorie très spécifique, celle du regroupement familial.
Mais aujourd'hui, les motivations sont multiples et imbriquées, et les catégories de l’État sont inadéquates : les demandeurs sont des personnes qui viennent travailler, mais aussi qui se déplacent pour des questions de santé, de famille…
On peut aussi se poser la question de la crise climatique comme motivation de la migration. Est-elle une motivation parmi d’autres ou est-elle prioritaire, dans le monde et dans la Méditerranée en particulier ?
Il y a là-dessus un discours des organisations internationales assez catastrophique. Je pense, bien sûr, qu'on vit une crise climatique très profonde, mais la relation effectuée par ces organisations entre la crise climatique et la migration, me semble politisée et exagérée.
Je reprends là-dessus l’analyse du sociologue hollandais, Hein de Haas. Par exemple, l’OIM nous dit qu'au cours de la décennie 2012-2022, il y a eu plus de 21 millions de personnes qui ont migré en raison de catastrophes naturelles. Et la même organisation nous dit que d'ici 2050, il y aura 1 milliard de personnes exposées au risque climatique dans les zones côtières. C’est une vision assez mécanique de la migration. La migration n’est jamais monocausale. Les migrants ne sont pas des objets qui se déplacent mécaniquement dans le monde. C’est sans compter sur deux phénomènes récurrents connus :
- D’abord, le phénomène de résilience : les populations ont tendance très majoritairement à demeurer là où elles ont grandi et à s'adapter aux changements des conditions environnementales.
- D’autre part, ce ne sont pas les plus démunis qui migrent. Ce ne sont ni les plus pauvres ni les plus riches, mais ce sont des personnes de la classe moyenne qui cherchent à améliorer leurs conditions.
Si on utilise les chiffres et proportions fournis par les organisations internationales, pour des projections très éloignées dans le temps, on n’anticipe pas une réalité objective, mais on pose un problème à gérer. On retrouve toujours cette question de la politisation.
Il y aura bien sûr des zones fortement impactées par le changement climatique qui peut générer des mouvements migratoires, combinées à la recherche d’une vie économique meilleure ou à la recherche d’expériences biographiques, mais on ne peut pas penser à la crise climatique comme à un jeu de boulier qui poussent des boules. C’est un thème à traiter, oui, mais pas comme une peur.
Bernard : Dans le sens commun, comme tu dis, il y a aussi, cette idée de l'invasion. Est-ce qu'elle n'est pas démentie par le fait que les migrations Sud-Sud deviennent majoritaires et par l’importance des migrations de proximité ?
Andrea : Oui, beaucoup d’idées reçues sont à lever, y compris dans le discours sociologique. Sur les migrations Sud-Sud, j'ai repéré des données très intéressantes de l’OIM. On pense toujours que les pays pauvres sont les pays d'émigration. Mais parmi les pays de plus forte émigration dans le monde, on trouve le Royaume-Uni et l'Allemagne aux 14e et 18e rangs. A contrario, la Chine qu’on considère comme un pays pauvre reçoit un grand nombre de migrants. C'est un monde beaucoup plus complexe que les discours le laissent supposer. On a des déplacements courts, des déplacements Sud-Sud, des mouvements secondaires de plus en plus complexes. Et la crise climatique qui complexifie encore le tableau… C'est notre monde… il est complexe, mais la rhétorique alarmiste de l’invasion ne correspond pas à la réalité.
Je terminerais, si tu veux bien, avec la quatrième dimension des migrations méditerranéennes. Il s’agit de la complexification non seulement des catégories d’acteurs et des motivations, mais aussi des contextes. On peut penser au cas de l’Italie, qui, jusqu'au début du XXe siècle était un pays d'émigration et, à partir des années 70, tout en continuant à être un point de départ pour les émigrations vers la France et l'Europe du Nord, devient également une destination pour les migrations internationales. Elle connaît également ces dernières années la réalité des migrations internes en devenant de plus en plus un pays de transit. Et ça, c'est le cas dans toute la Méditerranée, en Espagne, en Grèce ou au Portugal, mais aussi en Turquie ou en Tunisie.
Cette complexification est liée aussi, comme on l’a vu, à une complexification interne des hiérarchies sociales, avec des statuts juridiques et sociaux différents, mais aussi à cause d’une complexification à l'échelle internationale, parce qu’il y a nécessité de négocier avec les pays de la rive sud qui sont interconnectés par les mouvements migratoires.
Biographies

Andrea CALABRETTA est chercheur postdoc à l’université de Padoue (Italie), où il donne des cours sur les méthodes de recherche qualitative en sociologie. Il a obtenu son doctorat en 2023 avec une thèse sur les relations transnationales entre la communauté tunisienne en Italie et le pays d’origine, basée sur la mobilisation des théories de Pierre Bourdieu. Outre les relations avec le contexte d’origine, il a travaillé sur les processus d’inclusion et d’exclusion sociale qui affectent les migrants et leurs descendants, leurs parcours de travail dans la société italienne et les processus de construction identitaire des migrants.
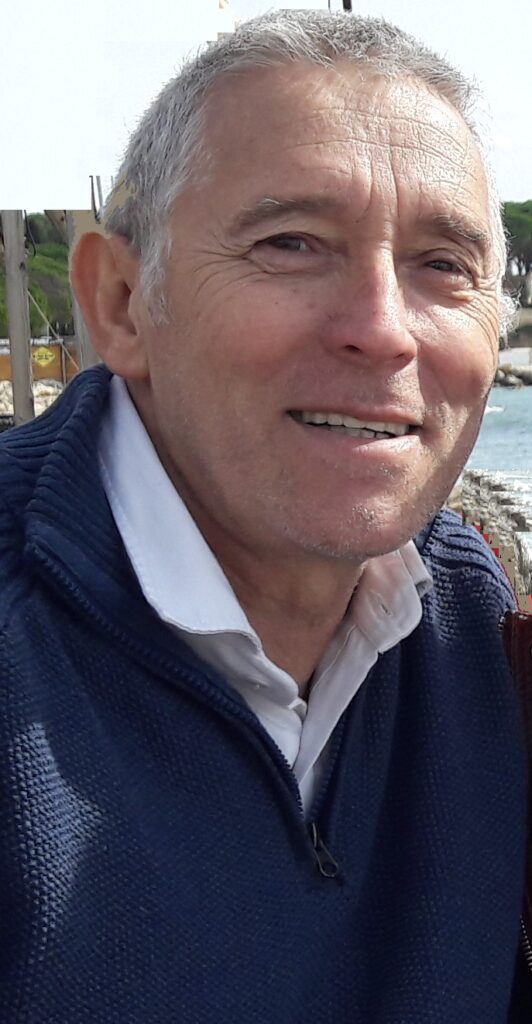
Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).
Bibliographie
Appadurai Arjun (2001), Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris : Payot.
Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc (1992), Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Paris: Seuil.
Calabretta Andrea (2023), Accepter et combattre la stigmatisation. La difficile construction de l’identité sociale de la communauté tunisienne à Modène (Italie), Territoires contemporains, 19. http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Espaces-Territoires/Andrea_Calabretta.html
Calabretta Andrea (2024), Doubles absences, doubles présences. Le capital social comme clé de lecture de la transnationalité, In A. Calabretta (ed.), Mobilités et migrations trans-méditerranéennes. Un dialogue italo-français sur les mouvements dans et au-delà de la Méditerranée (p. 137-150). Padova: Padova University Press. https://www.padovauniversitypress.it/system/files/download-count/attachments/2024-03/9788869383960.pdf
Castles Stephen, De Haas Hein and Miller Mark J. (2005 [dernière edition 2020]), The age of migration. International Population Movements in the Modern World, New York: Guilford Press.
de Haas Hein (2024), “L’idée de grandes vagues de migrations climatiques est très improbable”, article dans ‘L’Express’.
https://www.lexpress.fr/idees-et-debats/hein-de-haas-lidee-de-grandes-vagues-de-migrations-climatiques-est-tres-improbable-K3BQA6QEKRB2JCN4W47VTNCA2Y/
Elias Norbert (1987), The Retreat of Sociologists into the Present, Theory, Culture & Society, 4(2-3), 223-247. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/026327687004002003
Elias Norbert, Scotson John L. (1965 [réédition 1994]), The established and the outsiders. A Sociological Enquiry into Community Problems. London: Sage.
Fukuyama Francis (1989), “The End of History?” The National Interest, 16, 3–18. https://www.jstor.org/stable/24027184
Mezzadra Sandro, Neilson Brett (2013), Border as Method, Durham: Duke University Press. https://academic.oup.com/migration/article-abstract/4/2/273/2413380?login=false
Sayad Abdelmalek (1999a), La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré. Paris: Editions du Seuil.
Sayad Abdelmalek (1999b), Immigration et “pensée d’État”. Actes de la recherche en sciences sociales, 129, 5-14.
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1999_num_129_1_3299 Simmel Georg (1908 [réédition 2019]), L’étranger, Paris

À partir de cette conversation, l’IA a généré un flot d’illustration. Stefan Muntaner l’a nourri avec les données éditoriales et a guidé la dimension esthétique. Chaque illustration devient ainsi une œuvre d’art unique à travers un NFT.
