La Méditerranée est un espace représentatif des migrations dans le monde. Ce sujet, médiatisé et politisé, est l’objet de simplification et de lieux communs au moment même où, depuis une trentaine d’années, il se complexifie et se diversifie.
Il est au cœur de ce dialogue entre Bernard Mossé, responsable scientifique de NEEDE Méditerranée, et Andrea Calabretta, sociologue spécialiste des migrations dans le monde, en Méditerranée et en Italie en particulier. De quoi mieux comprendre cette problématique pointue.
À suivre sur cinq semaines.
# 2 -Face à la complexification des catégories et des motivations des acteurs de la migration, les sciences sociales ont dû adapter leurs outils d’analyse.
Bernard Mossé : Tu as dit que les catégories des sociologues ne collaient pas toujours aux catégories administratives. Est-ce que tu peux nous donner un exemple des catégories administratives qui sont retravaillées par les sociologues ? Et c'est aussi l'occasion pour moi de te demander, face à ces mutations, comment la sociologie et les sciences sociales en général ont évolué dans leur analyse.
Andrea Calabretta : Oui, bien sûr. C'est une question épistémologique : nous, sociologues, en tant que travailleurs des sciences sociales, comme l’analyse très bien P. Bourdieu, on est on est poussé à utiliser et à penser dans les catégories de sens commun et dans les catégories de l'État. On subit cette pression des catégories normatives, juridiques, comme si elles étaient objectives, ce qui n’est pas le cas : ce sont des catégories aussi créées socialement. Par exemple, il n'existe pas une différence, comment dire, « humaine », entre un demandeur d'asile et un migrant travailleur. On est appelé à travailler sur et avec des personnes qui sont catégorisées comme ça par l'État et cette catégorisation change leur vie. C'est évident que cette catégorisation a des effets objectifs sur la vie des personnes. Mais notre travail consiste aussi à déconstruire ces catégories prétendument « naturelles ».
C’est pour ça que je suis un grand fan du sociologue A. Sayad. Il nous amène, dès les années 1970, à penser la migration au-delà des catégories de l'État. On sait, grâce à lui, que toute migration de travail est aussi migration familiale. Ce sont des catégorisations qui existent, mais le sociologue doit être attentif à ne pas les normaliser, les naturaliser. C’est ma perspective encore aujourd'hui : dans les études migratoires, il existe ce risque-là d’être analytique, de laisser les institutions indiquer ce qui doit être étudié et comment nommer les choses. Le grand risque c’est de ne pas se donner le pouvoir de nommer les objets de recherche, parce que c'est vraiment ça, la base de notre travail.
Pour en venir à ta deuxième question, je pense que la sociologie des phénomènes migratoires a évolué dans les dernières années : on a appris à travailler dans la complexification. Ça a pris un peu de temps parce que jusque dans les années 1980, voire 1990, on avait quand même des lectures assez simples. il y a eu tout un travail de prise en compte de la complexité et aussi la récupération d'une pensée décoloniale.
Bernard : Est-ce réducteur de caractériser cette évolution de la recherche par le fait qu’avec A. Sayad, collaborateur de P. Bourdieu, on a pu considérer le migrant comme ni d'ici, ni de là-bas, dans la foulée de la décolonisation, et qu'aujourd'hui le migrant est considéré à la fois d'ici et de là-bas, notamment à travers l'analyse transnationale ?
Andrea : Selon moi, c’est un peu réducteur, oui. Parce que dans les ouvrages de Sayad, on n'a pas seulement de l'absence. Il y a aussi toute la question relative à la présence, la permanence en France des migrants, notamment algériens, qui se traduit par des trajectoires intergénérationnelles dans le pays d'immigration.
En fait, aujourd’hui comme hier, dans les années 1970, ces deux pôles dialoguent dans la vie du migrant : la présence et l’absence. Même s’il y a des changements qui les recomposent. Par exemple, le portable et les réseaux sociaux permettent aujourd’hui d’entretenir une relation sociale dans un sens large, communicationnel, symbolique. Mais ce serait simplifier que de parler de « double présence ».
Quelquefois, malgré des outils d’analyse plus performants, le chercheur est amené à simplifier son discours, à répondre brutalement à des phénomènes complexes. C’est le cas en particulier dans les réponses aux programmes de recherche des grandes organisations internationales et aux demandes des décideurs politiques. C'est un peu le risque que je vois dans la sociologie des migrations aujourd'hui : la simplification de la complexité, pour répondre aux besoins du « marché » de la recherche.
Bernard : Peut-être penses-tu aussi réducteur de dire que la sociologie des années 1970 considérait le migrant comme une personne subissant son sort alors qu'aujourd'hui elle le considère davantage comme acteur ?
Andrea : Non, ce n’est pas une simplification. Je pense qu’effectivement, comme je l’ai dit, les années 1990 constituent un changement dans l’imaginaire des migrations. Il existe aujourd’hui des outils, individuels, identitaires, qui portent les migrants à se déplacer non seulement d’un pays à l’autre, mais dans le monde social, différemment que dans le passé. L’image de soi du migrant lui permet de se considérer davantage comme acteur que comme simple participant d’une société d’accueil en quête de travailleurs. Je suis d’accord avec ce processus de construction des acteurs plus actifs dans la migration.
Même s’il existe parfois une lecture sociologique un peu trop optimiste et simplificatrice sur cet aspect.
Biographies

Andrea CALABRETTA est chercheur postdoc à l’université de Padoue (Italie), où il donne des cours sur les méthodes de recherche qualitative en sociologie. Il a obtenu son doctorat en 2023 avec une thèse sur les relations transnationales entre la communauté tunisienne en Italie et le pays d’origine, basée sur la mobilisation des théories de Pierre Bourdieu. Outre les relations avec le contexte d’origine, il a travaillé sur les processus d’inclusion et d’exclusion sociale qui affectent les migrants et leurs descendants, leurs parcours de travail dans la société italienne et les processus de construction identitaire des migrants.
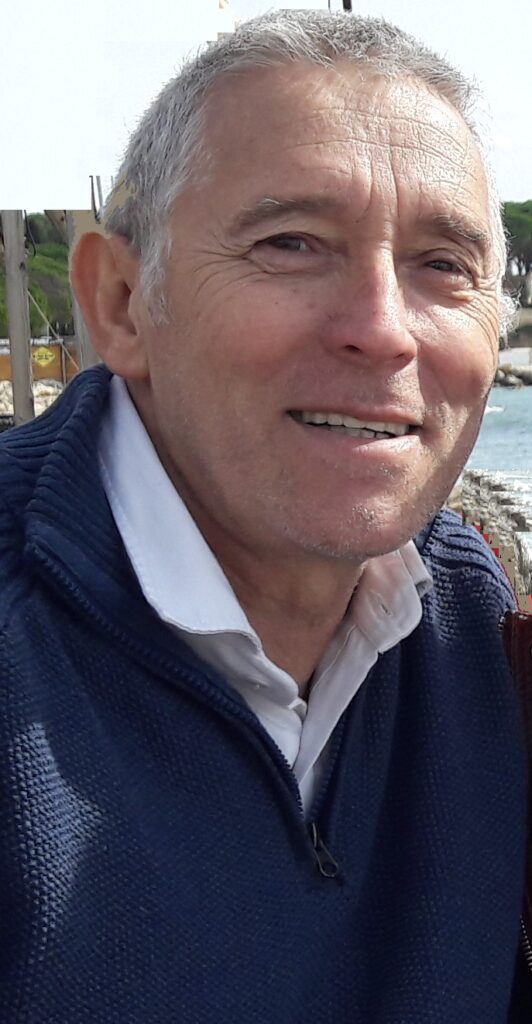
Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).
Bibliographie
Appadurai Arjun (2001), Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris : Payot.
Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc (1992), Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Paris: Seuil.
Calabretta Andrea (2023), Accepter et combattre la stigmatisation. La difficile construction de l’identité sociale de la communauté tunisienne à Modène (Italie), Territoires contemporains, 19. http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Espaces-Territoires/Andrea_Calabretta.html
Calabretta Andrea (2024), Doubles absences, doubles présences. Le capital social comme clé de lecture de la transnationalité, In A. Calabretta (ed.), Mobilités et migrations trans-méditerranéennes. Un dialogue italo-français sur les mouvements dans et au-delà de la Méditerranée (p. 137-150). Padova: Padova University Press. https://www.padovauniversitypress.it/system/files/download-count/attachments/2024-03/9788869383960.pdf
Castles Stephen, De Haas Hein and Miller Mark J. (2005 [dernière edition 2020]), The age of migration. International Population Movements in the Modern World, New York: Guilford Press.
de Haas Hein (2024), “L’idée de grandes vagues de migrations climatiques est très improbable”, article dans ‘L’Express’.
https://www.lexpress.fr/idees-et-debats/hein-de-haas-lidee-de-grandes-vagues-de-migrations-climatiques-est-tres-improbable-K3BQA6QEKRB2JCN4W47VTNCA2Y/
Elias Norbert (1987), The Retreat of Sociologists into the Present, Theory, Culture & Society, 4(2-3), 223-247. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/026327687004002003
Elias Norbert, Scotson John L. (1965 [réédition 1994]), The established and the outsiders. A Sociological Enquiry into Community Problems. London: Sage.
Fukuyama Francis (1989), “The End of History?” The National Interest, 16, 3–18. https://www.jstor.org/stable/24027184
Mezzadra Sandro, Neilson Brett (2013), Border as Method, Durham: Duke University Press. https://academic.oup.com/migration/article-abstract/4/2/273/2413380?login=false
Sayad Abdelmalek (1999a), La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré. Paris: Editions du Seuil.
Sayad Abdelmalek (1999b), Immigration et “pensée d’État”. Actes de la recherche en sciences sociales, 129, 5-14.
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1999_num_129_1_3299 Simmel Georg (1908 [réédition 2019]), L’étranger, Paris

À partir de cette conversation, l’IA a généré un flot d’illustration. Stefan Muntaner l’a nourri avec les données éditoriales et a guidé la dimension esthétique. Chaque illustration devient ainsi une œuvre d’art unique à travers un NFT.
