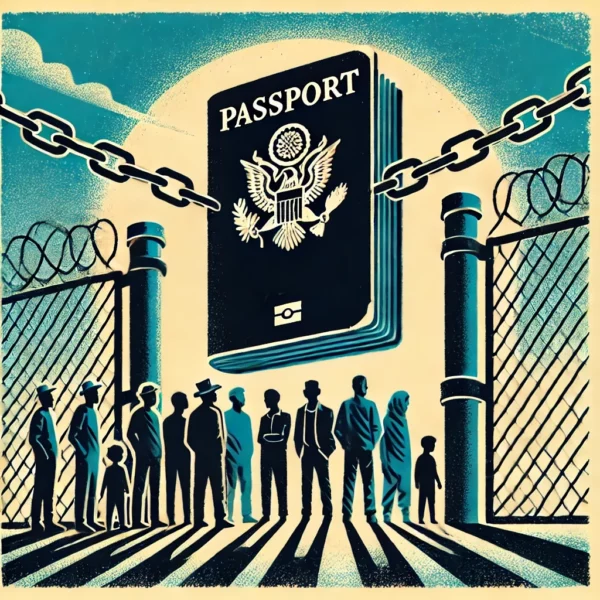La Méditerranée est un espace représentatif des migrations dans le monde. Ce sujet, médiatisé et politisé, est l’objet de simplification et de lieux communs au moment même où, depuis une trentaine d’années, il se complexifie et se diversifie.
Il est au cœur de ce dialogue entre Bernard Mossé, responsable scientifique de NEEDE Méditerranée, et Andrea Calabretta, sociologue spécialiste des migrations dans le monde, en Méditerranée et en Italie en particulier. De quoi mieux comprendre cette problématique pointue.
À suivre sur cinq semaines.
#1 Le monde dans lequel on vit a été construit par les migrations
Bernard Mossé : Cher Andrea, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Andrea Calabretta : Je suis chercheur en sciences sociales à l'université de Padoue en Italie où j’ai conduit ma recherche de doctorat. J'ai travaillé sur les relations transnationales, notamment sur la communauté tunisienne en Italie, et en particulier celle qui vit à Modène dans le nord de l’Italie et à Raguse, en Sicile. Elle entretient des relations avec le pays d'origine sur plusieurs volets : économique, symbolique et identitaire.
Après le doctorat, j'ai participé à un projet de recherche à Milan sur la condition de travail de plusieurs communautés immigrées dans la ville. Maintenant, je travaille à Padoue sur un projet de recherche sur la deuxième génération en Italie : les enfants de la migration, notamment d'origine maghrébine, qui sont en train de devenir adultes, souvent en recherche de travail. Comment grandissent-ils en Italie, quelles sont leurs conditions de vie, leur insertion dans la vie professionnelle, les questions d’habitat : comment ces enfants de migrants entrent dans l’âge adulte et vivent leur participation dans la citoyenneté italienne.
J'ai publié des travaux en anglais, en français, en italien, sur ces questions-là : le rapport avec le pays d'origine et l'exclusion sociale des migrants. Ce sont les deux volets majeurs de ma recherche en ce moment.
Bernard : Est-ce que tu peux nous faire un point général sur les migrations dans le monde et sur l'évolution de la sociologie elle-même par rapport aux migrations ?
Andrea : Je pense que c'est important de partir d’un constat : dans l’histoire humaine, il y a une continuité évidente des phénomènes migratoires. C'est important pour moi de le souligner parce que ça permet, surtout à nous chercheurs, de nous éloigner un peu de la pression de l'actualité : comme le dit le sociologue Norbert Elias, cette pression nous fait perdre de vue quelquefois la vision générale.
Il faut comprendre que le monde dans lequel on vit a été construit par les migrations.
Moi je suis né à Rome, la Ville éternelle, qui a été fondée, selon la légende, par les descendants d’Enée, un prince parti de Troie, en Anatolie : Enée c’est un demandeur d’asile en quelque sorte, si on peut le dire dans les termes d’aujourd’hui !
Bernard : Avec sa femme, son fils, ses amis, et son père Anchise sur le dos… !
Andrea: C'est ça. L’histoire du monde est marquée par les migrations et par une certaine permanence de ce phénomène. Pour rester sur le cas italien et revenir à la période contemporaine, l’Italie a été bouleversée par les migrations : on estime qu’en un siècle, entre 1876 et 1988, 27 millions d'Italiens sont partis à l'étranger : c'est presque la moitié de la population de l’Italie d’aujourd'hui. Ce sont des chiffres énormes qui ont changé l'horizon humain et social du pays. À une époque, le 19ème siècle, où les sociétés d'Europe, d'Amérique et d'Océanie étaient reconfigurées par le mouvement migratoire.
C'est pour dire les continuités et l’importance des phénomènes migratoires. Et c'est la base de l’analyse : ces déplacements de personnes transforment les sociétés d’origine comme les sociétés d’arrivée. C’est un phénomène social récurrent : on a des autochtones qui se connaissent déjà, qui ont un certain pouvoir social, et des nouveaux arrivés qui manquent de ressources.
Il y a également la question constante de la temporalité de la migration. C’est ce que nous dit Georg Simmel : l'étranger est celui qui reste le lendemain. On ne peut pas parler de migration sans s’intéresser à la temporalité de ces mouvements.
Il y a aussi la question de l'espace. Pas seulement le mouvement dans l'espace géographique, mais aussi le mouvement dans l'espace social et dans l'espace symbolique.
Dans ces grandes continuités, ce n’est pas simple de déterminer des discontinuités. Mais dans l’histoire récente, je pense qu’on peut fixer un moment de discontinuité dans les années 1990, parce que c'est un moment où on assiste à un effondrement du modèle communiste, à un renouvellement politique dans le Monde, un nouvel imaginaire qui se crée, relatif à la communication, aux moyens de transport. Il y a vraiment ce que l'anthropologue indien Arjun Appadurai pense en termes de nouveaux « paysages », un ensemble historique de différents acteurs collectifs en mutation : États-nations, sociétés transnationales, communautés diasporiques, groupes et mouvements sous-nationaux et même plus intimes comme les villages, les quartiers, et les familles, ce qu’il nomme les ethnoscapes…
Ces nouveaux imaginaires sont traversés par des personnes en mobilité : pas seulement les migrants, mais aussi d'autres figures (entrepreneurs, touristes, pèlerins, etc.) qui, dans leur mouvement, interagissent avec d'autres mouvements, parfois antagoniques : mouvements financiers, communicationnels, médiatiques.
On peut penser qu'à partir des années 1990, les caractéristiques typiques de la migration demeurent, mais elles s'appliquent et se réalisent dans un terrain social différent. C'est ce qu’on désigne en termes de « globalisation », même si c’est un terme que je n’aime pas beaucoup. Mais quand même, on peut dire que les migrations sont prises dans une société globale qui est beaucoup plus interconnectée, et s’inscrivent dans un imaginaire qui s’est déplacé.
Bernard : Pardon, juste une parenthèse ; à quoi est due cette réticence à employer le terme de globalisation? C'est parce que la globalisation s'accompagne aussi pour toi d'une régionalisation ?
Andrea : Ma réticence est relative au fait que c'est un terme avec une dimension plus politique que scientifique, comme beaucoup d'autres termes qu'on utilise en sociologie, et que j’utilise moi-même, comme intégration, transnationalisme... Le terme de globalisation s’est développé, surtout dans les années 1990, dans une dimension politique comme synonyme d’un avenir très positif de la société mondiale néolibérale.
Cet imaginaire politique induit l'idée qu'on vivra dans un monde sans histoire, comme dit Francis Fukuyama. Et évidemment, ce n’est pas ce vers quoi nous allons.
Donc, par rapport à ces nouveaux paysages qui se développent dans les années 1990, je pense que pour caractériser le phénomène migratoire actuel, on peut faire référence aux analyses du livre très connu The age of migration des sociologues S. Castles, H. De Haas and M. J. Miller (2005), qu'on peut résumer par la notion de complexification.
La vraie clé pour comprendre les migrations actuelles, c'est de les penser comme un phénomène complexe, beaucoup plus complexe que ce qu’on a appris à connaître auparavant.
Tout d'abord la mondialisation des migrations. De plus en plus de pays sont impliqués dans les flux migratoires internationaux. Des régions du monde qui étaient épargnées sont aujourd'hui en plein dans les mouvements humains généraux et sont des acteurs clés en tant que pays d'origine et que pays de destination.
Un changement des directions des flux migratoires. Les flux Sud-Sud sont devenus majoritaires par rapport aux flux Sud-Nord. Des régions sont devenues de nouveaux pôles migratoires : le Golfe persique par exemple est une nouvelle région d’arrivée.
Une différenciation interne du phénomène et de ces motivations. Les catégories du passé ne sont plus valables : les personnes en mouvement ne sont plus seulement des travailleurs de l’usine ou qui relèvent du regroupement familial, mais il y a une prolifération de figures et de chemins. Les migrations de transit deviennent plus longues et plus lourdes.
Une féminisation de la main-d'œuvre immigrée : ça, c'est une question qui va être centrale dans les prochaines années en Europe, surtout avec nos sociétés vieillissantes, et le travail du soin qui est un travail essentiellement féminisé.
Ces tendances sont en dialogue les unes avec les autres.
Finalement, dans ces bouleversements, le plus important, c'est la politisation croissante du thème de la migration. Il y a eu les élections européennes en juin dernier : on a vu que c’était pratiquement impossible de mener une campagne électorale sans parler des migrations.
En ce sens, la complexification objective des mouvements migratoires est étroitement liée à leur politisation et à l'invocation d'un durcissement des règles.
D’un côté, on cherche à fermer les frontières, d’un autre côté, on cherche à rendre les conditions de vie des migrants de plus en plus lourdes. Ainsi les routes de transit deviennent de plus en plus longues et de plus en plus difficiles.
Des pays d’émigration ou de transit deviennent des pays d'immigration parce que les personnes sont obligées de rester là-bas pour des années. C’est le cas par exemple de la Turquie.
C'est un peu ça l'image qu’il faut avoir : une image de complexification qui s’accompagne d’une politisation, c’est-à-dire en l’occurrence d’une criminalisation des migrants, et pas seulement en Europe : c'est la même chose un peu partout, comme en Amérique, entre les États-Unis et le Mexique.
Biographies

Andrea CALABRETTA est chercheur postdoc à l'université de Padoue (Italie), où il donne des cours sur les méthodes de recherche qualitative en sociologie. Il a obtenu son doctorat en 2023 avec une thèse sur les relations transnationales entre la communauté tunisienne en Italie et le pays d'origine, basée sur la mobilisation des théories de Pierre Bourdieu. Outre les relations avec le contexte d'origine, il a travaillé sur les processus d'inclusion et d'exclusion sociale qui affectent les migrants et leurs descendants, leurs parcours de travail dans la société italienne et les processus de construction identitaire des migrants.
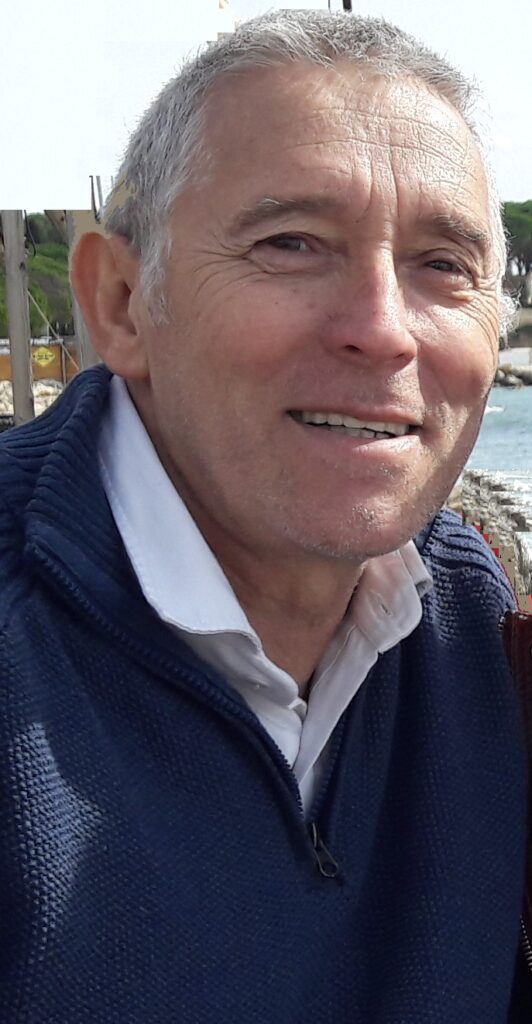
Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).
Bibliographie
Appadurai Arjun (2001), Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris : Payot.
Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc (1992), Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Paris: Seuil.
Calabretta Andrea (2023), Accepter et combattre la stigmatisation. La difficile construction de l’identité sociale de la communauté tunisienne à Modène (Italie), Territoires contemporains, 19. http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Espaces-Territoires/Andrea_Calabretta.html
Calabretta Andrea (2024), Doubles absences, doubles présences. Le capital social comme clé de lecture de la transnationalité, In A. Calabretta (ed.), Mobilités et migrations trans-méditerranéennes. Un dialogue italo-français sur les mouvements dans et au-delà de la Méditerranée (p. 137-150). Padova: Padova University Press. https://www.padovauniversitypress.it/system/files/download-count/attachments/2024-03/9788869383960.pdf
Castles Stephen, De Haas Hein and Miller Mark J. (2005 [dernière edition 2020]), The age of migration. International Population Movements in the Modern World, New York: Guilford Press.
de Haas Hein (2024), "L’idée de grandes vagues de migrations climatiques est très improbable", article dans ‘L’Express’.
https://www.lexpress.fr/idees-et-debats/hein-de-haas-lidee-de-grandes-vagues-de-migrations-climatiques-est-tres-improbable-K3BQA6QEKRB2JCN4W47VTNCA2Y/
Elias Norbert (1987), The Retreat of Sociologists into the Present, Theory, Culture & Society, 4(2-3), 223-247. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/026327687004002003
Elias Norbert, Scotson John L. (1965 [réédition 1994]), The established and the outsiders. A Sociological Enquiry into Community Problems. London: Sage.
Fukuyama Francis (1989), “The End of History?” The National Interest, 16, 3–18. https://www.jstor.org/stable/24027184
Mezzadra Sandro, Neilson Brett (2013), Border as Method, Durham: Duke University Press. https://academic.oup.com/migration/article-abstract/4/2/273/2413380?login=false
Sayad Abdelmalek (1999a), La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré. Paris: Editions du Seuil.
Sayad Abdelmalek (1999b), Immigration et "pensée d'État". Actes de la recherche en sciences sociales, 129, 5-14.
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1999_num_129_1_3299 Simmel Georg (1908 [réédition 2019]), L’étranger, Paris
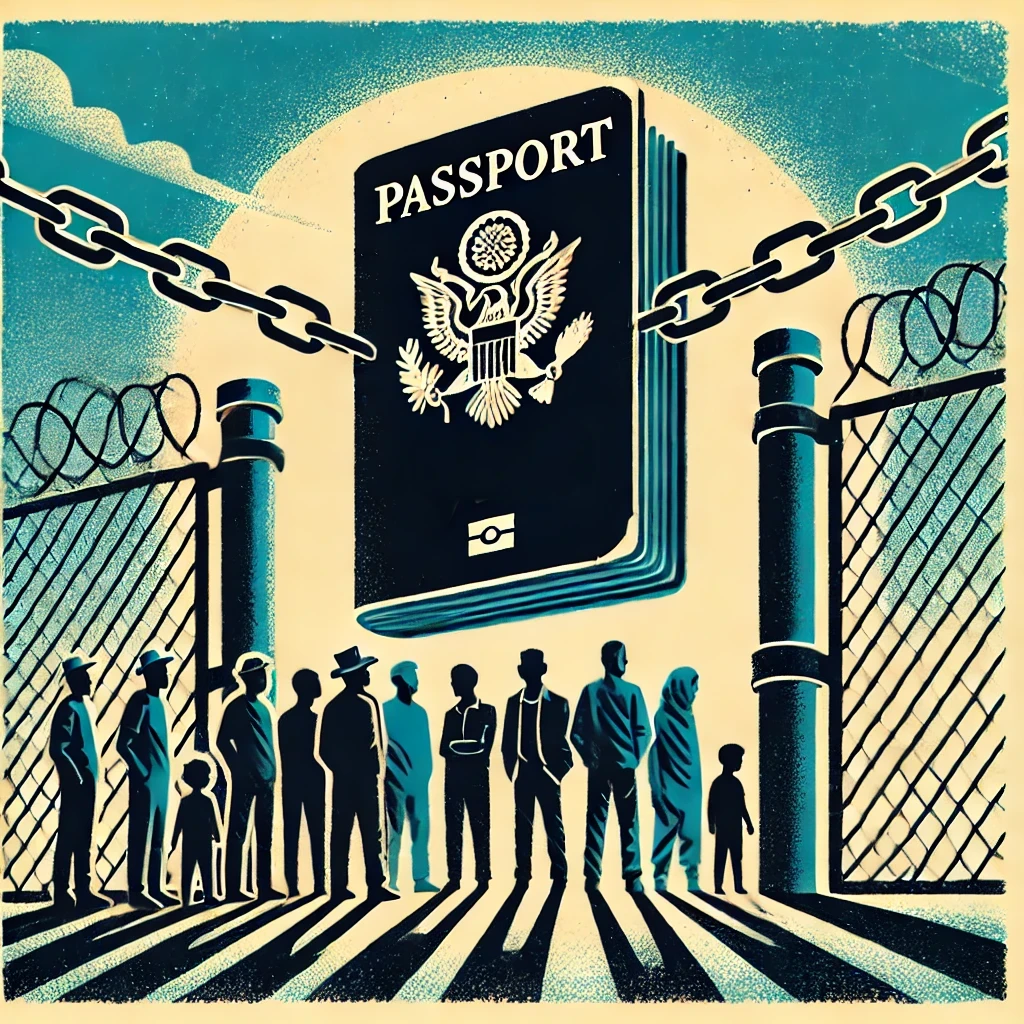
À partir de cette conversation, l’IA a généré un flot d’illustration. Stefan Muntaner l’a nourri avec les données éditoriales et a guidé la dimension esthétique. Chaque illustration devient ainsi une œuvre d’art unique à travers un NFT.