Longtemps considérée comme une zone de passage ou de départ, la Méditerranée est aujourd’hui au cœur des dynamiques migratoires mondiales. Entre transformations économiques, politiques, symboliques et sociales, les migrations se complexifient, tout en alimentant tensions et fantasmes. Le sociologue Andrea Calabretta éclaire ces enjeux à travers ses recherches sur les parcours migratoires en Italie et au-delà.
Cet article est un résumé de 4 entretiens entre scientifiques publiés dans 22-med en octobre 2024. Un dialogue entre Bernard Mossé responsables scientifique de Neede Méditerranée et Andrea CALABRETTA chercheur à l’université de Padoue (Italie), où il donne des cours sur les méthodes de recherche qualitative en sociologie. Outre les relations avec le contexte d’origine, il a travaillé sur les processus d’inclusion et d’exclusion sociale qui affectent les migrants et leurs descendants. Les 4 entretiens sont à retrouver ICI dans les 11 langues utilisées sur le site.
Les migrations ne sont pas une nouveauté. « Le monde dans lequel on vit a été construit par les migrations », rappelle Andrea Calabretta. L’Italie en est un exemple frappant : entre 1876 et 1988, près de 27 millions d’Italiens ont émigré. Aujourd’hui, la Méditerranée devient une région de réception, de transit, mais aussi de recomposition identitaire. Depuis les années 1990, la chute du bloc soviétique, l’essor des transports et des réseaux numériques ont transformé les mobilités humaines : les flux migratoires ne suivent plus les schémas anciens. Ils se mondialisent, se féminisent, se fragmentent
Des catégories à repenser, des frontières à comprendre
Face à la diversité des parcours, les catégories administratives classiques — réfugié, migrant économique, regroupement familial — deviennent inadéquates. « Les sociologues doivent éviter de reproduire les cadres de l’État », souligne Calabretta, qui plaide pour une lecture critique des notions imposées par les politiques migratoires. L’essor des « border studies » illustre cette évolution : la frontière devient un filtre sélectif, plus qu’un mur, créant des statuts précaires à géométrie variable au sein même des sociétés d’accueil. Résultat : une « pyramide de la citoyenneté » dans laquelle les droits sont inégalement répartis.
La Méditerranée, laboratoire des tensions migratoires
En Méditerranée, les migrations sont fortement politisées. Depuis les années 1990, les conditions d’entrée en Europe se sont durcies, transformant la mer en frontière mortelle. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, plus de 30 000 personnes sont mortes en dix ans en tentant de la traverser. Cette fermeture nourrit un discours de peur, souvent en décalage avec la réalité. Les migrations Sud-Sud, plus nombreuses que celles vers le Nord, sont peu médiatisées. Loin d’une invasion, les mobilités actuelles sont complexes, motivées par des raisons imbriquées : économiques, familiales, climatiques, personnelles.
L’exclusion se construit aussi de l’intérieur
L’expérience de la communauté tunisienne à Modène montre comment les distinctions entre « anciens » et « nouveaux » migrants se cristallisent. En temps de crise, les groupes dominants renforcent les hiérarchies, et les migrants installés peuvent eux-mêmes chercher à se différencier des derniers arrivés. Cette logique de fragmentation est renforcée par des politiques publiques qui exploitent les divisions internes. « Même bien intégrés, les descendants de migrants peuvent rester perçus comme étrangers », observe Calabretta. L’enjeu est donc de reconnaître la construction sociale de ces catégories, et non de les essentialiser.
Vers une recomposition sociale lente mais nécessaire
Les migrations en Méditerranée révèlent des tensions, mais aussi des opportunités de recomposition sociale. « Le changement viendra lentement, avec des conflits, mais il est inévitable », affirme Calabretta. La reconnaissance de la pluralité des parcours, l’intégration des descendants, et une relecture des politiques migratoires au prisme des réalités vécues sont les conditions d’une société plus inclusive. Comprendre cette complexité est un préalable essentiel à toute action publique durable.
Biographies

Andrea CALABRETTA est chercheur postdoc à l’université de Padoue (Italie), où il donne des cours sur les méthodes de recherche qualitative en sociologie. Il a obtenu son doctorat en 2023 avec une thèse sur les relations transnationales entre la communauté tunisienne en Italie et le pays d’origine, basée sur la mobilisation des théories de Pierre Bourdieu. Outre les relations avec le contexte d’origine, il a travaillé sur les processus d’inclusion et d’exclusion sociale qui affectent les migrants et leurs descendants, leurs parcours de travail dans la société italienne et les processus de construction identitaire des migrants.

Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).
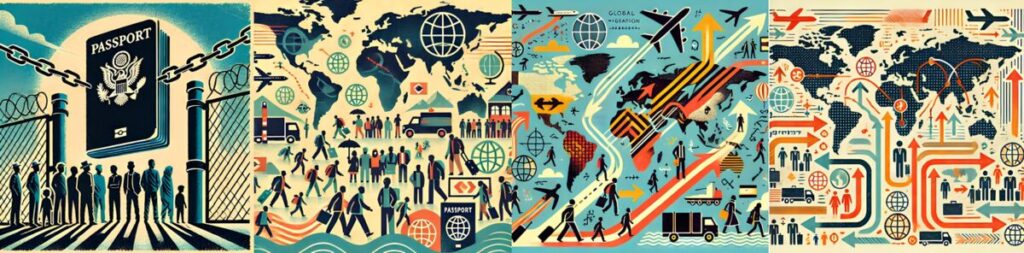
Photo de Une : Bateaux de migrants dans le port de Lampedusa © Dionigi Albera
Indexation : Bibliothèque des savoirs méditerranéens
Migrations en Méditerranée
Andrea Calabretta – Bernard Mossé
22-med
14 août 2025
• La migration est un phénomène historique permanent en Méditerranée qui se complexifie depuis les années 1990.
• La Méditerranée est un laboratoire des tensions migratoires : politisation, frontières, décès en mer, criminalisation.
• Les catégories administratives sont inadaptées à la réalité vécue des parcours.
• La migration n’est jamais monocausale : elle conjugue raisons économiques, climatiques, sociales et personnelles.
• Les migrants sont à la fois acteurs et victimes des hiérarchies sociales, y compris au sein de leur propre communauté.
• L’évolution passe par une recomposition sociale lente mais nécessaire.
Tunisie – Italie
#migration #Méditerranée #frontière #politisation #Tunisie #Italie #sociologie #hiérarchie_sociale #complexité #globalisation #secondarité
