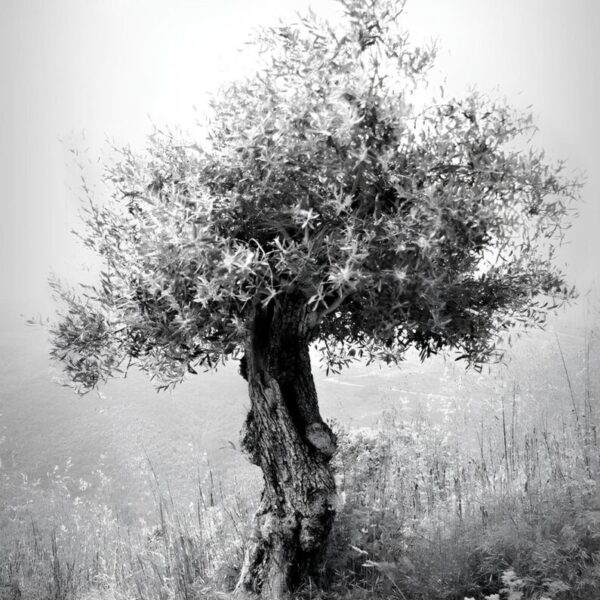Dans cette chronique, diffusée l’année dernière par France Culture, Dominique Eddé nous invite à faire un pas de côté, dans cette région du monde, le Proche-Orient, aujourd’hui si tourmentée et ensanglantée, pour nous faire entendre le murmure et la sagesse des oliviers…
Romancière inspirée, pensons notamment à son livre visionnaire, « Kamal Jann » sur la Syrie contemporaine, prise dans une sorte de tragédie antique dont elle raconte les mécanismes inéluctables, ou à son récent « Palais Mawal », Dominique Eddé est une voix singulière. Editorialiste à la plume acérée, pour le journal « Le Monde » ou pour « L’Orient le Jour », essayiste à la pensée lumineuse, pour mieux nous faire connaître et comprendre « Le crime de Jean Genet » ou « Edward Saïd, le roman de sa pensée », elle éclaire notre temps et met en récits notre monde…
Je vous propose d’entendre un rêve éveillé. Imaginez un instant….
Deux minutes de rêve éveillé. Imaginez un instant la région vidée de ses populations sans qu'il leur soit fait de mal, juste le temps de renouer, en leur absence, avec le paysage. Imaginez ensuite la remise en marche de tous ces pays dont le Liban, sur le modèle de leurs arbres, rien que leurs arbres.
Les troncs des oliviers tressent le temps dans leur écorce noueuse, tantôt marron, tantôt grise selon l'heure de la journée. Certains ont 1000 ans, d'autres viennent de naître. Chacun est un règne à lui seul. Aucun ne dicte la loi. Leurs branches montent en V, parfois un, parfois cinq, parfois plus. Elles s'affinent au fur et à mesure de manière à libérer les feuilles qui, au moindre coup de vent, font trembler la lumière.
Elles sont toutes solitaires et forment toutes ensemble des buissons indivisibles aux allures de nuages, aux verts et aux gris multicolores. Elles me font penser par leurs tailles, leurs formes, leurs couleurs aux petits poissons argentés, les bezree, qui filent en bancs par dizaines de milliers, sous la surface de la mer.
Quoi de plus humble et de plus résistant qu'une feuille d'olivier aux rebords à peine retournés, si bien qu'une goutte de pluie, peut y loger sans tomber. Les oliviers, placent les paysages au-dessus des pays et la lumière au-dessus de l'espace. Nous autres, habitants surexcités de tous ces lieux ensanglantés aux oliveraies en feu, aurions beaucoup à gagner en préférant leur manière de grandir à la nôtre, en les imitant, ne serait ce qu'une heure par jour.
La bibliothèque de Méditerranée
Chroniques et critiques
Par Thierry Fabre
Il est si bon de se plonger, ou de se replonger, dans un conte pour notre temps. C’est cette chance que nous donne Zineb Mekouar dans son très beau livre « Souviens-toi des abeilles ».
Un monde s’ouvre sous nos yeux, inscrit dans une terre, ou mieux dans un terroir comme celui du Haut-Atlas, au Maroc, dans le village d’Inzerki. C’est là où les personnages principaux de ce récit, les abeilles, trouvent leur place. Avec un vieil homme, Jeddi, un enfant, Anir, une mère égarée ou possédée, la mejnouna, devenue folle de tristesse et un père absent, Omar, qui ne sait plus très bien comment faire, désarmé, perdu face au monde tel qu’il va.
Le Taddart obéit à des règles très strictes, là où les ruches du village sont déposées et assemblées. C’est le théâtre principal de cette histoire qui nous invite à partager le mystère des abeilles. De leur organisation, de leur envol comme de leur immense fragilité, face au réchauffement et à l’aridité qui vient et qui semble devoir les faire disparaître.
Comment imaginer un monde sans abeilles ? Un monde sans floraison, sans la douceur du miel qui répare et qui soigne, sans la saveur de ce nectar dont nous ne savons plus vraiment goûter le suc ? La banalité de ce qui est consommé a effacé notre sens de la rareté, cette quête de l’émerveillé qui est juste là, dans une cuillèrée de miel. Il vient de cet univers si organisé et complexe des abeilles, fruit d’un art de butiner, de polliniser, d’un sens de la mesure et de tout un équilibre, aujourd’hui rompu, entre la nature, les abeilles et les hommes.
Zineb Mekouar sait, à travers son art subtil du récit, nous faire entrer dans ce monde où les équilibres sont aussi fragiles qu’instables. Les croyances sont puissantes dans le village et l’ordre des abeilles, comme la répartition du miel entre les familles doit être strictement respecté, au risque d’un effondrement de la vie en commun.
C’est un monde âpre qui se révèle dans la vie d’Inzerki, là où chaque geste est épié, où l’entre-soi prédomine et où un ordre quasi immémorial s’impose. Mais c’est un lieu où la terre gronde aussi, où les secousses d’un tremblement de terre viennent retourner l’espace, comme la vie des hommes, qui n’ont pas d’autre choix que de faire face, de faire front et d’inventer un avenir incertain. Nombreux sont ceux qui partent vers la ville, tenter leur chance à Agadir, mais la misère et l’absurde ne sont jamais bien loin, chimère des temps modernes.
Reste le temps et la douceur des abeilles, le temps de la beauté d’un conte qui sait nous entraîner, nous emporter dans son histoire, nous enchanter, en recherchant une forme épurée, une simplicité qui fait écho à ces murmures lointains qui font la beauté d’un être…et d’un livre.
Zineb Mekouar, « Souviens-toi des abeilles », Gallimard, 2024, 170p, 19 euros
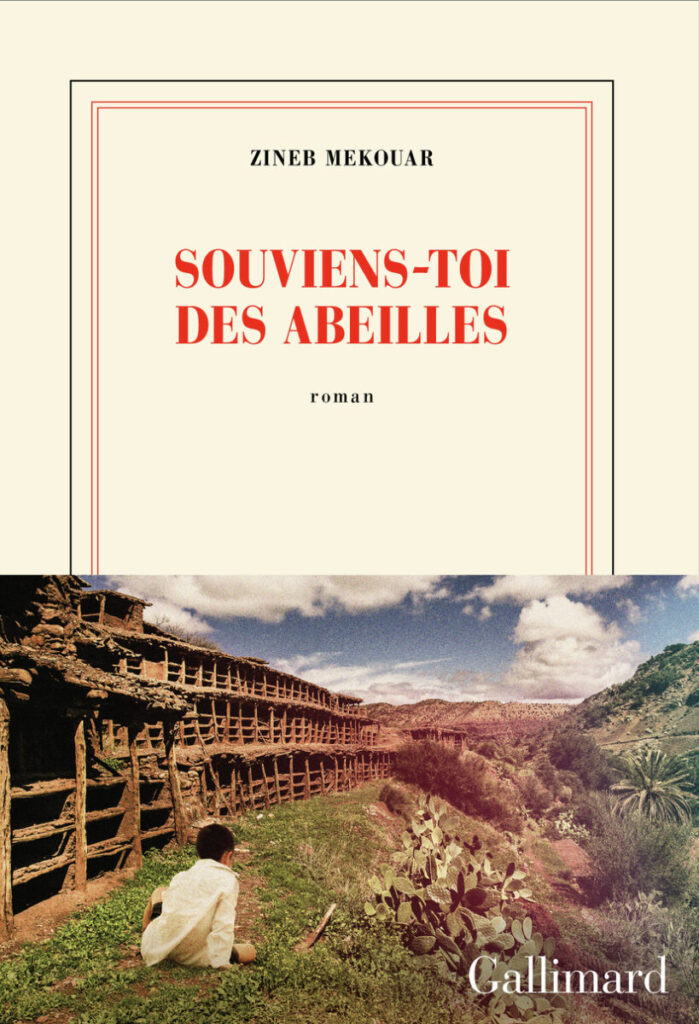
Alors que la chute de la maison Assad a lieu, sous nos yeux ébahis, après plus d’un demi-siècle d’un pouvoir effroyable et destructeur, d’un pouvoir qui emprisonne et qui avilit, une espérance nouvelle, teintée d’inquiétude, arrive depuis la Syrie. Il est bon, dans un tel contexte de se plonger dans les livres de Justine Augier, qui a su inventer une forme, entre le récit politique et la littérature, qui nous invite à ouvrir bien grand les yeux sur le monde tel qu’il va.
Il y eut, en 2017, « De l’ardeur. Histoire de Razan Zeitouneh avocate syrienne », qui a permis à tous ceux qui ne connaissaient pas ce pays, la Syrie, d’entrer dans la révolution syrienne à partir du regard de cette passionaria, malheureusement enlevée et disparue, avec Samira Khalil, épouse de Hassin el Hadj Saleh, grande figure de l’opposition au régime de Hafez el Assad, père du sinistre Bachar.
Ce livre, qui a reçu le prix Renaudot de l’essai 2017, porte si bien son nom-« De l’ardeur ». Il sait nous faire vibrer, au rythme des secousses politiques, de toutes les exactions et les bombardements, y compris au gaz toxique, que la population civile a dû subir de la part du régime. Des figures se sont alors dressées, et Razan Zeitouneh est de celles-là, qui refusent de consentir au pire et qui cherche à tisser des liens avec toute une partie de la population syrienne, marginalisée et méprisée, qu’elle a cherché à défendre dans ses plaidoiries. Cette plongée dans la société syrienne est particulièrement instructive aujourd’hui, alors qu’un scepticisme méprisant et orientalisant est dans la bouche de tant de commentateurs. Comme si la Syrie ne parviendrait jamais à instaurer un nouvel ordre politique, équitable. Justine Augier suit les traces de Razan Zeitouneh pour tenter d’éclairer la société syrienne au prisme de cette figure, lumineuse et entêtée, résolue et si profondément humaine. Il lui a fallu tant de courages, pour ne pas renoncer, pour ne pas s’enfuir, et pour tenter de résister à la police et à l’armée de Bachar el Assad, relayée par l’armée russe, l’Iran et le Hezbollah libanais, sans oublier les groupes islamistes qui l’ont enlevée. Pour se faire une idée, disons plus juste ou visuelle, de ce que fut cet enfer sur terre de la Syrie sous Bachar, il faut voir le film, à la fois lumineux et bouleversant, « Pour Sama » de Waad el Kateab, qui raconte l’intimité d’un hôpital syrien, bombardé sans cesse par les barils russes, qui terrorisent et déchiquettent la population civile, qui ne peux y échapper. Si l’on veut découvrir la misère et de l’infâmie du régime syrien, comme la grandeur, le courage et la force d’une grande partie de la société, qui a su résister face au pire, alors ce film- « Pour Sama » et ce livre-« De l’ardeur » sont parmi ces rares pépites qui donnent une raison de vivre et le désir de ne jamais désespérer. La « marge humaine », comme dirait Romain Gary, se donne ainsi à voir et à lire, pleinement, et on en ressort comme grandi, debout face à l’écrasement et à l’infâmie. Tous les complices de la maison Assad, et ils sont nombreux dans le monde, comme en France, de l’extrême droite à l’extrême gauche, devraient perdre définitivement la face. Mais le sens de la décence humaine n’est pas vraiment le fort de « ces gens-là ».
Justine Augier quant à elle, maintient le cap et ne cesse de vouloir éclairer les angles morts. Ainsi en va-t-il de son enquête édifiante, en Syrie toujours, à propos des complicités du cimentier Lafarge avec la soldatesque de Daech. Son nouveau livre, « Personne morale », redonne à cette appellation juridique d’une entreprise son sens plein et entier. C’est un livre exemplaire, fait de précision dans l’enquête, de rigueur dans l’analyse, de probité dans l’écoute, des témoins et des acteurs. C’est un livre implacable aussi, qui démonte les complicités et les mensonges d’une des plus grandes entreprises qui fabrique du ciment dans le monde. Elle avait installé une immense usine en Syrie, très gros investissement qui a servi à justifier toutes les compromissions de cette soi-disant « personne morale », jusqu’à mettre gravement en danger son personnel syrien sur place.
Avec un sens du récit remarquable, elle nous raconte le combat d’une ONG internationale, en particulier des femmes qui incarnent ce travail si ardu et minutieux pour réunir un faisceau d’indices graves ou concordants, visant à faire condamner Lafarge.
Ce récit, qui revient dans plusieurs chapitres, alterne avec la vision de l’entreprise et de son puissant PDG, Bruno Lafont, les jeux douteux d’intermédiaires sans foi ni loi tels que Firas Tlass, les agents secrets et autres chargés de la sécurité, le bataillon d’avocats, mobilisé par Lafarge pour obtenir l’impunité, alors que les liens de l’entreprise avec Daech sont avérés, mais pas encore prouvés par l’institution judiciaire. Ce livre est l’histoire d’un combat inégal, du droit contre la force, raconté avec précision et détermination, où le droit finit par s’imposer, malgré tout et avant tout grâce à des personnes qui restent debout, ne reculent pas face aux intimidations, ne renoncent jamais, n’acceptent pas les choses, telles quelles sont, injustes, misérables, insupportables. Il y a là encore de l’ardeur, une véritable continuité avec le livre précédent, dans cette histoire d’une « personne morale » qui part en vrille et se révèle être prête à tout, jusqu’au pire, pour préserver ses bénéfices. Ma priorité est de créer de la valeur pour nos actionnaires, souligne bien tranquillement le PDG de Lafarge, hors de tout contexte…
Véritable plongée dans l’univers délétère d’une grande entreprise, en plein cœur de la Syrie tourmentée des Assad, le livre de Justine Augier devrait être enseigné dans toutes les écoles de commerce ! Il donne un cap, permet à une entreprise de ne pas perdre complètement la boussole et de toujours se souvenir « qu’il n’est de richesse que d’homme ».
« Razan Zaitouneh a disparu en décembre 2013 mais sa trajectoire, comme la façon dont son être persiste et continue d’inspirer, révèle la force de cette arme du droit, qui permet comme peu d’autres d’attiser la détermination et la volonté d’agir. » C’est par cette leçon d’humanité que Justine Augier conclut son livre. Une « personne morale », assurément.
Justine Augier, De l’ardeur. Histoire de Rayzan Zeitouneh, avocate syrienne. Actes-Sud, 2017, 21 ,80 euros.
Justine Augier, Personne morale, Actes-Sud, 2024, 22 euros.
Film, « Pour Sama », de Waad el Kateab et Edward Watts, 2019, 1h44’
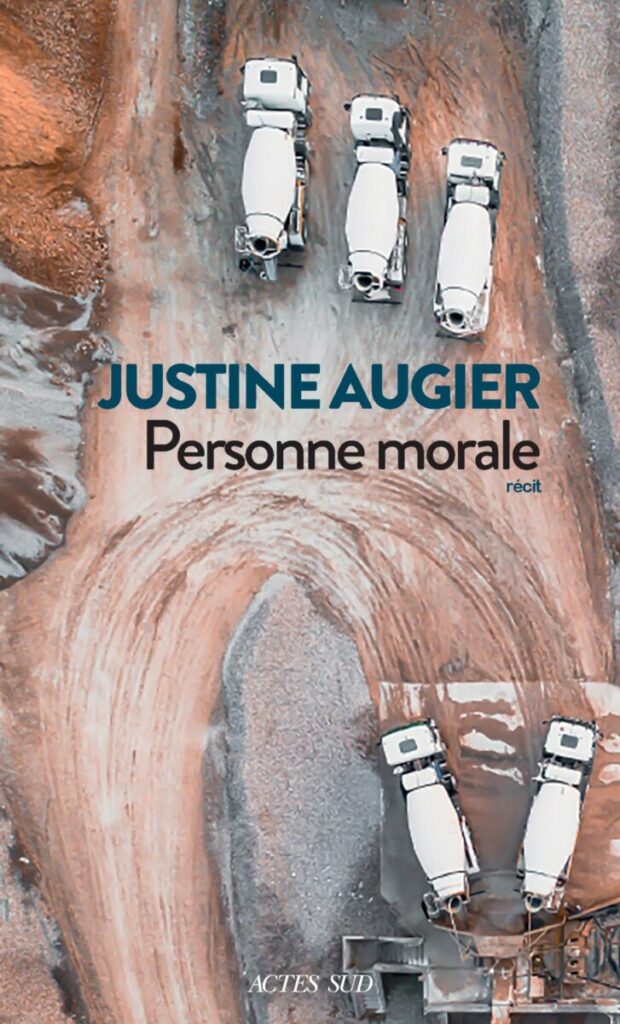
Photo de Une : @ Thierry Fabre