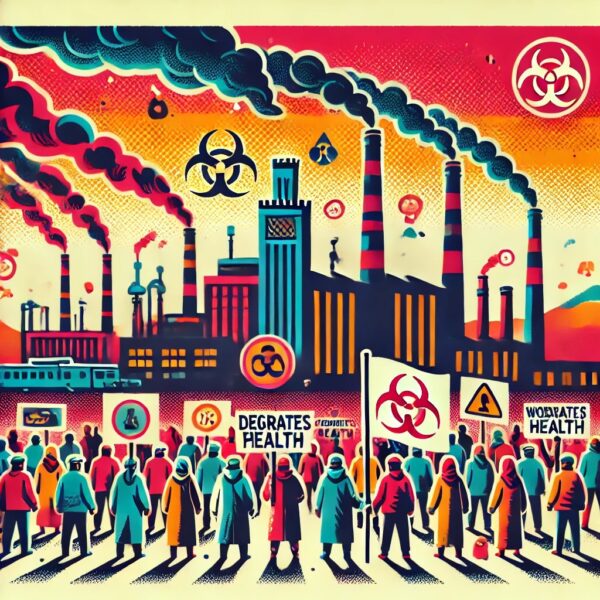Fethi Rekik est professeur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et directeur du laboratoire de recherche d‘État, Culture et Mutations de Société’ à la faculté des Lettres et Sciences humaines de Sfax, Tunisie. Il est également militant écologique dans sa ville de Sfax depuis les années 2000.
Sfax, « la capitale du Sud » a connu, depuis les années 1980, un déclin continu. Deuxième centre économique du pays, après Tunis, Sfax est une ville à la culture entrepreneuriale : huileries, élevage bovin, pêche, confection... Mais elle est aujourd’hui en déclin du fait de la mondialisation avec la concurrence des pays d’Asie, et la concurrence interne de Tunis et Sousse.
Ville régionale qui ambitionne de devenir « métropole méditerranéenne », les indicateurs de développement la classent à présent au cinquième, voire au septième rang national. Ce déclin a des causes multiples : mondialisation, fuite des élites économiques et culturelles à la Capitale ou à l’étranger, passage à une économie de service… mais une des causes déterminantes est la dégradation de la qualité de vie due à la pollution industrielle -notamment chimique- malgré la mobilisation citoyenne depuis 1980 et surtout après la révolution de 2011.
L'ère du service nécessite un cadre de vie propre et attractif que la ville de Sfax, très polluée, n’offre plus.
Jusqu’en 2011, une seule association, l’APNES, militait sur la question environnementale dans la région de Sfax, et particulièrement sur la pollution des entreprises chimiques : la SIAPE (Société industrielle d’acide phosphorique et d’engrais) et la NPK (azote, phosphore et potassium).
Après la révolution de 2011, avec l’acquisition de la liberté d’expression, de nombreux mouvements citoyens ont émergé, y compris sur la thématique environnementale.
Un collectif s’est alors dessiné pour faire fermer la SIAPE. Mais il s’est heurté à des résistances, notamment syndicales : 3000 emplois sont en jeu.
En 2019, une décision gouvernementale de fermeture est prise, mais sans projet de dépollution et sans plan de réaménagement du site. Un autre combat commence qui engage la qualité de vie des habitants, mais aussi l’attractivité économique de la ville.
Les dégâts de la pollution industrielle
Des chercheurs ont démontré la très grande nocivité des usines sur la santé, avec des cas de maladies graves. On a largement pointé du doigt la radioactivité du phosphate avec des montagnes de gypse sur le littoral. C’est toute la zone de Sfax Sud qui est impactée sur un rayon de 15 à 20 kilomètres. C’est une région pleine de richesses naturelles endommagées par le phosphogypse : on ne peut bien sûr plus y pêcher…
Plus au nord, on a trouvé une solution : on a mis en place une sorte de rond-point géant de 50 hectares, on a mis du gazon, de l’eau… c'est devenu une sorte de parc. Apparemment, ce n’est pas nocif…
Les associations avancent l’idée d’un projet de reconversion qui permettrait, une fois le site dépollué, de dynamiser la région en l’engageant sur la voie de la transition à l’économie propre, et qui s’inscrirait dans un vrai projet de métropolisation. Malheureusement ce n’est pas le chemin qui est pris.
Sfax dans le projet de régionalisation
Le modèle de développement de la Tunisie depuis l'Indépendance a été fondé sur une sorte de privilège accordé à Tunis et à la région côtière (Nabeul, Sousse). Il y a des régions de l'intérieur délaissées : ce sont des régions dites « handicapées ».
Il y a des milliers de Tunisiens qui partent en Europe, en particulier de Sfax : 70 000 personnes porteuses de hautes compétences sont parties dans les dernières années vers les États-Unis, l’Europe ou les pays du Golfe : c’est une perte énorme pour la population tunisienne. De Sfax, chaque année, il y a notamment des milliers de bacheliers qui partent pour l’Allemagne pour poursuivre les études et pour y travailler.
Il y a un autre facteur qui affaiblit Sfax. Pour être un compétitif, il faut un réseau de transport qui relie la ville à d’autres régions. Mais le réseau d’autoroutes est exclusivement lié à la capitale. Cela suscite un sentiment de marginalisation d’une bonne partie de l’intérieur du pays.
En 2019. Il y a eu un sentiment de révolte des régions délaissées par le pouvoir. En fait, c’est un sentiment de révolte contre le modèle de développement, et finalement un sentiment de révolte contre la démocratie elle-même.
Le paradoxe de Sfax, c’est qu’elle est considérée comme une ville du système parce qu’elle aurait les moyens de se développer. Mais elle n’a jamais été dans le système et elle se considère elle-même hors système.
C’est le drame d’être considéré dans le système et de ne pas y être.
La ville de Sfax fait face à des défis majeurs liés à la pollution industrielle, au manque d’investissements, et à une gouvernance centralisée peu favorable à son développement. La société civile tente de pallier ces carences, mais des changements structurels et une ouverture au capital étranger semblent nécessaires pour transformer la région en un pôle économique durable.