Sfax, « la capitale du Sud » a connu, depuis les années 1980, un déclin continu dont les causes sont multiples : mondialisation, fuite des élites économiques et culturelles à la Capitale ou à l’étranger, passage à une économie de service… mais une des causes déterminantes est la dégradation de la qualité de vie due à la pollution industrielle -notamment chimique- malgré la mobilisation citoyenne depuis 1980 et surtout après la révolution de 2011.
Sociologue et militant écologique sfaxien, Fethi Rekik analyse ce cas exemplaire avec le recul du scientifique et témoigne de ce combat difficile avec l’engagement du citoyen, dans un dialogue avec Bernard Mossé, historien, responsable Recherche, Éducation Formation de l’association NEEDE Méditerranée.
Bernard Mossé : Sfax occupe une place particulière dans l’histoire économique de la Tunisie. Peux-tu nous dire un mot de ce contexte, pour mieux situer la question industrielle et environnementale sfaxienne que tu viens de décrire ?
Fethi Rekik : L'idée générale, c'est que dans les années 1960 et 1970, dans le cadre de l'économie nationale, il y a déjà à Sfax une culture entrepreneuriale.
On peut reprendre les analyses de plusieurs spécialistes, notamment du géographe Ali Bennasr, qui caractérise Sfax comme une ville régionale inscrite dans un projet de métropolisation .
Deuxième centre économique du pays, après Tunis, Sfax a toujours été en délicatesse dans son rapport à l’État central. Marquée par sa culture entrepreneuriale, elle se développe pourtant dans plusieurs domaines :
l’agroalimentaire, avec l’entreprise Poulina (PHG) implantée dans tout le pays, avec des filiales au Maroc et dans d’autres pays encore ;
dans le domaine de l’oléiculture : même si l’olivier est partout en Tunisie, Sfax détient toujours aujourd’hui 1/3 de la production du pays, en huile principalement, ce qui est considérable ;
malgré un climat semi-aride, c’est une région d’élevage bovin avec notamment la production laitière ;
et aussi bien sûr l’industrie chimique : la SIAPE (Société industrielle d’acide phosphorique et d’engrais) et la NPK (azote, phosphore et potassium).
Mais à la fin des années 1970, surviennent les premiers effets de la mondialisation, l’ouverture du pays à la production étrangère, en particulier l’importation des produits d’Asie, via la Libye, dans le domaine du textile et de la confection, avec son marché informel qui entraine beaucoup de faillites, même si certaines entreprises réussissent à se maintenir. Mais ce n’est pas le même poids qu’autrefois.
Surtout on passe de l’ère industrielle à l’ère de service qui requiert de meilleures infrastructures. Le secteur privé de service se concentre là où il y a l’ouverture sur la mer bien sûr, mais aussi de meilleures conditions de vie.
À partir de ce moment, comme l’explique un géographe tunisien, 80% à 90% des investissements privés sont accaparés par ce qu’on appelle le « triangle compétitif », ou le « triangle utile », qui comprend Tunis, Nabeul et le Cap Bon, et descend jusqu’à Sousse. Il exclut donc la région de Sfax, plus au sud, et tout le Sahel tunisien.
Sfax est en fait sanctionnée par les dégâts de l’industrie chimique : une grande partie de l’élite économique sfaxienne est partie à Tunis où elle constitue une diaspora. Elle s’implante par exemple à El Ennasr, un quartier chic de Tunis.
Tu vois, on a découvert cette communauté dans une finale de match de football en 1994, entre le CS Sfax et l’Espérance de Tunis…
Bernard Mossé : c’est une vieille rivalité entre ces deux clubs…,
Fethi Rekik : Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a découvert le poids de la population sfaxienne à Tunis. C'est là où on a découvert qu'il y a une grande communauté et pas des moindres, parce que c'est l'élite économique. Et pas seulement économique, mais l'élite culturelle. Il y a aujourd’hui à Tunis des Sfaxiens qui ne sont pas des acteurs économiques. Ils sont par exemple avocats, juges… Des médecins émigrent vers Tunis parce que la nombreuse clientèle libyenne qui venait d'habitude, pendant les années 1980-90, aux polycliniques de Sfax, un secteur très, très prospère, maintenant se déplace par avion directement à Tunis. C'est ce qui fait que même les médecins les meilleurs vont à Tunis.
L'ère du service nécessite un cadre de vie propre et non pollué que Sfax n’offre pas. Elle se vide ainsi de ses forces vives.
En termes de migration, elle est certes toujours excédentaire du fait des populations qui arrivent des régions de l’intérieur, de Sidi Bouzid, Kairouan ou Gafsa ..
Cela compense numériquement les départs. Mais la différence c’est que ce sont des personnes peu ou pas qualifiées, alors que ceux qui partent sont les élites économiques et intellectuelles.
Bernard Mossé : On peut donc dater ce déclin des années 1980 ?
Fethi Rekik ; Oui, le déclin de Sfax commence au début des années 1980 avec la mondialisation, la flexibilité de l’emploi qu’accompagne le nouveau Code du travail, le développement de la sous-traitance… Sfax se spécialise dans des industries peu qualifiées avec peu de valeurs ajoutées, comme le textile qui emploie des femmes à faible qualification. Les meilleures industries se délocalisent à Tunis…
Toujours selon le géographe Ali Bennasr, le gouvernorat de Sfax, dite « capitale du Sud », considérée en théorie comme le deuxième pôle économique du pays est en réalité aujourd’hui la 5e région du pays : elle est peut-être même passée, tout récemment, à la 7e place.
Sfax reste démographiquement la 2e ville du pays, juste derrière Tunis, mais elle est classée 5e sur le plan des indicateurs de développement et d’attractivité.
Un exemple : depuis les années 1990, les dirigeants des grands clubs de football sont des grands hommes d’affaires, des patrons d’industrie. Sur les dix derniers présidents du CS Sfax, un seul réside à Sfax ; les autres vivent à Tunis … ils ont leurs affaires à Tunis. Il y a même un Sfaxien qui est un dirigeant … de l’Espérance de Tunis.
Ils investissent à Gamarth, à la Marsa, dans la banlieue de Tunis, mais pas à côté de la SIAPE atteinte par la pollution…
Ainsi, comme l’écrit Ali Bennasr, « aux retards d'aménagement et de mise à niveau de son tissu économique viennent s'ajouter de graves problèmes environnementaux… Ces obstacles se présentent comme un handicap majeur devant la métropolisation et l'internationalisation de la ville ».
Biographies
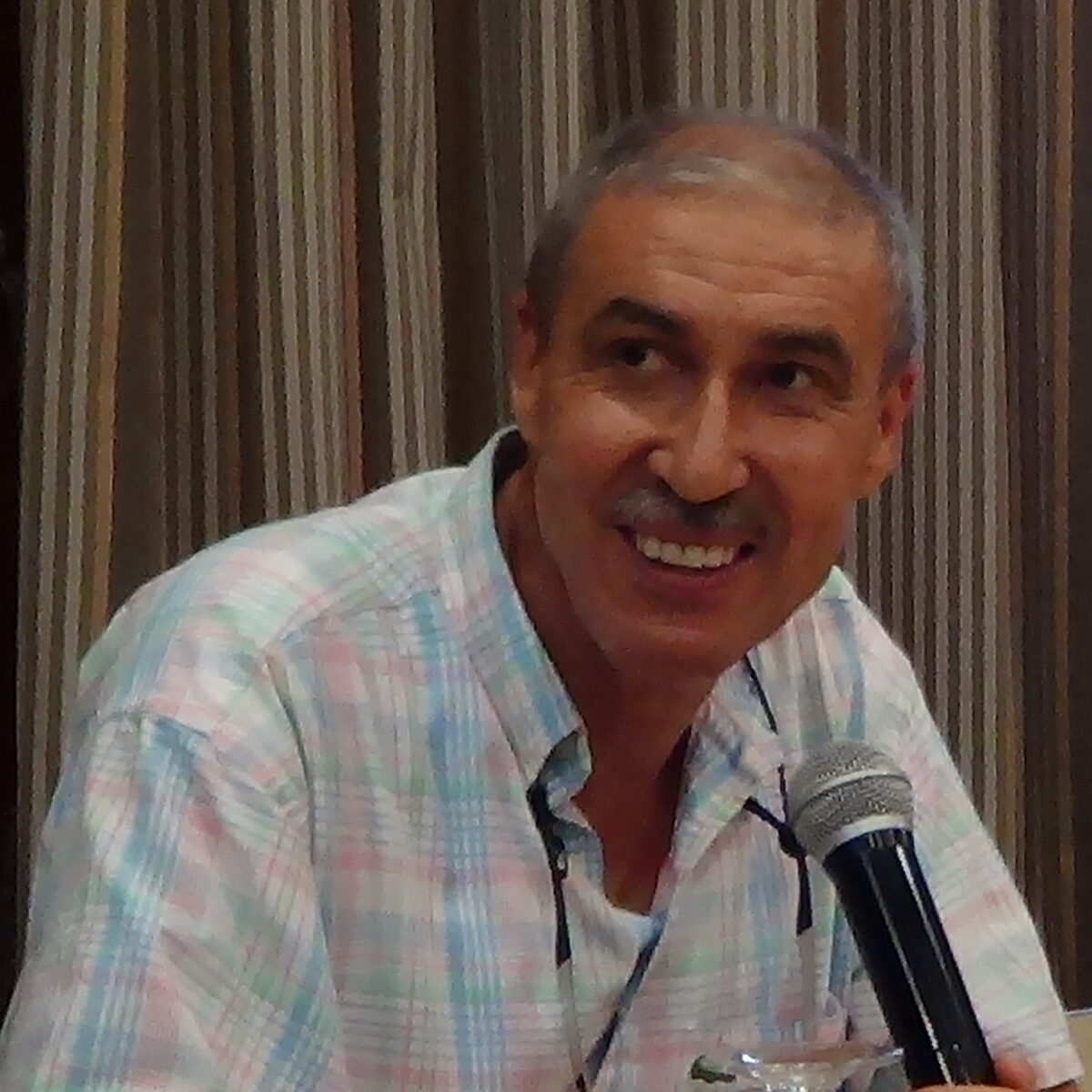
Fethi Rekik est professeur (HDR) de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et directeur du laboratoire de recherche ‘Etat, Culture et Mutations de Société’ à la faculté des Lettres et Sciences humaines de Sfax, Tunisie. Il est également militant écologique dans sa ville de Sfax depuis les années 2000.

Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).
Bibliographie :
