Mer fermée, la Méditerranée concentre les pollutions. Au cœur du problème : les déchets, dont la gestion reste inégale d’une rive à l’autre. Entre initiatives locales et stratégies nationales, scientifiques et associations alertent sur les risques pour l’environnement et la biodiversité. Et appellent à repenser la gestion des déchets comme un levier de transition écologique. Illustration avec la France et Algérie.
Cet article est un résumé de trois entretiens entre scientifiques publiés dans 22-med en juin 2024. Un dialogue entre Justine Viros, scientifique spécialiste de la forêt méditerranéenne et des interactions chimiques forêt – atmosphère dans le cadre du changement climatique, ingénieure de Recherche au sein de la mission Interdiscipinarité(s) d’Aix-Marseille Université et Mélissa Kanane, Docteure en protection des écosystèmes spécialisée en gestion des déchets et enseignante vacataire à l’Université de Tizi-Ouzou en Algérie. Ces entretiens sont à retrouver dans les 11 langues utilisées sur le site.
La Méditerranée est l’une des mers les plus polluées du monde. À 80 %, cette pollution provient de la terre : les fleuves, les vents et les bassins versants charrient les déchets jusqu’à la mer, où ils s’accumulent. Si 10 % d’entre eux sont visibles (mégots, emballages...), 90 % sont invisibles : des microplastiques qui s’infiltrent partout, jusque dans les fonds marins. Ces pollutions affectent directement les écosystèmes : ingestion de plastique par la faune, contamination des sols et nappes phréatiques par les lixiviats toxiques issus de décharges mal gérées, perturbation de la chaîne alimentaire. Chaque année, plus de 1,5 milliard d’animaux marins meurent à cause des déchets plastiques. Et les humains ne sont pas épargnés : les métaux lourds, persistants, se retrouvent dans nos aliments et notre eau.
Algérie : entre système défaillant et solutions locales
Avec plus de 11 millions de tonnes de déchets ménagers produits chaque année, l’Algérie fait face à un défi environnemental et sanitaire majeur. Le schéma national repose encore essentiellement sur la collecte en mélange et l’enfouissement en centre technique, souvent mal contrôlé. Résultat : fuites toxiques, pollution des sols et mauvaise valorisation des déchets.
Pourtant, des alternatives émergent. En Kabylie notamment, des initiatives locales misent sur le tri à la source, le compostage et le recyclage. Des comités de village collaborent avec des entreprises de traitement des déchets et forment les jeunes à ces pratiques. Plus de 60 % des déchets ménagers y sont organiques, et donc facilement valorisables.
Les pistes pour améliorer la situation sont connues : infrastructures de tri, compostage, recyclage, principe du pollueur-payeur, mais aussi coordination entre acteurs publics et citoyens. Encore faut-il que la volonté politique suive.
France : quand l’abondance entrave le tri
De l’autre côté de la Méditerranée, la France fait face à des enjeux différents, mais complémentaires. Le niveau de consommation y génère une grande quantité de déchets non organiques, souvent emballés. Le tri est obligatoire, mais reste peu efficace : dans la région Sud-PACA, pourtant à la pointe de la modernité, les performances sont en dessous de la moyenne nationale.
Les associations comme Clean my Calanques ou MerTerre pallient les carences institutionnelles par des campagnes de sensibilisation, des ramassages citoyens, ou des programmes éducatifs. La diversité des types de déchets, l’éloignement entre les producteurs et les lieux de traitement, et la faible responsabilisation des industriels compliquent encore la gestion.
Pour faire évoluer les comportements, la sensibilisation reste cruciale. L’ancrage culturel, le cadre de vie et les politiques publiques jouent un rôle majeur dans l’adoption des bons réflexes de tri.
Pour une réponse commune aux enjeux méditerranéens
La gestion des déchets est autant une question environnementale qu’un marqueur social et culturel. Des déchets organiques aux emballages plastiques, ils révèlent nos modes de vie, nos priorités politiques et nos choix économiques. En Méditerranée, mer partagée, ils deviennent un enjeu commun.
La Convention de Barcelone, signée en 1976, pose les bases d’une gouvernance environnementale conjointe. Mais les efforts doivent aller bien au-delà des textes. Coopérations régionales, éducation à la consommation, soutien aux initiatives citoyennes et innovations comme la phytoremédiation sont autant de leviers pour avancer.
Un avenir durable passera par des politiques transversales, ancrées dans les territoires, et par une prise de conscience collective : la mer est un miroir de nos déchets, mais elle peut aussi devenir le reflet de nos engagements.
Biographie

Melissa Kanane : Docteure en protection des écosystèmes spécialisée en gestion des déchets et enseignante vacataire à l’Université de Tizi-Ouzou en Algérie. Ses travaux sont consacrés à la quantification, identification, caractérisation et valorisation des déchets ménagers et assimilés.

Justine Viros : Scientifique spécialiste de la forêt méditerranéenne et des interactions chimiques forêt – atmosphère dans le cadre du changement climatique. Elle occupe actuellement un poste d’ingénieure de Recherche au sein de la mission Interdiscipinarité(s) d’Aix-Marseille Université où elle est chargée de mission développement pour l’association Neede Méditerranée.
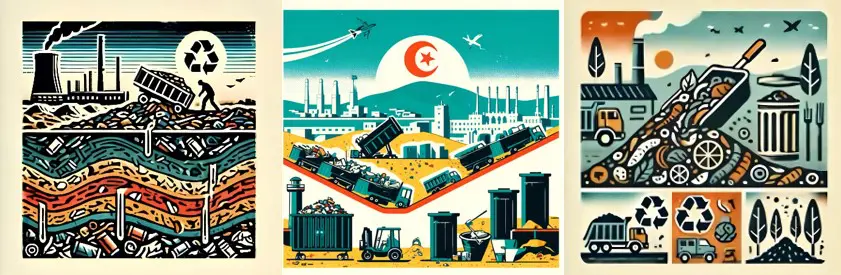
Photo de Une : La Méditerranée concentre les pollutions, dont 80 % viennent de la terre © DR
