Saviez-vous que plus de 95 % des communications internationales et des transferts de données dépendent des réseaux de câbles sous-marins mondiaux ? Au départ, cela peut sembler être un petit fait amusant : quelle curiosité ! - la technologie la plus évoluée et révolutionnaire de notre époque n'est pas basée sur des satellites, mais serpente plutôt le long du fond marin (pourquoi associons-nous toujours la modernité à l'espace ?). Mais si nous prenons le temps de considérer les aspects de la vie qui dépendent de cette technologie — finance, diplomatie, sécurité, coopération internationale— son importance critique devient claire.
Par Ada Ferraresi
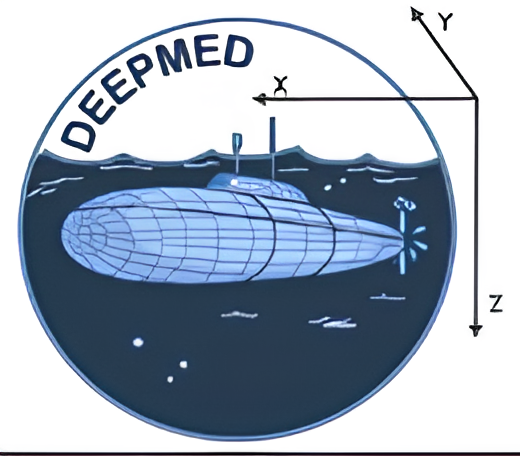
Cet article s’inscrit dans le cadre du programme de recherche Deepmed/ ERC ( European Research Council) piloté par Lino Camprubí de l’Université de Séville
Dans le climat géopolitique tendu d'aujourd'hui, les ruptures de câbles sont de plus en plus attribuées à des actes de sabotage. En 2022, par exemple, le web mondial a faibli suite à des coupures intentionnelles de câbles sous-marins dans le sud de la France – Marseille est un hub mondial de données sous-marines. Des accusations de sabotage russe ont suivi. La vulnérabilité de cette infrastructure sous-marine suscite des alarmes parmi les gouvernements, les entreprises et les médias. Comme le note un article dans The Guardian, ces attaques suspectées ont mis "les pays européens en état d'alerte maximale."
Bien que cet alarmisme ne soit pas surprenant, il est en partie mal placé et potentiellement dangereux. Une grande partie du discours actuel implique que cette menace est nouvelle, alimentée par la croissance explosive du trafic Internet mondial depuis 2013. Pourtant, les systèmes de câbles sous-marins existent depuis le 19ème siècle. Le premier a été posé en 1850 entre Douvres et Calais, suivi huit ans plus tard par le premier câble transatlantique. En quelques décennies, une grande partie du globe était connectée par des lignes sous-marines, la plupart contrôlées par des entreprises privées britanniques.
Le sabotage, une stratégie militaire
De plus, il manque dans ces récits une reconnaissance que le sabotage est lui-même aussi ancien que la communication sous-marine. Un article spécialisé récent déclare : “Des activités auparavant inconnues – telles que … l'utilisation de navires de pêche comme forces paramilitaires ; ou l'exploration et la patrouille des eaux d'autres nations comme moyen d'élargir les revendications souveraines - sont des exemples de la manière dont Pékin gagne dans la zone grise tandis que ses adversaires essaient encore de diagnostiquer le problème dans leurs catégories bien rangées de lois et de normes.”
Historiquement, cependant, ces activités n'étaient pas seulement entendues, mais largement acceptées comme des stratégies militaires légitimes. Pendant la Première Guerre mondiale, les forces britanniques, autrichiennes, allemandes et italiennes ont toutes ciblé les câbles sous-marins comme une stratégie militaire principale. L'ingénieur en câbles italien Emanuele Jona a décrit le blocus télégraphique de l'Angleterre sur l'Allemagne comme "passé sous silence", comme un "blocus implacable, inévitable, précis et certain — comme un phénomène astronomique : un blocus lourd de conséquences graves — le blocus des communications télégraphiques avec le monde entier.”
Il a détaillé plusieurs incidents de sabotage : les Allemands coupant des câbles d'Afrique à l'Australie, les Autrichiens coupant des lignes près des îles Tremiti, et les forces italiennes ciblant des câbles ottomans reliant Constantinople à des villes à travers la Méditerranée orientale. Un opérateur italien se souvient de l'ordre de couper le câble autrichien entre Trieste et Corfou—"le seul câble encore opérationnel parmi nos ennemis. Les câbles allemands au nord avaient tous été coupés par les Britanniques quelques heures après la déclaration de guerre avec l'Allemagne.” Le sabotage de câbles est devenu une tactique militaire précoce et répandue dans les conflits suivant l'avènement du télégraphe sous-marin, utilisée par toutes les nations — pas seulement celles dans les zones grises de la guerre moderne.
Par conséquent, les inquiétudes concernant le sabotage des câbles sont compréhensibles dans la mesure où la scène géopolitique d'aujourd'hui s'approche des eaux dangereuses. Cependant, elles ne doivent pas être comprises comme des inquiétudes concernant un nouveau danger : nous vivons sous la menace du sabotage des câbles depuis 200 ans ! En fait, le sabotage est si ancien que la Convention internationale pour la protection des câbles a été signée en 1884 et reste le principal cadre juridique.
Les moyens de communication premières cibles de guerre
Plus préoccupant que la menace elle-même est le discours qui l'entoure : les câbles sous-marins sont présentés comme s'ils se développaient indépendamment des sociétés qui les ont créés, poussés uniquement par la demande croissante d'Internet. Ils semblent autonomes — vulnérables, mais implacables. Et si la technologie est perçue comme indépendante, les lois qui la régissent le sont aussi. À tel point qu'à l'atelier 2024 du Comité international de protection des câbles (ICPC) sur le Droit de la mer et les câbles sous-marins, lorsqu'il s'agissait de discuter “de la question de savoir si les États ont le droit de couper des câbles en cas de conflit armé”, il a été établi que, “en raison de raisons historiques, les câbles ne sont pas considérés comme neutres et pourraient être les premières cibles de la guerre”. Cette vulnérabilité, alors, n'est pas inévitable — elle reflète des choix juridiques et politiques faits depuis deux siècles. La loi est faite par l'homme et peut être changée ; la fragilité du réseau est une question de volonté, pas de destin. Le point est que les avantages de l'environnement sous-marin ont toujours surpassé les obstacles depuis le tout début.
Malgré son inaccessibilité, l'espace sous-marin a longtemps permis aux puissances terrestres d'agir discrètement —sous les vagues, pour ainsi dire. Cela est particulièrement vrai pour un espace géopolitiquement et topographiquement complexe comme la mer Méditerranée.
Au 19ème et au 20ème siècle, les entreprises britanniques détenaient un quasi-monopole mondial sur le télégraphe sous-marin et étaient fréquemment mandatées pour construire des réseaux sous-marins pour d'autres États. Dans l'Empire ottoman, qui manquait du savoir-faire technologique pour le câblage sous-marin, les entreprises britanniques non seulement installaient l'infrastructure, mais acquéraient également des connaissances détaillées sur sa géographie. Cela a donné à la Grande-Bretagne un accès privilégié à des informations hautement stratégiques.
Pendant la guerre italo-turque (1911-12), menée pour le contrôle de la Libye, couper les câbles ennemis était une tactique militaire essentielle. Bien que la Grande-Bretagne soit officiellement restée neutre, elle a discrètement aidé l'Italie : dès 1900, le navire câblier italien Città di Milano a reçu des cartes britanniques montrant l'emplacement des câbles méditerranéens. Un opérateur de l'époque note : "deux représentants de la English Cable Company sont rapidement montés à bord … nous laissant en charge d'un étui en métal contenant des cartes nautiques avec les routes de tous les câbles qui formaient leur vaste réseau méditerranéen." Que cela se soit produit plus d'une décennie avant la guerre suggère une prévoyance stratégique. L'Empire britannique semblait neutre à la surface, mais en dessous, il traçait des frontières à son avantage. Nous devrions nous concentrer sur l'environnement sous-marin non pas parce qu'il abrite de nouvelles menaces, mais parce que sa nature fluide et souvent opaque a permis des manœuvres géopolitiques incontrôlées pendant des siècles.
Un déséquilibre nord / sud
En fait, puisque la pose de câbles sous-marins a été un choix actif des sociétés humaines depuis le 19ème siècle, des mesures de contre-sabotage ont également été mises en place. Conscientes de la vulnérabilité de l'environnement, les entreprises installent souvent plusieurs routes pour garantir la redondance. Poser des câbles coûte cher, mais les grands acteurs d'aujourd'hui — Google, Meta, etc.—peuvent se le permettre. Pendant ce temps, les pays du Sud global dépendent souvent de réseaux fragiles, manquant de ressources ou d'attrait stratégique.
Les réseaux européens, en revanche, sont robustes et bien ramifiés ; ils ne sont pas sous une menace existentielle. Si quoi que ce soit, ce sont les entreprises occidentales qui ont contribué à produire des disparités mondiales en matière de connectivité. Même si la Russie et la Chine s'engagent dans le sabotage — comme d'autres l'ont fait—l'Europe est peu susceptible de faire face à de grandes perturbations. Il est révélateur que l'article de The Guardian “L'Europe est-elle attaquée ?” cite uniquement des exemples non européens d'impact sérieux :
“La coupure en 2023 des connexions de câbles entre les îles Matsu et Taïwan dans la mer de Chine orientale … a laissé 14 000 personnes sans accès à Internet pendant plusieurs jours … Dans la mer Rouge, la coupure de quatre câbles a perturbé 25 % du trafic de données entre l'Asie et l'Europe.
Ce déséquilibre entre les réseaux bien protégés du Nord global et l'accès précaire dans le Sud global nous dirige vers une région où ces tensions deviennent particulièrement visibles : la Méditerranée. Aujourd'hui, la mer Méditerranée est positionnée comme une porte numérique entre l'Europe et l'Afrique — un hub stratégique reliant les continents. Mais derrière le langage de l'innovation et de l'intégration régionale se cache une réalité plus complexe. Une grande partie de l'infrastructure permettant cette transformation — des câbles comme BlueMed et des projets comme Medusa—est détenue ou dirigée par des entreprises européennes et occidentales. Même si des pays comme la Libye expriment des ambitions de souveraineté numérique, leur accès aux réseaux mondiaux est médié par des systèmes qu'ils ne contrôlent pas entièrement.
Pour aller de l'avant, nous devons prêter une attention plus étroite à l'histoire des infrastructures sous-marines — non pas pour alimenter la peur, mais pour sensibiliser à la manière dont les réseaux mondiaux ont longtemps reflété et renforcé les déséquilibres de pouvoir. Nous devrions nous concentrer sur les espaces où des acteurs inégaux interagissent le plus directement — des espaces comme la Méditerranée, où le capital mondial, les ambitions nationales et les asymétries historiques convergent de manière frappante. Sous la mer se trouvent non seulement la technologie, mais les traces d'anciens empires, de nouvelles dépendances et la politique de l'avenir.

