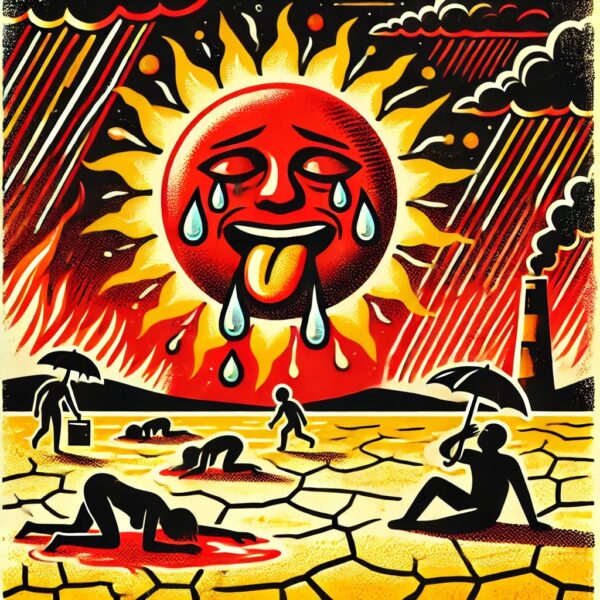Pour le directeur de Green Cross International Nicolas Imbert, l’urgence climatique et écologique est là. Rester passif n’est pas une option. Il l’explique dans un livre programme. La génération émergente est confrontée à l’impasse et devra faire avec les solutions du bord, tout en reconstruisant des cohésions dans un monde désormais sans équilibre. Les pistes de solutions existent, elles sont enthousiasmantes et accessibles. Il n’appartient qu’à nous de nous en emparer. Loin des idéologies, c’est dans l’action qu’elles se situent : mieux manger et consommer autrement, faire de l’énergie chère l’accélérateur de nos transformations, ménager notre manière de vivre les territoires pour être une société apaisée.
Cet ouvrage donne des clés pour agir, fait entrevoir des perspectives, incite à l’action concrète, plus précisément à faire terre ensemble. Après le volet 1, la mise en perspective, la compréhension de la situation, les extraits contenus dans ce volet 2 illustrent des actions à entreprendre.
# 2 Agir face à l’urgence climatique
Agir sur l’eau
L'économie circulaire de l'eau est connue depuis les Égyptiens et les textes liturgiques historiques, qui évoquaient les sept vies de l'eau, l'importance de la réutiliser et la valeur inestimable de la ressource. Désormais, nous avons la possibilité d'outiller cette approche à travers une méthodologie inclusive, qui nous permet par exemple de nous rendre compte de l'efficacité des politiques de gestion de l'eau mises en place au Maroc après une dizaine d'années de taux d'utilisation à 120 %.
L'Espagne et le Portugal s'en inspirent actuellement pour sortir de leur situation alarmante, où leurs taux d'utilisation dépassent les 107 % ou 110 %. En France également, depuis deux ou trois ans sur certains territoires, en particulier dans les Pyrénées-Orientales, nous dépassons les 100 % de manière répétée. C'est donc le bon moment pour un choc de sobriété dans la manière de gérer l'eau au quotidien. Chacun peut à l'échelle de son habitation, de son territoire ou de son mode de vie, mettre en place des pratiques de gestion circulaire et optimisée de la ressource.
Ainsi à Porquerolles, dès la mise en place de ce dispositif de pratiques, nous nous sommes aperçus qu'à l'échelle d'une fondation d'art contemporain qui reçoit 200 personnes par jour, le taux d'utilisation de l'eau en provenance du réseau d'eau potable simplement pour faire fonctionner les toilettes était de 40 %, et qu'il était possible avec la station de traitement actuelle présente sur cette fondation de réutiliser l'eau de sortie de station pour les toilettes, une fois les autorisations accordées. Sur cette même île de Porquerolles, une mobilisation sans précédent des habitants a encouragé l'utilisation sobre de la ressource, tant par les particuliers que par les hébergeurs et les touristes. Ces démarches multiples et suivies ont permis une gestion contenue de la ressource alors même que la fréquentation touristique de l'île s'est fortement accrue.
Pourtant, la réutilisation de l'eau reste encore marginale en France. Les différentes mesures, lois et décrets parus sur le sujet en France en 2023 et en 2024, dans la continuité des 53 mesures annoncées par le président Emmanuel Macron en 2023 et rappelées lors de la mise en place du plan de résilience territoriale des Pyrénées-Orientales en juin 2024 ne sont, pour la plupart, que le rattrapage du retard pris dans la mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur l'eau 2000/60/CE ou, plus récemment, du règlement 2020/741 sur la réutilisation de l'eau, très loin des préconisations du GIEC ou du Haut Conseil pour le climat….
Agir sur l’alimentation
Qui aurait pu prévoir que, alors que l’industrialisation de l’agriculture était portée à son paroxysme au motif de nourrir la planète, le monde risquait à la fois de voir se multiplier pénuries et famines, mais également de souffrir de l’impact global de l’industrie alimentaire sur les écosystèmes ? En France, le secteur agricole est le second secteur émetteur de gaz à effet de serre, avec 19 % des émissions.
Ce ratio est lui-même minimisé, puisque le transport des denrées agricoles et des invendus alimentaires est intégré au secteur des transports et non dans ce chiffre, tout comme leur élimination qui elle est intégrée au secteur des déchets […] Il nous faut concrètement penser et réparer simultanément notre sécurité alimentaire et la performance économique, écologique et sociale des filières agricoles et alimentaires.
Comment le faire ? Il s’agit de commencer par retravailler concrètement la sécurité alimentaire, les deux pieds et les deux mains dans la terre et de ré-enchanter toutes nos assiettes en développant à la fois une sécurité sociale alimentaire, une alimentation saine locale et de saison, accessible à tous et une régénération forcenée de la vitalité naturelle de nos territoires par la reconquête d’espaces agro-écologiques, le ménagement, la renaturation et le re- ensauvagement. Les bénéfices sont complémentaires et diversifiés. Il s’agit de sécuriser un présent et un futur alimentaire serein, mais aussi de permettre des ilots de fraîcheur amortisseurs climatiques, des sols revitalisés, un circuit de l’eau qualitativement et quantitativement régénéré, et une meilleure santé tant humaine que des écosystèmes.
Agir sur l’énergie chère
Nous prenons le pari que cet enchérissement des prix de l’énergie, qui survient bien tardivement face à une urgence climatique et écologique dont les effets au quotidien sont énormes, est le déclencheur qui nous permettra d’évoluer rapidement vers une économie de la sobriété. Pour cela, l’écosystème français a quelques spécificités qu’il convient d’appréhender. Tout d’abord, l’illusion entretenue par le passé d’une électricité électronucléaire abondante et peu chère n’a pas permis de mettre en place les actions de rénovation énergétique nécessaires à l’inverse de ce qui s’est passé chez nos voisins européens.
Ainsi, sur un indicateur européen communément admis, les logements français perdent en hiver en moyenne 2,5 °C sur une période de cinq heures, contre 1 °C en Allemagne ou en Suède, ou 1,5 °C en Italie.
C’est pourquoi la rénovation énergétique est désormais, en France, une urgence absolue, doublée d’une urgence sociale de lutte contre la précarité énergétique […]
Les dispositifs de boucliers énergétiques qui sont à la fois économiquement somptuaires et inefficaces, ne fournissent pas le contexte économique propice aux travaux d’urgence nécessaires. À l’inverse, le dispositif des Energy Services Companies (ou ESCO) mis en place depuis plus de vingt ans chez nos voisins allemands, autrichiens et nordiques, permet de transformer une dépense énergétique constatée, en particulier dans l’habitat, en investissant vers la sobriété.
Le nucléaire ?
Les fluctuations récentes sur les prix ainsi que l’impact des conflits en cours sur la continuité d’approvisionnement ont remis au cœur de nos préoccupations l’importance d’une transformation énergétique d’ampleur basée sur la sobriété des usages et la diversification des sources disponibles.
Le nucléaire est doublement condamné par ses coûts démesurés et une inadaptation au contexte écologique :
« Construire une nouvelle centrale électrique [p. ex. électronucléaire] est complètement absurde », affirme Jeremy Rifkin ; « le prix réel de l’énergie nucléaire sur la durée de vie d’une centrale est de 112 dollars par mégawatt, contre “ 29 à 40 dollars par mégawatt” pour le solaire et l’éolien. Et il y a un autre problème : le manque d’eau, prévient-il ; une part importante de l’eau douce sert à refroidir les réacteurs. Mais avec le changement climatique, l’eau des rivières et des lacs se réchauffe et deviendra inutilisable l’été pour refroidir les centrales.
Cela s’est déjà produit dans le sud de la France. […] Une fois ce lourd héritage décommissionné, le champ des possibles devient libre pour déployer un ensemble de technologies renouvelables qui permettront de produire à des prix très compétitifs.
L’hydrogène ?
La filière est souvent présentée comme celle qui permettra rapidement d’atteindre un horizon zéro carbone, les demandes d’investissement public sont massives et l’engouement d’une partie du monde industriel patent. Dans son rapport 2020, l’Agence Internationale de l’Énergie nous parle d’investissements mondiaux à hauteur de 15 000 milliards de dollars sur la période entre 2020 et 2050, avec une pointe à environ 800 milliards de dollars à l’horizon 2030. En regardant la répartition des investissements, on s’aperçoit que 85 % de ces investissements souhaités sont liés au renforcement de capacités de production d’électricité […]
Dans le même temps, l’Energy Transition Commission, un think tank européen, relève que sur les utilisations possibles, les avantages relatifs de l’hydrogène par rapport aux autres options de décarbonation ne sont pas encore clairs. C’est bien tout le paradoxe de cette incitation à l’économie hydrogène.
D’un côté, l’usage de l’hydrogène, ce vecteur d’énergie gazeux, ne génère que de l’eau et permet de limiter les émissions de dioxyde de carbone au point de consommation. D’un autre côté, les modes de production, de transformation, de stockage et de transport sont aujourd’hui globalement très énergivores […]
L’hydrogène a un potentiel, parmi d’autres technologies, pour être l’une des briques technologiques du transport énergétique de demain, avec des atouts intéressants. Il est par contre essentiel, dans son émergence et son développement, de ne pas reproduire les erreurs d’appréciation et d’action qui ont conduit à la France du Minitel, du Concorde et des centrales nucléaires.
Ménager notre manière de vivre les territoires pour être une société apaisée
Espace d’intégration de nombreux défis urbanistiques, architecturaux, économiques, sociaux et environnementaux, la ville a également révélé, à travers la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, sa grande vulnérabilité. Elle doit se repenser et s’aménager, ou plutôt se ménager, pour répondre aux défis actuels et futurs. […]
Même si 80 % de la planète vit en ville et si ce chiffre est en constante augmentation, deux tendances de fond viennent contrebalancer cette dynamique. Tout d’abord, l’artificialisation des villes a désormais atteint un niveau de saturation qui se manifeste d’abord par les métropoles et les zones périurbaines. Ensuite, la trop grande fragmentation des rôles entre ville, périurbain, banlieue et campagne a développé de grandes vulnérabilités, que l’on voit dans l’alimentation ou dans les phénomènes climatiques extrêmes, mais qui ont aussi généré dans nos sociétés une violence latente […]
Autour des modèles d’évolution des territoires préalablement cités, c’est bien une forme de rapport à la vie et au territoire complètement nouvelle qui est désormais au cœur des démarches de résilience : le ménagement. Empruntée à la fois aux travaux du philosophe Thierry Paquot et à ceux du paysagiste Gilles Clément, cette démarche à hauteur d’humain vise à trouver l’équilibre qui permet à la fois à la ville de s’adapter et de se réinventer, de s’inspirer du vivant, de créer de l’enthousiasme pour des projets concrets et aboutis, de mettre en avant le plaisir de vivre ensemble, de développer de nouvelles solidarités et une robustesse certaine face au dérèglement climatique.
L’urgence climatique et écologique est au cœur de nos vies. C’est maintenant qu’il faut agir, bousculer nos priorités, mettre en place les actions concrètes, à la hauteur des enjeux pour être heureux et sereins, nous projeter dans le futur et contribuer à le rendre désirable et partagé.
La génération émergente est confrontée à l’impasse et devra faire avec les solutions du bord, tout en reconstruisant des cohésions dans un monde désormais sans équilibre.
Les pistes de solutions existent, elles sont enthousiasmantes et accessibles. Il n’appartient qu’à nous de nous en emparer. Loin des idéologies, c’est dans l’action qu’elles se situent : mieux manger et consommer autrement, faire de l’énergie chère l’accélérateur de nos transformations, ménager notre manière de vivre les territoires pour être une société apaisée.
Cet ouvrage donne des clés pour agir, fait entrevoir des perspectives, incite à l’action concrète, plus précisément à faire terre ensemble. C’est autant d’inspirations et de respirations qu’il nous appartient, de transformer en actions et en initiatives.
La suite ? À nous de l’évoquer, de l’écrire et de la vivre ensemble. Il y a une urgence ; faisons en sorte d’être créatifs et solidaires. Et, plus que jamais, à l’écoute du monde et de sa musique.

Extraits du livre « repanser la planète ». Son auteur Nicolas Imbert est un ingénieur français, directeur exécutif de l’ONG Green Cross. Il intervient sur la structuration des propositions de la société civile sur le climat, la santé environnementale, la résilience territoriale et la prévention des conflits environnementaux, en France et à l’international.
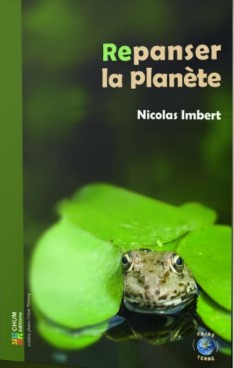
Illustration de Une : À partir de cette conversation, l’IA a généré un flot d’illustration. Stefan Muntaner l’a nourri avec les données éditoriales et a guidé la dimension esthétique. Chaque illustration devient ainsi une œuvre d’art unique à travers un NFT.