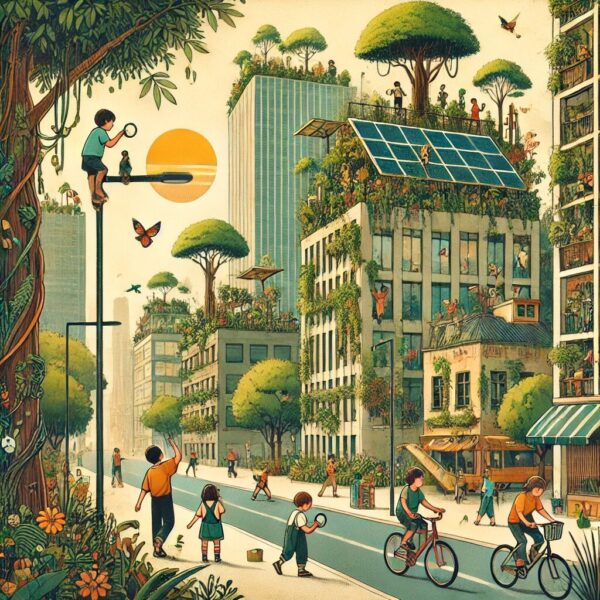À l’heure où les espaces naturels se raréfient en milieu urbain, l’éducation à la biodiversité devient un enjeu essentiel pour reconnecter les citoyens, et en particulier les plus jeunes, au vivant. Des sociologues ont récemment montré que des mots liés à la nature, comme fougère ou corbeau, disparaissent des dictionnaires pour enfants, remplacés par des termes technologiques comme Wi-Fi ou réseaux sociaux (1,2). Cela traduit une déconnexion croissante des jeunes avec leur environnement naturel.
Entretien mené par : Justine Viros – Scientifique spécialiste de la transition environnement, de la forêt méditerranéenne et des interactions chimiques forêt – atmosphère dans le cadre du changement climatique.
Comme le souligne Magali Deschamps Cottin, cette déconnexion croissante a des conséquences directes : comment protéger ce que l’on ne connaît pas ? À Marseille, l’attention s’est longtemps portée sur les espaces naturels périphériques, comme les Calanques ou l’arrière-pays méditerranéen. Mais la ville elle-même recèle une biodiversité insoupçonnée.
Marseille : un exemple méditerranéen de biodiversité urbaine
Jusqu’en 2008, la biodiversité urbaine marseillaise était peu étudiée. Magali Deschamps Cottin et sa doctorante entre 2008 et 2011 (Marie-Hélène Lizée) ont entrepris un recensement des papillons de jour dans les espaces verts urbains, révélant une diversité surprenante, y compris en plein centre-ville. Du Jardin des Vestiges, à proximité du Vieux-Port, au parc Longchamp il est possible d’observer des papillons, preuve que certaines espèces parviennent à survivre malgré l’urbanisation. (3)
Cependant, les études montrent une perte progressive des espèces de papillon méditerranéennes, remplacées par des espèces généralistes mieux adaptées aux transformations du paysage urbain et aux espèces végétales disponibles. Cette évolution souligne l’urgence de repenser l’aménagement des espaces verts afin de maintenir et restaurer la diversité des espèces locales. La préservation d’espaces de friches, ou de jardins au naturel participe à maintenir un écosystème méditerranéen au sein des villes et donc à permettre le développement de la faune associée.
Au-delà du cas spécifique des papillons, l’enjeu est plus vaste : comment adapter nos villes aux défis environnementaux tout en favorisant le lien entre les habitants et la nature ? Magali Deschamps Cottin identifie trois leviers majeurs : 1) végétaliser les espaces urbains en privilégiant des espèces locales et en réduisant l’imperméabilisation des sols, 2) préserver les habitats naturels en laissant des zones de nature spontanée et en limitant l’artificialisation des sols, 3) former et sensibiliser les citoyens et les décideurs pour les impliquer dans la gestion de leur environnement.
Le parc Urbain des Papillons, un espace urbain dédié à la biodiversité, à l’éducation et à la recherche
C’est dans cette optique que le parc Urbain des Papillons a vu le jour dans le 14ᵉ arrondissement de Marseille, à la Bastide Montgolfier. Ce projet, né des recherches en écologie urbaine menées par le Laboratoire Population-Environnement-Développement (LPED), vise à concilier préservation de la biodiversité, éducation et formation (4).
Cet espace unique en son genre ne se limite pas à un simple refuge pour la faune et la flore. Il constitue un véritable terrain d’étude pour les chercheurs, les étudiants et les professionnels de la gestion des espaces verts. Actuellement fermé au public (à l’exception d’évènements ponctuels), il accueille un lieu de formation pour différents publics dont les agents municipaux, dans l’objectif de diffuser des pratiques de gestion favorisant la biodiversité en ville. Après ses douze premières années d’existence, la présence du parc avait déjà fait ses preuves. En effet, l’équipe de Magali Deschamps Cottin a pu observer l’augmentation des espèces de papillons fréquentant le site, passant de 17 espèces en 2010 à 34 espèces en 2020. (5)
Un modèle reproductible pour d’autres villes
L’ambition du projet ne s’arrête pas à Marseille. Grâce à l’Association du Parc Urbain des Papillons, l’initiative se structure autour d’une charte garantissant le respect d’une dynamique scientifique et pédagogique. Des projets similaires sont déjà en cours à Bordeaux et pourraient bientôt voir le jour à Angers ou Lille.
Les parcs urbains ne sont pas seulement des refuges pour la biodiversité, ils constituent aussi des outils de sensibilisation et des leviers pour la transition écologique. « Nous souhaitons organiser des formations à destination des élus afin de mieux intégrer la biodiversité dans la planification urbaine », explique Magali Deschamps Cottin. Car si les urbanistes et paysagistes sont aujourd’hui plus sensibilisés aux enjeux écologiques, l’implication des décideurs politiques reste essentielle pour faire évoluer les pratiques.
Cette démarche met en lumière un principe essentiel : intégrer la biodiversité en ville ne doit pas se limiter à planter quelques arbres ou installer des nichoirs. Il s’agit avant tout de créer des espaces où citoyens, chercheurs et gestionnaires peuvent collaborer pour comprendre et protéger le vivant.
En effet, face aux réticences de certaines collectivités à végétaliser l’espace public – par crainte des insectes ou par manque de connaissances –, l’éducation joue un rôle clé. Comme le rappelle la chercheuse, « apprendre dès le plus jeune âge à connaitre la nature et son fonctionnement permettrait de la respecter, de mieux la conserver et d’éviter bien des problèmes ».
Contrairement à l’approche qui met en avant des espèces emblématiques, Magali Deschamps Cottin insiste sur l’importance de la biodiversité dite « ordinaire », celle qui compose notre quotidien. Sensibiliser les citadins à la richesse écologique de leur environnement immédiat est un enjeu clé.
Par exemple, le pacha à deux queues, un papillon méditerranéen dépendant de l’arbousier pour le développement de sa chenille, a été choisi comme espèce méditerranéenne emblématique du parc Urbain des Papillons, pour illustrer l’importance de la végétation pour tous les stades de développement en ville. En effet, si l’on aborde souvent la relation de l’adulte avec les plantes nectarifères, on n’aborde que très rarement le rôle des plantes-hôtes et de leur importance pour les stades chenilles qui conditionnent la présence effective et le développement in situ des espèces. Sans arbousier, pas de reproduction de Pacha !
Observer un tel papillon en ville permet de créer un lien tangible entre les habitants et leur environnement naturel, et ainsi favoriser une prise de conscience.
Les initiatives comme le parc Urbain des Papillons montrent que la biodiversité en ville ne doit pas être perçue comme un obstacle, mais bien comme une opportunité. Souvent cela passe par le besoin de repenser les villes : une ville plus verte avec des palettes végétales diversifiées, plus résiliente et plus pédagogique est possible, à condition d’y intégrer pleinement le vivant. (6)
Biographies

Magali Deschamps Cottin – Enseignante chercheuse au LPED (Laboratoire Populations, Environnement, Développement). Écologue, entomologiste de formation, spécialisée en écologie urbaine, elle s’intéresse à la dynamique des communautés animales dans les écosystèmes anthropisés par l’étude des mécanismes de leur maintien ou de leur colonisation en relation avec les modes de gestion et de naturalité de ces espaces. Ses recherches sont majoritairement conduites en interdisciplinarité avec des sociologues, géographe et urbanistes en collaboration avec des gestionnaires d’espaces urbanisés.Elle a été à l’initiative de la création du projet du Parc Urbain des Papillons.

Justine Viros – Scientifique spécialiste de la transition environnement, de la forêt méditerranéenne et des interactions chimiques forêt – atmosphère dans le cadre du changement climatique. Elle occupe actuellement un poste d’ingénieure de Recherche au sein de la mission Interdiscipinarité(s) d’Aix-Marseille Université où elle est chargée de mission développement pour l’association Neede Méditerranée. Elle a notamment participé à l’écriture de la candidature d’Aix-Marseille Université en partenariat avec Neede à la création d’une chaire UNESCO intitulée « Education à la transition environnementale en méditerranée ».
Sources
(1)Luthin, Margaret C., "Loss for Words: An Investigation of the English Nature Vocabulary" (2020). Undergraduate Theses, Professional Papers, and Capstone Artifacts. 294.
https://scholarworks.umt.edu/utpp/29
(2) Craps, S. (2024). Lost Words and Lost Worlds: Combatting Environmental Generational Amnesia. Memory Studies Review, 1(1), 36-55. https://doi.org/10.1163/29498902-20240001
(3) Marie-Helene Lizee, Rémy Bonardo, Jean-François Mauffrey, Thierry Tatoni, Magali Deschamps-Cottin. Relative importance of habitat and landscape scales on butterfly communities of urbanizing areas. Comptes Rendus Biologies, 2011. ⟨hal-02109128⟩
(4) Deschamps-Cottin, M., Vila, B., & Robles, C. (2019). Le parc urbain des papillons: un dispositif collaboratif de recherche, formation et diffusion des connaissances sur la biodiversité urbaine. Éducation relative à l'environnement. Regards-Recherches-Réflexions, 15(1).
(5) Deschamps-Cottin M, Jacek G, Seguinel L, Le Champion C, Robles C, Ternisien M, Duque C, Vila B. A 12-Year Experimental Design to Test the Recovery of Butterfly Biodiversity in an Urban Ecosystem: Lessons from the Parc Urbain des Papillons. Insects. 2023; 14(10):780. https://doi.org/10.3390/insects14100780
(6) Urban, M.C., Alberti, M., De Meester, L. et al. Interactions between climate change and urbanization will shape the future of biodiversity. Nat. Clim. Chang. 14, 436–447 (2024). https://doi.org/10.1038/s41558-024-01996-2