Un style de vie, comment l’apprivoiser ? Comment le caractériser sans jamais l’enfermer, l’encercler dans des catégories, des valeurs ou des clichés qui le figent ? Ce serait lui faire perdre sa raison d’être, justement, qui est d’être dans la vie, dans une façon de consentir au devenir. Comme dirait Montaigne : « Je ne peins pas l’être, je peins le passage »
Se mettre en quête d’un ou des styles de vie, à la méditerranéenne n’est pas une façon de renouer avec les références anciennes de l’anthropologie méditerranéenne : l’honneur, la sieste, le mariage au plus près, le machisme, la virilité…Les études méditerranéennes[1] ont fait leur chemin depuis et ont su dépasser ces notions ou catégories placées hors du temps et de l’histoire. Ce sont des trajectoires de vie qui font sens aujourd’hui, elles échappent aux formes du savoir figées qui tentent de les caractériser, une fois pour toutes.
Il s’agit ici d’une invitation à suivre une pensée traversière, en mouvement, d’une quête d’un ou des styles de vie, à la méditerranéenne. Une pensée contextuelle se jouant des interactions de l’histoire et d’autres styles de vie, en concurrence, qui s’affirment et parfois s’affrontent. Au temps du cosmopolitisme ottoman, par exemple, à Istanbul/Constantinopoli, on opposait volontiers un style à la franca d’un style à la turca, avec toutes les gradations imaginables entre les deux.
L’invention du quotidien
Partons à la recherche de « L’invention du quotidien[2] ». Il y a par là une source toujours vive pour interroger un style de vie, dans sa généralité, et un style de vie, à la méditerranéenne, en particulier. Les façons de manger nous en donnent une magistrale expression. C’est notamment le cas à travers la diffusion, largement mondialisée, d’un régime méditerranéen dont les effets bénéfiques sur la santé, contre l’obésité notamment, sont désormais devenus explicites. Mais au-delà de ce régime méditerranéen, qui n’est qu’un label à l’échelle internationale, il est des gestes qui se rencontrent et se retrouvent pour inventer une cuisine, à la méditerranéenne, au plus près de ce qui se produit, dans une forme de circuit court, d’agriculture biologique, naturelle, de recours à la terre, à la nature, qui n’est pas un retour à la terre, inscrit dans une identité unique, mais au contraire une façon de conjuguer un sol et un monde, un terroir d’ici et des saveurs venues d’ailleurs – pour fabriquer des cuisines, à la méditerranéenne, du XXIe siècle. Une traversée des frontières culinaires dont témoignent si bien la calantica ou les panelles, racontées ici par Mayalen Zubilaga.
Un style de vie, à la méditerranéenne, du XXIe siècle s’inscrit dans le contexte historique qui est le nôtre, celui d’un changement profond d’ère, sur le plan climatique, dont l’homme est à la fois acteur et pleinement responsable : l’anthropocène. Ce style de vie, à la méditerranéenne, n’est pas un simple phénomène de mode, éphémère ou même jetable. Il se distingue en cela de ce que l’on nomme un lifestyle, dont on change aussi aisément que de T-shirt. Un style de vie répond en effet à une forme d’ancrage, de régularité, de valeurs profondes qui se retrouvent, même si elles ne sont jamais figées, hors du temps et de l’histoire.
Une guerre des styles
Ainsi lorsque George Bush déclarait, lors de la Conférence de Rio, en 1992, sur le développement durable : « American way of life is not negotiable », il mettait en avant un ancrage culturel et une priorité stratégique américaine. Un way of life, un style de vie que les responsables politiques américains, de George Bush hier à Donald Trump plus encore aujourd’hui, sont prêts à défendre bec et ongles au nom de leurs valeurs, quel que soit l’impact que cela peut avoir sur le réchauffement climatique et sur le devenir de notre planète. Il est ainsi une profonde résonance politique liée à la question du choix, du respect ou de la défense d’un style de vie.
Une guerre des styles est à l’œuvre à notre époque, et il serait judicieux de ne pas sous-estimer l’ampleur de tels débats, de tels combats. Cela touche aussi bien au champ symbolique, à l’univers des valeurs qu’au plan économique, à la défense d’un modèle de consommation et de production à l’échelle internationale. Guerre des styles notamment entre un American way of life, un Chinese way of life ou un Islamic way of life, pour reprendre des logiques d’empire ou des formes trans-nationales qui ont un impact à l’échelle globale.

Comment caractériser ce style de vie à la méditerranéenne ?
Un mediterranean way of life, un style de vie, à la méditerranéenne, lui-même pluriel et composite, est sans doute une alternative au monde tel qu’il va, un chemin de traverse qui n’obéit pas à une logique politique d’empire, même s’il s’affirme et se déploie en concurrence voire en opposition avec d’autres styles de vie. Ne l’oublions pas, le style est bien la « marque de l’humain sur toute chose », comme dirait Paul Valéry…
Comment caractériser ce style de vie à la méditerranéenne ? Il commence par se mettre en récits. La Méditerranée n’existe en effet que pour autant qu’elle se raconte. Notre imaginaire méditerranéen est en effet composé de toutes ces histoires qui nous font être ce que nous sommes, depuis L’Iliade et l’Odyssée d’Homère, les Métamorphoses d’Ovide ou les Mille et Une Nuits et jusqu’aux récits, poèmes et romans contemporains qui donnent un visage à la Méditerranée du XXIe siècle.
Ces récits composent l’étoffe de nos songes, mais il est aussi des musiques qui nous font entendre le monde autrement. Elles traversent les frontières et circulent, d’une rive à l’autre, de port en port, cargaisons sonores qui lestent notre écoute d’une matière subtile et plurielle et nous font entrer dans un monde, dans un rythme, fait d’alliages musicaux.
Des récits, des univers sonores, mais aussi des images cinématographiques et des imaginaires plastiques. Tout cela dessine-t-il un style de vie, à la méditerranéenne ? C’est encore en pointillés, il s’agit d’une histoire en devenir, d’une recherche qui ne s’abolit ni ne s’achève en une formule définitive. Elle trouve au moins un visage ou une figure dans ce cercle ouvert sur l’ailleurs que trace la Méditerranée du XXIe siècle.
Une communauté d’images peut par exemple s’instaurer dans le regard des photographes, créant leur propre monde à partir de leurs périples. Il est une matière visuelle à travers laquelle s’incarneun style de vie, à la méditerranéenne. C’est une des façons de lui donner un ou des visages, de s’y retrouver, de lieu en lieu, fragments de paysages sensibles ou d’aventures humaines qui composent un monde et nourrissent un imaginaire visuel à partir de la photographie. Cet imaginaire pourrait être aussi bien cinématographique – tant de gestes d’un style de vie sont en effet inspirés par des séquences de films qui font vivre des « mythologies » et transforment notre rapport au quotidien. À cet égard, l’empreinte du cinéma américain sur nos modes de vie et nos modèles de consommation ne fait guère de doute. A-t-on une idée de ce qui peut naître, à partir du cinéma, ou des cinémas méditerranéens ?
La culture au quotidien, les objets de tous les jours, tables, chaises, lampes, tasses, plats ou théières, robinets ou lanternes, fabriquées par exemple par un designer contemporain comme Zouhair Ben Jannet, raconté ici par Sana Tamzini, donne une idée de ce qui se dessine et peut s’accomplir autour de la Méditerranée.
Explorer un ou des styles de vie, à la méditerranéenne, est une juste et belle façon de montrer que la Méditerranée n’est pas une étoile morte, qu’elle n’est pas condamnée à devenir un nouveau cimetière marin. Elle fabrique, encore et encore, des œuvres, du sens et de la vie.
[1] Voir Le Dictionnaire de la Méditerranée, sous la direction de Dionigi Albera, Maryline Crivello et Mohamed Tozy, Actes-Sud/MMSH, 2016.
[2] Michel de Certeau, L’invention du quotidien, 10/18, 1980.
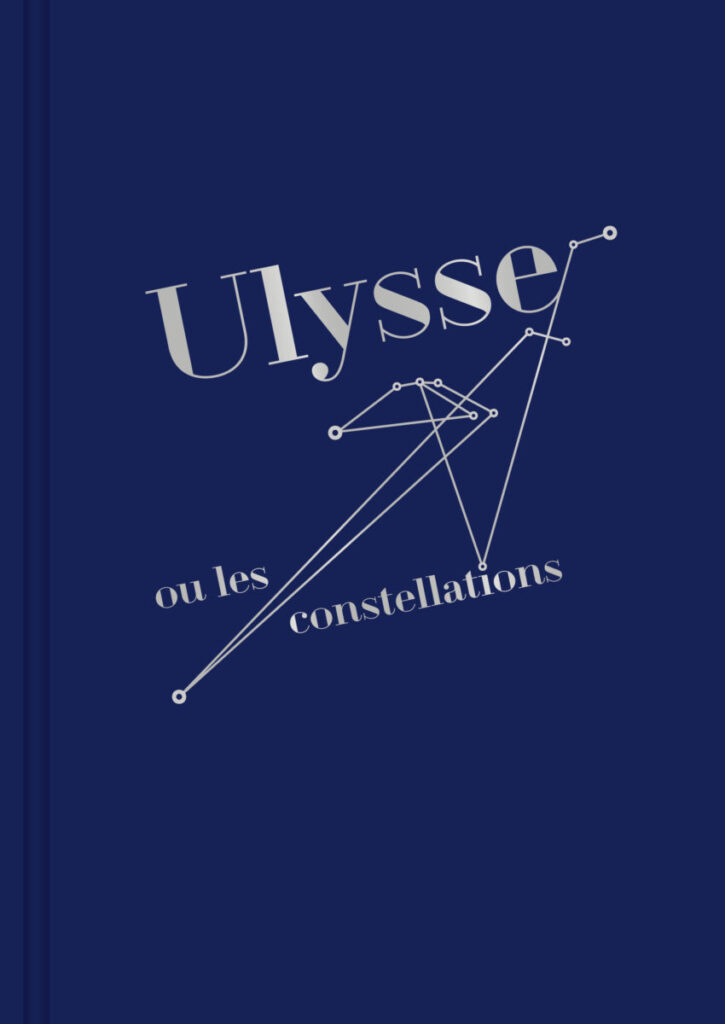
« Ulysse ou les constellations », éditions le Bec en l’air, 2013, Avec l’amicale complicité de Franck Pourcel
Photo de Une © Franck Pourcel
