Qui aime la Méditerranée est invariablement attiré par l’œuvre de Predrag Matvejevitch ! Personnage singulier, de père russe et de mère croate, il était profondément attaché à Mostar, à ce vieux pont qui relie les deux rives d’un monde qui fut le sien. Malheureusement, ce pont a été détruit, lors de la guerre en ex-Yougoslavie, et Predrag fut orphelin de ce « monde ex » qu’il a si justement décrit, en professeur inspiré, en érudit gourmand et en intellectuel engagé contre tous les nationalismes identitaires. L’œuvre de Predrag sur la Méditerranée est une météorite, venue des Balkans, qui raconte un monde devenu le sien, au fil de ses nombreuses pérégrinations dans ce milieu du monde.
Il est des traversées après lesquelles notre regard change et de celles où notre passé lui-même se transforme : elles ouvrent ou concluent les récits de la Méditerranée.
Gardons cet exergue pour notre « Méditerranée en récits »…
Son « Bréviaire méditerranéen » est devenu un de ces livres indispensables qui ne cesse de vous accompagner, au fil du temps. Il se prend et se reprend, se feuillette et se murmure, s’écoute et se raconte en autant de fragments assemblés dont il détient seul le secret.
Voici en effet une œuvre singulière qui est devenue un indispensable, pour découvrir et comprendre le monde méditerranéen, nous inviter à faire un pas de côté, comme dans un de ses autres livres majeurs, « L’Autre Venise », qui a reçu en 2003 le prix Strega, une des plus hautes distinctions littéraires italienne. Il a l’art de nous donner à voir ce qui se dissimule dans l’évidence des choses inaperçues.
Cheminant entre sa Croatie natale, la France, sa patrie littéraire d’adoption, et l’Italie, où il enseignait à l’Université de la Sapienza de Rome, Matvejevitch est un des très rares écrivains qui a su faire naître et faire vivre un trait d’union entre Mittel-Europa et Méditerranée. Passeur d’entre les mondes, amoureux du pain, dont il fit un de ses derniers grands livres, Matvejevitch est bien plus qu’un simple compagnon de voyage, ce fut un ami, un allié, un amoureux du monde sensible en Méditerranée, qu’il a su faire partager comme nul autre avant lui.
Ici commence une œuvre, qui n’a rien d’écrasante, c’est plutôt un Bréviaire qui, plus qu’à une prière, nous invite à entrer dans un véritable jardin des délices !
Le Bréviaire méditerranéen, dont voici un court extrait, à lire et à relire…
On ne saurait expliquer ce qui nous pousse à tenter, encore et toujours, de reconstituer la mosaïque méditerranéenne, de dresser une fois de plus le catalogue de ses composantes, de vérifier le sens de chacune d’elles prise à part ou la valeur des unes par rapport aux autres : l’Europe, le Maghreb et le Levant ; judaïsme, christianisme et islam ; le Talmud, la Bible et le Coran ; Athènes et Rome ; Jérusalem, Alexandrie et Constantinople ; Venise et Gênes ; la dialectique, la démocratie et l’art grecs ; la république, le droit et le forum romains ; la science arabe d’autrefois ; la poésie provençale et catalane de jadis ; la Renaissance en Italie ; l’Espagne à diverses époques, exaltées et cruelles ; les Slaves du Sud sur l’Adriatique, et bien d’autres choses encore. Relevant ou dissociant ainsi les composantes plus fortes ou prédominantes, présentées d’ordinaire dans leurs relations binaires ou ternaires, nous courons le risque de réduire ou de déformer la portée ou le contenu de la Méditerranée. Ici, peuples et races se sont unis et désunis des siècles durant, se rapprochant ou s’affrontant plus intensément peut-être qu’ailleurs : on tombe dans l’exagération en voulant faire ressortir leurs similitudes et leurs réciprocités, au mépris de leurs dissemblances et de leurs conflits. La Méditerranée n’est pas seulement une histoire.
Les particularités méditerranéennes ne s’intègrent pas aisément dans d’autres ensembles, elles n’entrent pas dans toutes les relations qu’entretiennent la mer avec le continent, le sud avec le nord, l’est ou l’ouest avec le sud. Nombreuses sont les contradictions qui marquèrent les civilisations, anciennes et nouvelles, des bords de la Méditerranée : après la Grèce et Rome, Byzance, l’Italie, la France avec la Provence, l’Espagne et la Catalogne, les Arabes du Maghreb au Levant, l’Espagne et la Dalmatie et la Pannonie, la Slovénie du littoral aux Alpes, la Serbie avec le Monténégro, la Macédoine et la Bulgarie, l’Albanie, la Roumanie, la Turquie, et sans doute d’autres encore, avant ou après l’époque gréco-romaine et par rapport à elle, conjointement ou séparément. Les cultures de la Méditerranée ne sont pas uniquement des cultures nationales.
La Méditerranée ne souffre pas les mesures trop étroites. C’est la trahir que de la considérer sous l’aspect de l’eurocentrisme, comme un produit purement latin, romain ou roman de l’observer du point de vue du panhellénisme, du panarabisme ou du sionisme, de la juger d’après tel ou tel particularisme ethnique, religieux ou politique. Souvent, son image fut déformée par des tribuns fanatiques et des exégètes partiaux, des savants sans conviction et des prédicateurs sans foi, des chroniqueurs officiels et des poètes de circonstance. États et Églises, monarques et prélats, législateurs laïques et religieux s’appliquèrent à diviser l’espace et les hommes. Mais les liens intérieurs résistèrent aux partages. La Méditerranée est plus qu’une simple appartenance.
Le discours sur la Méditerranée a pâti de la faconde méditerranéenne : soleil et mer ; senteurs et couleurs ; vents et vagues ; plages de sable et îles de félicité ; jeunes filles vite mûres ; veuves vêtues de noir ; ports, bateaux et invitations au voyage ; navigations, naufrages et récits qui les accompagnent ; orange, myrte et olivier ; palmiers, pins et cyprès ; faste et misère, réalité et chimères ; vie et rêve. Tels sont les motifs auxquels ont puisé à outrance les lieux communs de la littérature : descriptions et redites. La rhétorique méditerranéenne servit la démocratie et la démagogie, la liberté et la tyrannie. Elle s’empara du forum et du temple, de la justice et du prêche. L’arène retentissait au-delà de l’Aréopage. La Méditerranée et son discours sont inséparables.
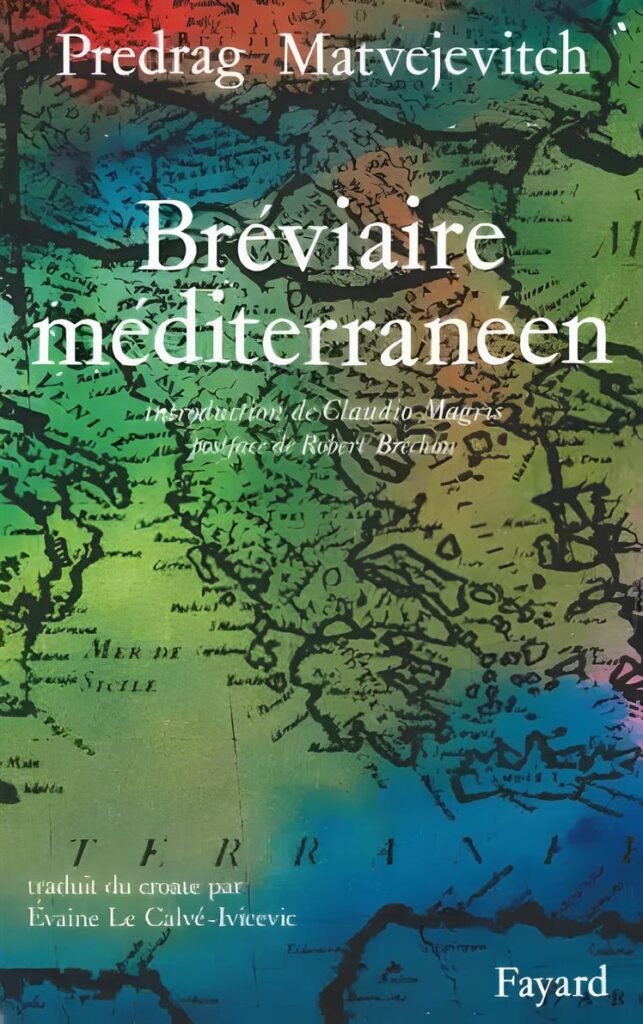
Photo de Une : Le Pont de Mostar ©Hans Hansen - Pixabay
