Sfax, « la capitale du Sud » a connu, depuis les années 1980, un déclin continu dont les causes sont multiples : mondialisation, fuite des élites économiques et culturelles à la Capitale ou à l’étranger, passage à une économie de service… mais une des causes déterminantes est la dégradation de la qualité de vie due à la pollution industrielle -notamment chimique- malgré la mobilisation citoyenne depuis 1980 et surtout après la révolution de 2011.
Sociologue et militant écologique sfaxien, Fethi Rekik analyse ce cas exemplaire avec le recul du scientifique et témoigne de ce combat difficile avec l’engagement du citoyen, dans un dialogue avec Bernard Mossé, historien, responsable Recherche, Éducation Formation de l’association NEEDE Méditerranée.
# 5 Sfax dans le projet de régionalisation
Bernard Mossé : Quelle est l’attitude de l’État face à la situation dans la région ?
Fethi Rekik : Tu sais que maintenant les partis sont de fait inactifs quoiqu’ils existent de droit. Et puis l'expérience de Sfax avec les partis politiques a toujours été une expérience négative.
Mon idée, c'est que le modèle de développement de la Tunisie depuis l'Indépendance a été fondé sur une sorte de privilège accordé à la région côtière, au nord-est, incluant Nabeul et Sousse, et excluant la côte sud à partir de Sousse. C'est ça l'essentiel. Il y a des régions de l'intérieur délaissées comme le Nord-Ouest. C'est pourtant une région très riche en ressources naturelles, favorisée par le climat. Mais ce sont des régions dites « handicapées » par les conditions naturelles et de ce fait, peu mises en valeur.
Et puis il y a le tourisme. Le tourisme, ce n’est pas seulement le tourisme balnéaire qui n’est pas rentable d’après moi. Lorsqu'on dit que le tourisme a rapporté cette année 6 milliards de dinars, ce n’est beaucoup par rapport à l'investissement public. C'est à peu près autant que les recettes des Tunisiens résidents à l'étranger ! Il y aujourd’hui une seconde Chambre. L’idée n’est pas nouvelle, mais elle vient d’être relancée et mise en œuvre par le Président de la République qui consiste à créer cette seconde Chambre parallèle au parlement : le Conseil national des Gouvernorats et des Régions qui est composé, chaque région inclut 4 ou 5 gouvernorats.
Sfax fait partie de la quatrième région incluant le gouvernorat aussi le gouvernorat de Gafsa qui héberge le bassin minier de phosphate, ceux de Sidi Bouzid et Tozeur connues pour leur vocation agricole (maraichage et arboriculture). L’idée est intéressante même si on ne voit pas bien le rapport entre ces différents gouvernorats.
La question la plus importante serait : les régions auraient-elles une marge d’autonomie dans sa propre gouvernance ? Peut-on imaginer par exemple une possibilité de voir une Région initier un projet en partenariat avec un investisseur étranger ? Pour le moment, les prérogatives des Régions ne sont pas encore définies, mais d’après quelques premières informations, il y a un égalitarisme quant à la présidence de la Région. Par exemple, il n'y aura pas de chef-lieu de Région, mais une alternance de la présidence entre les différents gouvernorats tout le long du mandat.
Si vraiment on va aborder des spécificités régionales économiques ou sanitaires, et sonder les opportunités de complémentarité entre les gouvernorats, ça peut-être une bonne chose. C'est une vieille demande, mais qui n'a jamais été concrétisée. Parfois, elle a été seulement formelle. Par exemple, avant la révolution, le gouvernorat de Sfax a été placée, de manière arbitraire, dans la même Région avec ceux de Sousse, Mahdia et Monastir ayant tous en commun la vocation touristique … Mais du coup Sfax a été lésée : étant second pôle économique depuis l’indépendance, le gouvernorat de Sfax s’est vu reléguer au septième rang, selon les critères de développement, faute de qualité de vie et d’attractivité aux investisseurs, comparé à deux autres de la même Région.
Bernard Mossé : ce privilège n’est pas nouveau.
Fethi Rekik : Oui, Monastir était privilégié sous Bourguiba, sa ville natale. Et Sousse est la ville natale de Ben Ali. Le modèle de développement est resté le même et focalisé sur des secteurs à faible valeur ajoutée : la confection et surtout le tourisme balnéaire, concentrés dans les mêmes gouvernorats…
Si on veux être compétitif à l’échelle mondiale, il va falloir enfin regarder du coté des ressources humaines : il y a des milliers de compétences tunisiennes de haut niveau qui sont partis dans les dernières années vers Les États-Unis, l’Europe ou les pays du Golfe, c’est gigantesque pour une population comme celle de Tunisie, dont Sfax l’un des grands pourvoyeurs en ces compétences. Et ce n’est pas seulement en aval de la chaine de formation de ces compétences, depuis quelques années c’est en amont : chaque année, il y a des milliers de bacheliers qui partent de Sfax pour l’Allemagne en vue de poursuivre les études et y travailler. Si ça continue ce sera un gros problème pour Sfax mais aussi pour tout le pays.
Bernard Mossé : D’autres facteurs jouent-ils encore en défaveur de Sfax ?
Fethi Rekik : Oui. Il y a un autre facteur qui affaiblit Sfax. Pour être un compétitif, pour être un pôle de développement, il faut un réseau routier qui relie la ville à d’autres régions. Il y a bien sûr l’autoroute qui va de Tunis à Gabès en passant par le Cap Bon, Sousse et Sfax. Le développement du pays a besoin aussi de voies transversales reliant les principales villes du littoral avec celles de l’Ouest, mais pas seulement à la Capitale.
Mais il n’y a pas d’autoroute de Sfax vers le sud-ouest, ou d’autoroute allant jusqu’à la Libye, à l’Ouest vers l’Algérie. A Sfax, les gens et pas seulement les hommes d’affaires se plaignent de l’inactivité ou le peu d’activité de l’aéroport et accusent la compagnie nationale de partialité : il n’y a presque plus de trafic, à part quelques vols pour la Libye et un autre assuré par une compagnie étrangère. Ce n’est pas conséquent pour un gouvernorat de cette importance, son isolement est maintenu par ce modèle de développement « macro-céphalique » !
Bernard Mossé : On connaît un peu cela en France : le réseau autoroutier français a longtemps été centralisé lui aussi.
Fethi Rekik : Oui, mais à ce point, tu risques de gonfler la capitale, de la congestionner : on ne peut pas tous vivre à Tunis…
Cela suscite un sentiment de marginalisation d’une bonne partie de l’intérieur du pays. Ce sont ces régions là qui ont voté pour le président Said : il est le représentant des gens de l’intérieur : on emploie le mot de El Jihet ceux qui ne sont pas du Centre, au sens géographique et économique…
Bernard Mossé: En France, on emploie encore quelquefois le terme de l’Ancien Régime, les « Provinciaux », pour désigner ceux qui ne sont pas de Paris…
Fethi Rekik : Je te raconte une anecdote à ce sujet. J’ai été invité il y a 1 an par le Ministère de l’Intérieur pour un colloque dans un bel hôtel à Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis. On m’explique que tout va bien, que les universitaires « de l’intérieur » seront pris en charge…
Je lui ai dit : c’est nous les universitaires de l’intérieur ? Vous êtes, vous, à Tunis les universitaires de l’extérieur ?
Il s’est excusé, mais c’est symptomatique des représentations, des Tunisois en particulier.
Bernard Mossé : Y a -t-il eu depuis 2011 un mouvement de révolte ou l’expression d’une frustration de cette Tunisie des régions de l’intérieur ?
Fethi Rekik : C’est à peu près ce qui s’est passé en 2019. Il y a eu un sentiment de révolte des régions délaissées par le pouvoir, contre les Islamistes ; Mais pas seulement contre eux, contre le parti moderniste de Nidaa Tounes aussi. En fait, c’est un sentiment de révolte contre le modèle de développement, et finalement un sentiment de révolte contre la démocratie elle -même : « on vous élit pour faire avancer les choses, mais finalement rien n’est fait, la croissance reste proche de zéro. Donc ça ne sert à rien… A quoi sert la démocratie si c’est juste pour faire alterner les partis au pouvoir… ».
C’est l’explication de la victoire de Said élu par les gens à l’extérieur du système, les marginalisés.
Le paradoxe de Sfax c’est qu’il est considéré comme un gouvernorat du système parce qu’il aurait les moyens en propre de se développer. Mais il n’a jamais été ami du système et se considère lui-même hors système. C’est le drame d’être considéré dans le système et de ne pas y être.
Bernard Mossé : C’est peut-être dû à un décalage entre une perception ancienne qui perdure d’une ville prospère et dynamique alors qu’elle est en déclin ? Un décalage entre l’image passée et la réalité présente ?
Fethi Rekik : Oui, il y a toujours dans le langage courant l’expression « Capitale du Sud », alors que c’est une ville livrée à elle-même depuis une vingtaine d’années : l’idée d’une métropole est chimérique.
Je te donne un dernier exemple concret de cette absence de perspective pour le pays dont Sfax est victime.
Quand j’ai présenté la crise de la collecte des déchets à Sfax il y a deux ans, je voulais montrer une crise qui n’est pas seulement locale, mais qui illustre parfaitement cette crise générale de vision.
On va donc créer une nouvelle décharge. Mais pourquoi ne pas passer à un autre modèle, plus radical et digne d’une grande ville ? Pourquoi ne pas penser à créer une entreprise de transformation, de traitement des déchets, qui pourrait être un modèle exportable pour d’autres villes de Tunisie et même pour d’autres pays ?
Alors qu’à Sfax, ils seraient prêts à aller de l’avant, le pouvoir central refuse un tel projet ambitieux dont il ne voit pas pourquoi il profiterait à Sfax plutôt qu’à une autre ville. Alors on reste dans le provisoire et l’immobilisme.
C’est sans doute le manque d’argent, et il y a sûrement d’autres priorités : la crise ne date pas d’aujourd’hui et depuis la révolution de 2011, les salaires augmentent sans reprise de la croissance. Mais surtout, il n’y a pas de vision générale capable de porter de grands projets comme celui-ci qui allierait développement économique et environnement.
En fait, pour résumer, la ville de Sfax fait face à des défis majeurs liés à la pollution industrielle, au manque d’investissements, et à une gouvernance centralisée peu favorable à son développement. La société civile tente de pallier ces carences, mais des changements structurels et une ouverture au capital étranger sont nécessaires pour transformer la région en un pôle économique durable.
Biographies
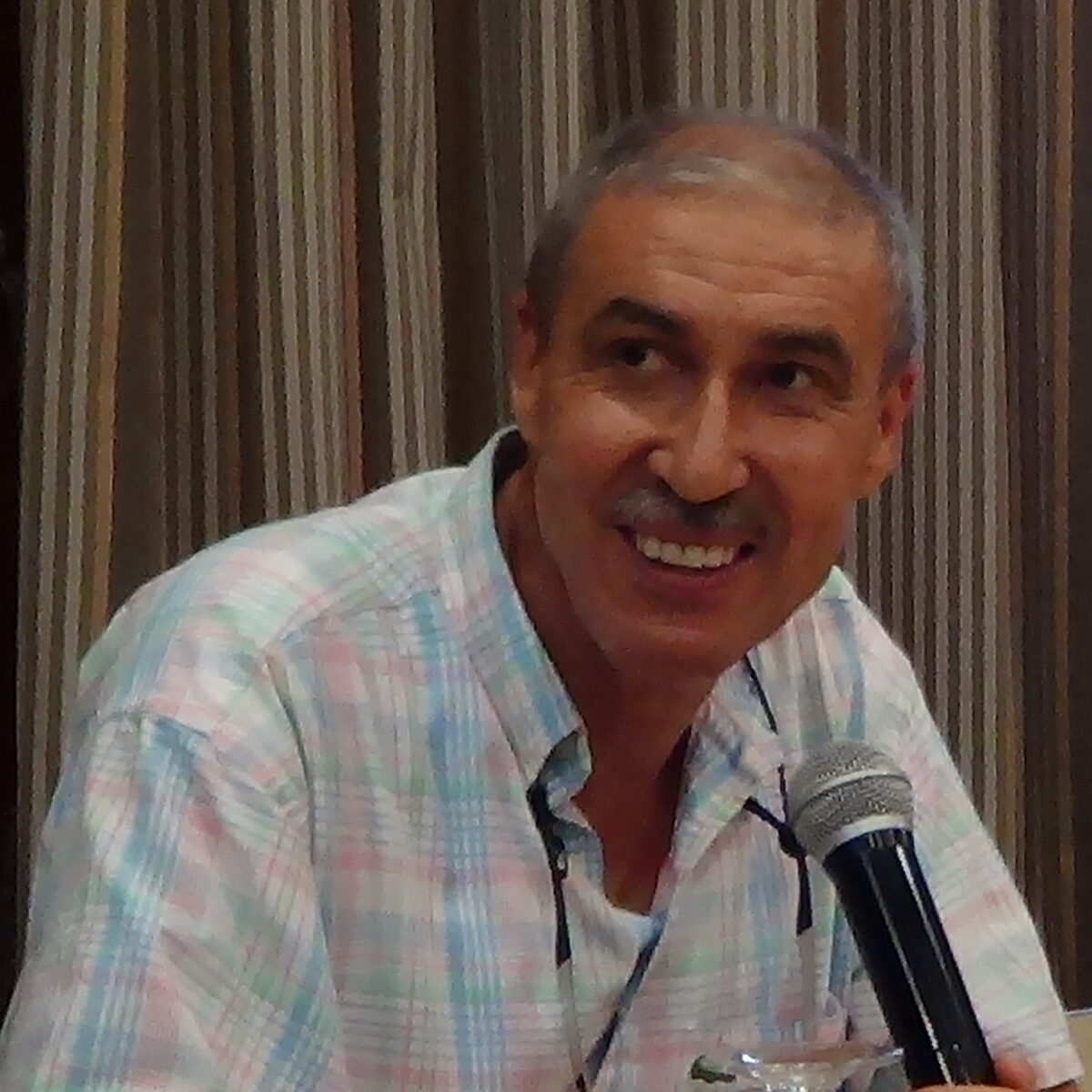
Fethi Rekik est professeur (HDR) de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et directeur du laboratoire de recherche ‘Etat, Culture et Mutations de Société’ à la faculté des Lettres et Sciences humaines de Sfax, Tunisie. Il est également militant écologique dans sa ville de Sfax depuis les années 2000.

Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).
Bibliographie :
Salem DAHECH et Fethi REKIK, « Trafic routier et pollution sonore à Sfax (Tunisie méridionale) : étude pluridisciplinaire ». Revue Pollution Atmosphérique, n°3, 2012.
Amor BELHEDI, « Les disparités régionales en Tunisie. Défis et enjeux », pp.7-62 in Les Conférences de Beit al-Hikma, 2019, 2017-2018, 194p + 112p en arabe. Coll. Conférences, n° V.
Ali BENNASR, « Sfax : de la ville régionale au projet de métropole ». Centre de publication universitaire. Mondialisation et changement urbain, pp.79-95, 2010.
Fethi REKIK, « Environnement et Développement durable entre le global et le local, cas des îles Kneïss », Revue CERES, n° 132, 2006
Taoufik MEGHDICHE, « les rapports de Sfax avec le Sud Tunisien : quelques éléments de réflexion », Revue de Recherches universitaires, n°8, 2010, pp. 41-61.

À partir de cette conversation, l’IA a généré un flot d’illustration. Stefan Muntaner l’a nourri avec les données éditoriales et a guidé la dimension esthétique. Chaque illustration devient ainsi une œuvre d’art unique à travers un NFT.
