Sfax, « la capitale du Sud » a connu, depuis les années 1980, un déclin continu dont les causes sont multiples : mondialisation, fuite des élites économiques et culturelles à la Capitale ou à l’étranger, passage à une économie de service… mais une des causes déterminantes est la dégradation de la qualité de vie due à la pollution industrielle -notamment chimique- malgré la mobilisation citoyenne depuis 1980 et surtout après la révolution de 2011.
Sociologue et militant écologique sfaxien, Fethi Rekik analyse ce cas exemplaire avec le recul du scientifique et témoigne de ce combat difficile avec l’engagement du citoyen, dans un dialogue avec Bernard Mossé, historien, responsable Recherche, Éducation Formation de l’association NEEDE Méditerranée.
# 4 La reconquête de l’espace industriel
Bernard Mossé : quels sont les obstacles à ce projet de reconversion du site pollué par le groupe industriel chimique de la SIAPE à Sfax ?
Fethi Rekik : Il coûte cher ! D'où l'idée de l'investissement privé, pas seulement national, mais ouvert aux investisseurs étrangers.
Il va falloir de toute façon s'ouvrir. Cela va dans le sens même de la stratégie qui a été arrêtée par la municipalité : transformer Sfax en métropole ouverte sur le monde. D'autant plus que l'État n'a pas d'argent pour ça. D'ailleurs, il y a une dizaine de projets qui n'ont jamais été réalisés : cela fait 20 ou 25 ans que l’on parle de cité sportive, on a parlé d’un stade, d'un grand stade. À chaque fois, ça a été ratifié par le ministère…, mais rien ne se réalise. Il y a le projet de métro. Il y a le projet Taparura aussi d’aménagement du bord de mer…
Pourquoi ne pas penser à des investisseurs étrangers pour financer ce genre de projets? Et cela génèrera de l'activité. Donc c'est ça l'idée : transformer le site de la SIAPE en une économie propre. D'autant plus que nous avons déjà l'une des deux grandes universités du pays.
Bernard Mossé : Ce qui peut freiner, c’est la gestion technique et budgétaire de la dépollution du site.
Fethi Rekik : Non. Comment ont-ils fait pour créer les projets du Lac 1 et 2 à Tunis ? C’était un capital saoudien et d’autres pays aussi ! Pourquoi ne pas le faire à Sfax? Ils ont vendu au minimum le mètre carré. Alors pourquoi ne pas le faire ici ? Donc, c'est toujours ce genre de comparaison. Pourquoi acceptent-ils de le faire pour la capitale et le refusent-ils à Sfax ? C'est ça l'idée. Il faut peut-être diviser par trois par rapport au projet tunisois, ce n’est pas considérable pour un projet de cette dimension, avec un crédit mis en place dans le cadre d'une coopération internationale.
Bernard Mossé : Oui, mais les investisseurs sont sans doute freinés par le fait que ce soit un site pollué.
Fethi Rekik : Oui, d'abord, il faut le dépolluer. Bien sûr. On a les techniques pour ça. Le problème n'est pas technique. C'est d'abord un problème de gouvernance et de volonté politique.
Bernard Mossé : Tu as expliqué que la société civile s’était emparée du sujet. S’est-elle restructurée autour de cette question ?
Fethi Rekik : Après 2011, ce n'est plus l’APNES le premier acteur, comme je te l’ai dit. Même si ses membres sont toujours actifs, il y a plein d'associations de jeunes par exemple qui ont pris le relais comme l'association « Sfax la Belle » qui organise régulièrement des séminaires. Une autre association aussi est très active : «Fermons la SIAPE ». Elle est composée d’associatifs, mais aussi d’universitaires et même d’entreprises comme « La Maison de l’expertise », avec un responsable qui a contribué à la redynamisation du mouvement.
Et puis, récemment, on assiste à la reconquête de l'un des endroits emblématiques des Sfaxiens des années 1960 : la place du Casino. À l'époque coloniale, dans les années 1950, Il y avait un casino, un club de natation… les plus de 60 ans s’en souviennent. Et ils l’ont reconquise. J'ai participé personnellement à cette reconquête avec l’association « Casino » dont l’un des chefs est un collègue de l’université. Le problème, c'est que cet espace s’étend sur quelques centaines de mètres en bord de mer. Au sud, il y a le port commercial : c'est une limite qu’on peut accepter. Mais de l'autre côté, il y a une autre limite imposée apparemment par le gouvernement : on a donné l'autorisation à une entreprise de s'installer là et du coup, on a limité l'étendue de la plage à quelque 600 ou 700 mètres. Et l'entreprise est à présent installée.
Bernard Mossé : quelle est cette entreprise ? Est-elle polluante elle aussi ?
Fethi Rekik : Abstraction faite de la pollution, la question c’est pourquoi l’installer là, en plein centre-ville, à l’endroit où les citadins demande une réhabilitation du lieu, un endroit emblématique de la ville. C'est ça la question.
Donc la société civile demande l'extension de la plage et le droit des Sfaxiens à une plage puisque le reste du littoral est pollué. Et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement a accordé une telle autorisation sur ce lieu… ! Mais l’association est active et efficace : il y a des restaurants, des chaises pour s’assoir au bord de la mer… Et les gens fréquentent cette plage. C’est en quelque sorte une reconquête de cet espace par la société civile.
Biographies
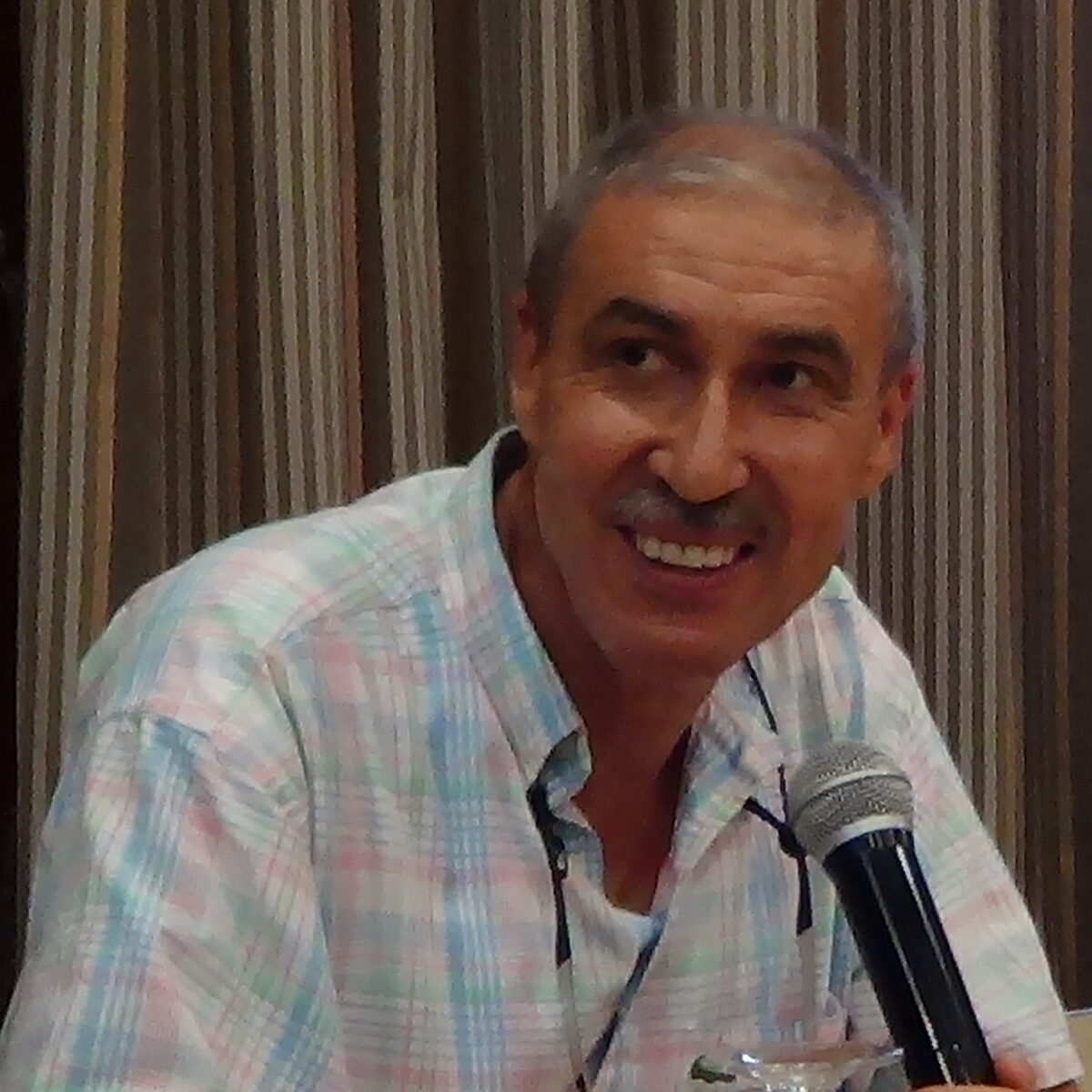
Fethi Rekik est professeur (HDR) de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et directeur du laboratoire de recherche ‘Etat, Culture et Mutations de Société’ à la faculté des Lettres et Sciences humaines de Sfax, Tunisie. Il est également militant écologique dans sa ville de Sfax depuis les années 2000.

Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).
Bibliographie :
Salem DAHECH et Fethi REKIK, « Trafic routier et pollution sonore à Sfax (Tunisie méridionale) : étude pluridisciplinaire ». Revue Pollution Atmosphérique, n°3, 2012.
Amor BELHEDI, « Les disparités régionales en Tunisie. Défis et enjeux », pp.7-62 in Les Conférences de Beit al-Hikma, 2019, 2017-2018, 194p + 112p en arabe. Coll. Conférences, n° V.
Ali BENNASR, « Sfax : de la ville régionale au projet de métropole ». Centre de publication universitaire. Mondialisation et changement urbain, pp.79-95, 2010.
Fethi REKIK, « Environnement et Développement durable entre le global et le local, cas des îles Kneïss », Revue CERES, n° 132, 2006
Taoufik MEGHDICHE, « les rapports de Sfax avec le Sud Tunisien : quelques éléments de réflexion », Revue de Recherches universitaires, n°8, 2010, pp. 41-61.

À partir de cette conversation, l’IA a généré un flot d’illustration. Stefan Muntaner l’a nourri avec les données éditoriales et a guidé la dimension esthétique. Chaque illustration devient ainsi une œuvre d’art unique à travers un NFT.
