La Méditerranée est un espace représentatif des migrations dans le monde. Ce sujet, médiatisé et politisé, est l’objet de simplification et de lieux communs au moment même où, depuis une trentaine d’années, il se complexifie et se diversifie.
Il est au cœur de ce dialogue entre Bernard Mossé, responsable scientifique de NEEDE Méditerranée, et Andrea Calabretta, sociologue spécialiste des migrations dans le monde, en Méditerranée et en Italie en particulier. De quoi mieux comprendre cette problématique pointue.
À suivre sur cinq semaines.
# 4 En Italie, depuis les années 2010, le contexte géopolitique et économique exacerbe la concurrence entre groupes arrivants et groupes installés.
Bernard Mossé : Si tu veux bien, on termine avec un thème au cœur de tes recherches : la construction de l'identité collective des migrants, le rapport aux populations locales et à leur propre communauté. Peut-être à travers les exemples que tu as étudiés des Tunisiens en Italie ?
Andrea Calabretta : On a parlé des migrants qui sont victimes des catégories qu'on utilise pour les nommer, et aussi des institutions qui politisent et criminalisent leur présence. Mais ces questions-là, intéressent toute la société civile, les associations et l'opinion publique : c’est une clé pour comprendre des dynamiques très typiques dans la construction des groupes, en s’appuyant encore sur les sociologues Sayad et Elias.
Pour commencer, il faut saisir une illusion : la perception du migrant comme individu « temporaire ». D’abord parce que le migrant lui-même ne veut pas trahir ses origines ; ensuite parce que la société d’accueil le considère comme une main-d’œuvre qui répond à un besoin provisoire qui ne nécessite pas l’intégration à la citoyenneté politique. Et même l'État d'origine ne tient pas à le considérer comme perdu pour sa population nationale.
Cette illusion a des conséquences sur la représentation du migrant, comme personne provisoire, marginal, qui ne fait pas partie de la communauté, et sur la représentation de soi : c'est un processus d’exclusion symbolique qui amène à des exclusions sociales.
Il y a un phénomène connu en sciences sociales que Norbert Elias a analysé : quand un nouveau groupe social entame un processus de stabilisation, les groupes dominants cherchent à rétablir les différences, à rétablir une distance. On a ce conflit, on peut dire, entre des groupes qui s’affirment justement comme faisant partie des sociétés européennes, qui aspirent à une vie normale, et des groupes dominants qui cherchent à maintenir leur pouvoir et à refuser l’entrée à ceux considérés comme étrangers. Ces derniers construisent une différence culturelle, ethnique, religieuse pour distancier les migrants et leurs descendants dans les discours publics. J’ai observé ce processus de différenciation avec un groupe de Tunisiens en Italie, à Modène, près de Bologne.
Cette communauté tunisienne est implantée depuis les années 1980. Ces travailleurs tunisiens ont intégré le tissu industriel, ils ont loué, puis acheté des maisons, ils ont ramené leurs femmes et leurs enfants, ils ont des amis italiens, des amis d’autres communautés. Etc.. Ils ont intégré la vie citoyenne, même si, dans une position un peu marginale d’ouvriers et d’étrangers.
En 2011, on a deux nouveaux éléments. Le premier, c'est la crise économique de ces années-là qui va toucher grandement le monde de l'industrie avec une grande vague de chômage. Les personnes immigrées, même si elles sont à Modène depuis des dizaines d'années, sont quand même considérées comme des étrangers et donc les premières à perdre leur travail… L’idée de l’interdépendance, qu'ils sont d'une certaine manière utiles pour la société locale se perd.
Le deuxième événement, ce sont les Printemps arabes. Beaucoup de jeunes Tunisiens fuient la Tunisie et arrivent en Italie sans toujours un projet migratoire très précis : des centaines d’entre eux passent par Modène. Il y a alors toute une médiatisation, une politisation de cette présence. Ces jeunes tunisiens sont considérés comme des criminels. On voit très clairement comment la différence ethnique, le fait d'être tunisien, qui n'était pas un problème en 2008, le devient en 2012. C'est une différence très importante qui a des conséquences concrètes sur la possibilité de trouver un logement, trouver un travail. Et ce n’est pas seulement le cas pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les personnes qui étaient là-bas depuis 30 ans.
C'est sur ça que je voulais conclure : on pense que ces distinctions nationales ou culturelles sont naturelles et évidentes, ce n’est pas le cas. Ce sont des distinctions construites, dans le temps, sur la base de conflits, en fonction des contextes et des différences de pouvoir. Je pense que les relations entre les groupes des sociétés méditerranéennes et les sociétés européennes pourraient être moins tendues, moins violentes, à travers une recomposition globale des alliances sociales. Pendant le COVID, par exemple, on n'avait pas cette grande rhétorique autour de la migration. L'ennemi de notre société était ailleurs. La recomposition sociale générée par les migrations sera un travail lent de modifications des hiérarchies sociales, impliquant aussi la revendication par les descendants de leur place dans les sociétés où ils vivent... Ça va être long et conflictuel, du fait des résistances de groupes installés, mais c’est inéluctable.
Bernard : Je voudrais aborder une question que tu n’as pas évoquée, issue de ton travail, indépendante du contexte géopolitique et économique : le fait que, à l'intérieur d’un même groupe d’immigrés – la sociologue Sylvie Mazzella a observé cela aussi pour les Tunisiens de Marseille -, il existe une distanciation. Sur la base de ce qu’elle a appelé « le voisin-voyou », le Tunisien plus jeune, qui vient d'arriver, et dont il faut se différencier. Un peu sur le thème du lieu commun : le dernier arrivé, ferme la porte.
Andrea : Oui, c'est un phénomène très courant. J'ai remarqué ça à Modène aussi, c'était très évident. De mon point de vue, c'est une dynamique qui est liée à cette question des hiérarchies sociales. Pour les Tunisiens qui avaient intégré la société locale, le fait d'être assimilés aux nouveaux arrivés, c'était négatif. Ils me disaient « On n’a rien en commun ; quand je les vois dans la rue, on change de chemin… ». Il s’agit de se différencier de l’image stéréotypée qui touche les migrants. Mais la chose très intéressante, c’est l'impossibilité de sortir de ces visions culturalistes, ethnicisés, de sortir de cette assimilation avec les nouveaux arrivés. Je me rappelle des entretiens avec de jeunes femmes qui sont nées et ont grandi à Modène, avec l'accent de Modène. C’était vraiment triste parce que, en ville, dans les bars, etc. les interactions se passaient bien jusqu’à ce que l’interlocuteur découvre qu’elles sont d’origine tunisienne…
Oui, les relations à l’intérieur des communautés étrangères sont parfois difficiles et conflictuelles, mais cette stratification interne est due à la tentative des migrants - installés ou nouveaux arrivants - de trouver un espace dans la société locale. Cette société, cependant, utilise parfois ces différences internes pour les tenir à la marge.
Biographies

Andrea CALABRETTA est chercheur postdoc à l’université de Padoue (Italie), où il donne des cours sur les méthodes de recherche qualitative en sociologie. Il a obtenu son doctorat en 2023 avec une thèse sur les relations transnationales entre la communauté tunisienne en Italie et le pays d’origine, basée sur la mobilisation des théories de Pierre Bourdieu. Outre les relations avec le contexte d’origine, il a travaillé sur les processus d’inclusion et d’exclusion sociale qui affectent les migrants et leurs descendants, leurs parcours de travail dans la société italienne et les processus de construction identitaire des migrants.
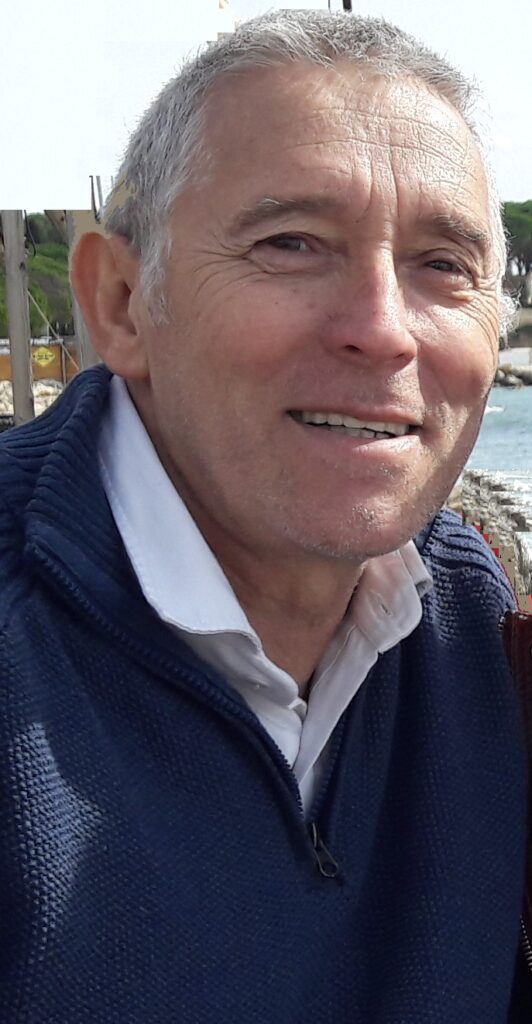
Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).
Bibliographie
Appadurai Arjun (2001), Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris : Payot.
Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc (1992), Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Paris: Seuil.
Calabretta Andrea (2023), Accepter et combattre la stigmatisation. La difficile construction de l’identité sociale de la communauté tunisienne à Modène (Italie), Territoires contemporains, 19. http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Espaces-Territoires/Andrea_Calabretta.html
Calabretta Andrea (2024), Doubles absences, doubles présences. Le capital social comme clé de lecture de la transnationalité, In A. Calabretta (ed.), Mobilités et migrations trans-méditerranéennes. Un dialogue italo-français sur les mouvements dans et au-delà de la Méditerranée (p. 137-150). Padova: Padova University Press. https://www.padovauniversitypress.it/system/files/download-count/attachments/2024-03/9788869383960.pdf
Castles Stephen, De Haas Hein and Miller Mark J. (2005 [dernière edition 2020]), The age of migration. International Population Movements in the Modern World, New York: Guilford Press.
de Haas Hein (2024), “L’idée de grandes vagues de migrations climatiques est très improbable”, article dans ‘L’Express’.
https://www.lexpress.fr/idees-et-debats/hein-de-haas-lidee-de-grandes-vagues-de-migrations-climatiques-est-tres-improbable-K3BQA6QEKRB2JCN4W47VTNCA2Y/
Elias Norbert (1987), The Retreat of Sociologists into the Present, Theory, Culture & Society, 4(2-3), 223-247. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/026327687004002003
Elias Norbert, Scotson John L. (1965 [réédition 1994]), The established and the outsiders. A Sociological Enquiry into Community Problems. London: Sage.
Fukuyama Francis (1989), “The End of History?” The National Interest, 16, 3–18. https://www.jstor.org/stable/24027184
Mezzadra Sandro, Neilson Brett (2013), Border as Method, Durham: Duke University Press. https://academic.oup.com/migration/article-abstract/4/2/273/2413380?login=false
Sayad Abdelmalek (1999a), La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré. Paris: Editions du Seuil.
Sayad Abdelmalek (1999b), Immigration et “pensée d’État”. Actes de la recherche en sciences sociales, 129, 5-14.
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1999_num_129_1_3299 Simmel Georg (1908 [réédition 2019]), L’étranger, Paris

À partir de cette conversation, l’IA a généré un flot d’illustration. Stefan Muntaner l’a nourri avec les données éditoriales et a guidé la dimension esthétique. Chaque illustration devient ainsi une œuvre d’art unique à travers un NFT.
