Le Liban est en proie à une crise multiforme depuis plusieurs années. L’économie s’effondre, le système bancaire est quasi inexistant et la politique, paralysée. Dans ce contexte déstabilisant, la recherche scientifique, déjà fragile, se retrouve au bord du gouffre. Scientifiques et organismes de recherche font front, traquent et parfois trouvent les moyens de poursuivre leurs études et travaux.
Les institutions de recherche libanaises, autrefois piliers du savoir et de l’innovation, sont aujourd’hui menacées. La crise de 2019 a porté un coup sévère à la recherche scientifique. Les budgets alloués ont été réduits, jusqu’à 33 fois en moins et la dévaluation de la livre libanaise n’a rien arrangé (1 500 000 livres équivalaient à 900 euros avant 2019, aujourd’hui c’est moins de 15). Bien qu'une légère reprise ait été observée en 2023-2024, avec des budgets atteignant 50 à 75% de leur niveau antérieur pour les institutions privées, la situation reste critique pour les établissements publics, qui ne reçoivent que 10 à 20% de leurs financements antérieurs.
Cette baisse des ressources a entraîné un exode massif des chercheurs. On estime que 15 à 20% des chercheurs expérimentés ont quitté le pays, tandis que plus de 50% des jeunes ont choisi de poursuivre leur carrière à l'étranger. Cette fuite des cerveaux a créé un vide difficile à combler, d'autant plus que le marché du travail dans la recherche scientifique libanaise était déjà limité avant la crise, avec moins de 20 institutions actives dans ce domaine.
Cela a également eu un impact sur les vocations scientifiques. Les jeunes générations sont de moins en moins nombreuses à envisager une carrière dans la recherche, face à l'instabilité et aux perspectives limitées offertes par ce secteur au Liban. Les postes laissés vacants par les chercheurs partis sont rarement pourvus, et de nombreux laboratoires ont été fermés ou fonctionnent avec des effectifs réduits.
Le CNRSL, moteur de résilience
Malgré les nombreux défis, le Conseil National de la Recherche Scientifique au Liban (CNRS-L) se réinvente comme un pilier de résilience pour la recherche scientifique libanaise. Depuis 2022, sous la direction de Tamara el-Zein, sa nouvelle secrétaire générale, le CNRSL redéfinit sa mission pour s'adapter aux crises actuelles. "La priorité est donc à la gestion de cette crise avec le moins de dégâts possible", explique-t-elle, soulignant que le travail du CNRS-L repose désormais sur trois axes stratégiques : les financements, la valorisation de la recherche existante, et la collaboration avec le secteur privé.
En matière de financement, Tamara el-Zein reconnaît que "des choix difficiles doivent être faits." "On ne peut plus financer toute la recherche", dit-elle. "Nous devons nous montrer sélectifs, car il est impératif de garder un certain rythme dans la recherche. Stagner veut dire régresser." Pour la première fois depuis sa création en 1962, le CNRS-L définit les priorités scientifiques à travers un processus collaboratif impliquant les décideurs des grandes institutions étatiques (ministères, etc.) afin d’évaluer leurs besoins scientifiques actuels et futurs. Grâce à ces consultations, il cherche à financer des projets qui répondent aux défis nationaux et à encourager les décideurs politiques à utiliser son expertise dans la planification et la prise de décision en matière de politiques publiques. C’est à la lumière de ces résultats que le CNRS-L lance le Programme de Subventions de Recherche pour les universités et les centres de recherche pour 2024.
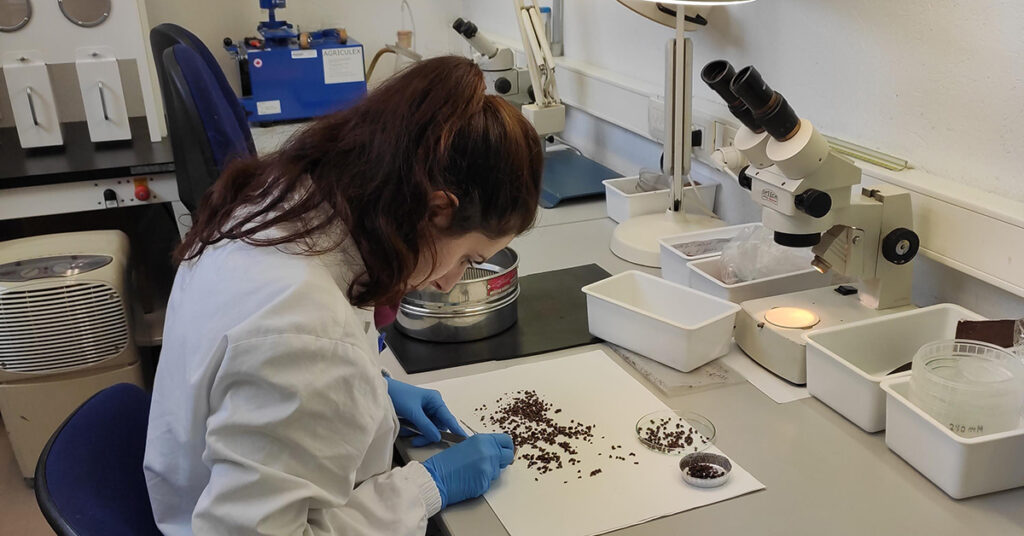
Pour que la recherche soit valorisée, la secrétaire générale souligne l'importance de dépasser l'application industrielle, et "d’étendre la transformation de cette recherche en savoir qui servirait à l’élaboration de politiques publiques", ajoutant que l'interdisciplinarité est cruciale pour relever les défis nationaux. Elle rappelle que "les pays qui ont fondé leurs politiques publiques sur la recherche scientifique sont ceux qui ont le mieux géré les crises."
Enfin, Tamara el-Zein souligne la nécessité de structurer des niches d’excellence et de créer des passerelles entre les secteurs économiques, académiques, et les citoyens. "Ces passerelles sont rares au Liban, et on ne peut que constater les dégâts que cela occasionne dans le pays à tous les niveaux", observe-t-elle. Elle insiste également sur la responsabilité de rendre compte aux citoyens, dont les taxes financent en partie la recherche. "Il faudrait pouvoir leur exposer les fruits de cette recherche," explique-t-elle.
Les universités privées, catalyseurs d'innovation
De leur côté, les universités privées du pays, comme l'Université Saint-Joseph (USJ) et l'Université Libano-Américaine (LAU), montrent une résilience remarquable en maintenant et en développant leur recherche scientifique. Ces institutions, conscientes de leur rôle crucial dans la société libanaise, ont su adapter leurs stratégies pour continuer à former les chercheurs de demain et contribuer activement à la reconstruction du pays.
À l'USJ, la priorité est de créer un environnement propice à la recherche malgré les défis financiers. "Nous avons pu libérer un budget considérable de notre propre budget pour financer les projets de recherche, mais également les bourses de doctorat" explique Richard Maroun, vice-recteur à la recherche. L'université s'appuie sur des financements internationaux, notamment ceux de la Commission européenne, de l'Agence française de développement, et de l'Agence universitaire de la francophonie, pour continuer à équiper ses laboratoires avec des technologies de pointe et offrir un accès aux ressources bibliographiques indispensables pour les enseignants-chercheurs. En parallèle, l'USJ travaille à renforcer l'engagement des étudiants dans les programmes de recherche. Un plan triennal a été présenté pour 2024-2026, visant à soutenir les chercheurs et à indexer les revues de l'université pour une meilleure visibilité internationale.
Les défis économiques ne sont pas les seuls obstacles. Nancy Fayad, professeure adjointe en génomique microbienne à la LAU, a vu sa carrière façonnée par les crises successives. En 2019, les manifestations au Liban l'ont empêchée d'accéder à son laboratoire pour poursuivre sa thèse. En 2020, le confinement en Belgique, dû à la pandémie de COVID-19, a encore une fois bloqué son travail en laboratoire. Pourtant, elle a su rebondir en se concentrant sur la bio-informatique, ce qui lui a permis de publier un article scientifique supplémentaire. "La recherche au Liban souffre d'une double crise : celle internationale du manque de financement de la recherche fondamentale et celle locale économique et financière," observe-t-elle. Pour soutenir ses chercheurs, la LAU a constitué un fonds d'urgence garantissant un minimum d'activité dans ses laboratoires. Une solution qui permet de maintenir les conditions nécessaires pour attirer des financements externes vitaux.
Une communauté scientifique unie et résiliente
Pour surmonter ces difficultés, des initiatives collaboratives émergent soutenues par des associations, des fondations, et des réseaux de chercheurs qui unissent leurs ressources et leurs savoirs. Ces efforts incluent la mise en place de programmes de mentorat, visant à accompagner et à développer les jeunes talents dans cet environnement difficile.
Pour souligner et soutenir les réalisations des chercheurs libanais, le Conseil National de la Recherche Scientifique relance son Prix annuel d'excellence scientifique. Ce prix prestigieux sera décerné dans quatre domaines fondamentaux : les sciences fondamentales et l'ingénierie, les sciences médicales et biologiques et la santé publique, les sciences agricoles et environnementales, et les sciences humaines et sociales. En plus de ces distinctions, un "Prix de la carrière scientifique" sera attribué aux chercheurs chevronnés qui ont apporté des contributions majeures à la recherche.
Ces prix visent non seulement à honorer ces chercheurs, mais aussi à encourager une recherche de qualité, pertinente et orientée vers les besoins du pays. Ces initiatives, combinées à une forte collaboration et à un mentorat structuré, sont essentielles pour assurer la pérennité et le développement de la recherche scientifique au Liban, même en temps de crise.

