La gestion des déchets est un enjeu majeur pour tous les pays, notamment dans le bassin méditerranéen. La scientifique Justine Viros décrypte avec Melissa Kanane, docteure en Protection des écosystèmes, la gestion des déchets en Algérie et notamment en Kabylie .
Cette dernière nous confie le résultat de ses travaux sur le schéma de gestion des déchets en Algérie, les problèmes et solutions associés, et, enfin, leur valorisation. Et plus spécifiquement ici leur impact sur l’environnement.
#1 – la gestion des déchets en Algérie
L’Algérie, avec une population de plus de 44 millions d’habitants et une consommation croissante, voit sa production de déchets en constante augmentation. Cet essor pose des défis environnementaux et sanitaires considérables, nécessitant des stratégies efficaces et durables.
La gestion des déchets a connu une évolution significative au fil des décennies.
Au début du 20ème siècle, la majorité des déchets étaient des déchets organiques, la gestion uniforme des déchets n’était pas mise en place et il était courant pour la population d’avoir recours à une forme de compostage en fond des jardins. Après l’indépendance en 1962, l’Algérie a dû faire face à une urbanisation rapide, à une augmentation de la consommation et à l’arrivée des emballages plastiques en quantité, ce qui a entraîné une production accrue de déchets différents. Selon le rapport de l’AND publié en 2016, la quantité de déchets issue des ménages s’élève à 11 millions de tonnes et chaque individu génère entre 0,7 et 0,9 kg de déchet par jour. La gestion de ces déchets est rapidement devenue un problème majeur qui combine des réglementations [1] et des initiatives.
Plusieurs techniques de gestion des déchets sont utilisées
Actuellement le schéma national de gestion des déchets repose uniquement dans la collecte en mélange (différents types de déchets mélangés) et l’acheminement vers les Centres d’enfouissement technique (CET)[2]. Les CET sont des installations conçues pour l’élimination sécurisée des déchets. Ils doivent respecter des normes strictes, comme avoir un sol argileux imperméable pour éviter les infiltrations de lixiviats toxiques, et des systèmes pour récupérer les émissions de gaz, comme le méthane et le CO2. Cependant, ces normes ne sont pas souvent respectées ce qui entraîne des infiltrations et des catastrophes écologiques [3].
Trois autres techniques sont également utilisées de façon locale, mais se situent en dehors du schéma national de gestion :
– Le compostage
– Le recyclage
– L’incinération
Cette dernière technique permet de réduire le volume de déchets, mais est la source d’émissions de gaz à effet de serre et de résidus toxiques).
Les initiatives locales pallient souvent l’insuffisance des politiques publiques
En Algérie, la gestion des déchets est souvent inefficace malgré des budgets conséquents. Certaines localités consacrent plus de 50 % de leur budget annuel à la gestion des déchets, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Les infrastructures sont souvent insuffisantes et la coordination entre les différentes entités responsables est faible.
Au-delà de la gestion par l’état et les collectivités, les initiatives locales jouent un rôle crucial. Les comités de village et de quartier prennent souvent des mesures indépendantes.
Par exemple, en Kabylie, des quartiers pilotes pratiquent le tri et le compostage des déchets organiques. Ces initiatives sont soutenues par des collaborations avec les collectivités locales et des organisations de la société civile. Le compostage est une méthode de valorisation des déchets organiques qui permet de réduire significativement leur volume tout en produisant un amendement utile pour l’agriculture [4]. À l’université de Tizi Ouzou, les équipes de recherche ainsi que les associations développent des projets pilotes qui montrent que plus de 60 % des déchets sont organiques et peuvent être valorisés [5]. À Tizi Ouzou, par exemple, je préside une association de compostage et de recyclage qui a été créée pour former les étudiants dans ce domaine et leur permettre un accès à l’emploi.
Plusieurs axes peuvent être proposés pour améliorer la gestion des déchets
Pour améliorer l’efficacité de la gestion des déchets et réduire les coûts, plusieurs pistes peuvent être avancées :
– La mise en place d’un système de tri généralisé : actuellement la récolte de déchets en mélange ne permet pas la valorisation de déchets recyclables (plastique recyclable, papier/carton, emballages métalliques, verre [6].
– L’adoption du principe pollueur-payeur : encourager les industries et les particuliers à réduire leurs déchets et à adopter des pratiques plus durables.
– Le renforcement des infrastructures : investir dans des infrastructures pour le tri, le compostage et le recyclage [7].
– La coordination entre les acteurs : coordonner l’action des autorités locales, des entreprises publiques et des associations.
– La sensibilisation et l’éducation : mener des campagnes de sensibilisation pour encourager le tri des déchets à la source et leur réduction.
Le compostage : une méthode de valorisation privilégiée
En Algérie, une méthode de valorisation courante est le compostage. Elle est économique, écologique et adaptée aux pays de la rive sud de la Méditerranée, car une grande majorité des déchets sont organiques.
Le recyclage est une autre méthode importante de valorisation. En Kabylie, de nombreuses entreprises spécialisées, qui disposent de technologies et de compétences adéquates, recyclent différents types de plastiques. Les comités de village et de quartier leur vendent leurs déchets recyclables, générant des revenus supplémentaires. Ces partenariats permettent de stimuler l’économie locale, en même temps qu’ils bénéficient à l’environnement.
Économiquement, elle permet de réduire les coûts de gestion des déchets et de créer des emplois dans le secteur. De plus, le compostage améliore la qualité des sols et favorise la biodiversité. En effet, la valorisation de ces déchets organiques préserve les sols et la biodiversité et limite la pollution en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et les lixiviats toxiques.
En conclusion, la gestion des déchets en Algérie présente des défis significatifs, mais aussi des opportunités importantes. En adoptant des méthodes de valorisation efficaces, en renforçant les infrastructures et en encourageant la participation des communautés locales et des entreprises, l’Algérie peut améliorer sa gestion des déchets et contribuer à un avenir plus durable.
# 2 – Sociologie et typologies des déchets en Méditerranée
La gestion des déchets en Méditerranée est une problématique complexe influencée par des facteurs sociologiques, économiques et culturels. Au sein des pays méditerranéens, elle varie par l’implication des autorités dans leur gestion, par la nature des déchets retrouvés, par l’éducation et par l’importance donnée à la question environnementale. Les déchets, en fonction de comment ils sont étudiés, sont considérés comme une ressource, un danger, une marchandise, un objet de gestion ou une archive. En effet, ce sont des objets complexes qui nous amènent à voir le monde différemment ; ils nous communiquent des informations sur les politiques environnementales, l’histoire urbaine, les sciences du comportement, les mouvements sociaux, etc. [1]
Variabilité des déchets : comparaison entre la France et l’Algérie
Le niveau de vie et les habitudes de consommation jouent un rôle crucial dans la typologie des déchets produits. En France, l’urbanisation et l’industrialisation ont conduit à une augmentation des déchets non organiques, tandis qu’en Algérie, les déchets organiques restent dominants en raison de la prévalence des marchés locaux et des pratiques alimentaires traditionnelles. En effet, les typologies de déchets s’inscrivent dans des habitudes alimentaires liées à la culture et au cadre familial. [2]
En France, les déchets recyclables tels que le plastique, le verre et le papier représentent une proportion importante des déchets produits, reflétant un certain niveau de vie et un accès généralisé aux produits emballés. La comparaison de la France avec les pays européens montre que le tri y est le moins effectif et lorsque l’on zoome sur la région Sud-PACA située au bord de la Méditerranée, le tableau de la gestion des déchets est pire encore. En 2011, la quantité de déchets produits par habitant était de 730 kg, contre une moyenne annuelle de 592 kg pour les ménages français. Et la part étant recyclée avoisinait les 56kg contre 77kg au niveau national. [3]
En Algérie, bien que les plastiques soient également courants, les déchets organiques restent majoritaires et représentent 60% des déchets ménagers, surtout dans les foyers à revenu modeste. Historiquement, les Algériens géraient ces déchets de manière plus locale et organique. La gestion des déchets varie considérablement à travers l’Algérie et la Méditerranée en général. En Kabylie, la gestion des déchets est plus avancée grâce à une meilleure organisation communautaire et à des initiatives locales. Cependant, dans d’autres régions, la gestion des déchets souffre de problèmes de financement, de manque d’infrastructure et de faible sensibilisation. En Algérie, il y a un certain détachement : tant que notre maison est propre, ce qui se passe à l’extérieur importe peu. Les pertes et gaspillages de déchets organiques en Méditerranée du Sud sont parfois élevés. Ainsi l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture estime qu’ils s’élèvent à 250 kg par habitant et par an, et représentent plus de 60 milliards de dollars de perte par an, soit 120 dollars par habitant posant alors des questions sur l’utilisation des ressources naturelles et sur la sécurité alimentaire dans des régions fortement impactées par le changement climatique et où l’agriculture est très consommatrice d’eau. [4]
Relation sociologique aux déchets
Les études scientifiques montrent que les critères permettant aux populations d’adopter un comportement de tri sélectif incluent la législation et les politiques publiques telles que la mise en place d’infrastructures, les taxes, les sanctions, la communication, etc. Mais aussi des critères plus individuels et intrinsèques aux populations comme les affinités environnementales, l’influence sociale et les logements (types, proximités, etc.). [3] De même, il est montré qu’une sensibilisation et une connaissance plus accrue de l’impact des déchets ainsi qu’une communication autour de la gestion de ceux-ci permettent d’améliorer les réflexes de tri et de consommation des populations. Ainsi, en Kabylie les programmes de sensibilisation menés par des associations locales et des comités de village jouent un rôle crucial dans cette prise de conscience. Ces initiatives comprennent la promotion du tri des déchets à la source, le compostage des déchets organiques et la réduction de l’utilisation des plastiques. En France, de nombreuses associations participent également à la sensibilisation autour des déchets et initient des campagnes de ramassage des déchets tels que Clean my Calanques ou l’association MerTerre.
Programmes nationaux et locaux : efficacité et perception
Des facteurs tels que la culture, le développement économique, le climat et les sources d’énergie influencent la composition des déchets ; cette composition affecte le besoin de collecter les déchets plus ou moins fréquemment et détermine comment effectuer leur élimination. [5]
En France, les programmes de gestion des déchets sont bien établis et bénéficient d’un soutien public important, avec des réglementations strictes et des infrastructures développées.
En Algérie, bien que des programmes nationaux existent, leur efficacité est souvent limitée par des contraintes budgétaires et des infrastructures insuffisantes. Il existe des programmes nationaux, comme la stratégie nationale de gestion intégrée et de valorisation des déchets à l’horizon 2035, mais leur efficacité reste limitée par rapport à la quantité de déchets produits. Le dysfonctionnement de ce système allié aux résultats des chercheurs et chercheuses dans ce domaine souligne l’importance d’élargir les programmes de collecte des déchets séparés à la source afin de permettre la réduction des déchets ménagers mis en décharge, de limiter les coûts économiques et environnementaux du transport des déchets et permettre une valorisation des matériaux triés. [6]
La Méditerranée, lieu de rencontre et de fin pour les déchets des pays du bassin
Les perceptions historiques des déchets en Méditerranée montrent une évolution dans la manière dont les sociétés ont perçu et géré les déchets. Traditionnellement, les déchets étaient perçus comme des ressources pouvant être réutilisées ou compostées. Cependant, avec l’industrialisation et la modernisation, cette perception a changé, les déchets étant de plus en plus considérés comme un problème environnemental et sanitaire.
Lors des ramassages effectués sur les plages de Tizi Ouzou les déchets retrouvés n’étaient pas directement identifiables comme venant d’autres pays, mais les déchets plastiques se fragmentent et se dispersent, ils se stockent dans les fonds marins et sont ingérés par la faune. Les bassins versants des pays bordant la Méditerranée amènent leur flux de déchets jusqu’à la mer Méditerranée qui facilite leur circulation. La question des déchets est ainsi un défi transnational pour lequel les coopérations régionale, nationale et internationale combinées aux initiatives locales sont donc essentielles pour aborder ce problème de manière efficace.
La gestion des déchets en Méditerranée est influencée par des facteurs sociologiques, économiques et culturels. Les différences entre la France et l’Algérie sont principalement dans les politiques publiques mises en place, sur la consommation (ex : proportion de déchets organiques/non organiques), mais aussi sur l’influence du niveau de vie, les initiatives locales et nationales, ainsi que les perceptions des déchets et notamment l’éducation et la sensibilisation environnementales.
La dimension environnementale, économique et sociale de la gestion des déchets en Méditerranée la place comme un des défis majeurs à relever dans les prochaines années. Une gestion efficace des déchets nécessite une compréhension approfondie de ses impacts et une coopération entre les acteurs pour développer des solutions durables et adaptées aux réalités locales.
# 3 – Impact environnemental et biodiversité en lien avec les déchets
L’anthropocène est parfois comparé à une ère géologique, notamment par l’omniprésence du plastique retrouvé sur tous les continents et dans toutes les mers. Ce plastique provient des déchets de la consommation de tout un chacun. Or si on sait comment le produire sa gestion et son impact sous forme de déchet ne sont pas encore maitrisés : 75% de l’ensemble du plastique déjà produit sur la planète est aujourd’hui un déchet [1]. En dehors du plastique, notre consommation est à l’origine d’une grande quantité de déchets qui impactent notre environnement et la biodiversité.
Déchets et pollution environnementale
La mer Méditerranée est considérée comme la mer la plus polluée au monde, ce triste record est dû à l’accumulation de déchets plastiques issus à 80% des activités terrestres et ayant été charriés par les fleuves ou le vent [1]. Ces déchets sont parfois visibles (mégots de cigarette, emballages, etc) et représentent 10% du plastique retrouvé en Méditerranée. Les 90% restants sont invisibles, présents sous la forme de microplastiques [2].
Sur terre les déchets sont aussi très présents, ils parsèment les plages, les routes et se retrouvent partout. Parmi-eux les déchets ménagers, en fonction de leur gestion, ils peuvent être brûlés, stockés ou recyclés. Ils sont parfois jetés avant même d’atteindre la poubelle, mais ils sont également retrouvés dans des décharges à ciel ouvert ou encore stockés dans des centres d’enfouissement technique (CET). En Algérie, comme dans de nombreux autres pays, les CET ne respectent pas toujours les normes environnementales strictes nécessaires pour limiter leur impact sur l’environnement et éviter les catastrophes écologiques. Or, les lixiviats, la partie liquide qui se forme lors d’une accumulation de déchets, sont toxiques, car chargés en métaux lourds et autres substances acides. Lorsque l’étanchéité des CET est défectueuse, les substances toxiques peuvent alors contaminer les sols et les eaux souterraines, entrainant des risques majeurs pour l'environnement et la santé humaine. En effet, les métaux lourds, tels que le plomb et le mercure, persistent alors dans l'environnement pendant des décennies, affectant ainsi la faune et la flore locales. Ces problèmes sont exacerbés par la gestion inefficace des déchets, souvent motivée par des intérêts financiers plutôt que par des préoccupations environnementales.
Biodiversité et contamination
Les déchets plastiques ont un impact dévastateur sur la faune et la flore marine. Chaque année, plus de 1,5 milliard d'animaux meurent à cause des déchets plastiques [3]. Les animaux marins, tels que les poissons, les tortues et les oiseaux, se retrouvent piégés dans les emballages plastiques ou ingèrent des fragments de microplastiques altérant leurs mouvements et leurs métabolismes. Aucun espace sur Terre n’est épargné, des scientifiques ont retrouvé du plastique jusque dans les fonds marins encore inexplorés [4]. Il en va de même pour la pollution aux métaux lourds liés aux déchets électroniques ou aux lixiviats, leur impact s’ancre dans un écosystème, en change le pH et contamine la biodiversité implantée à cet endroit.
Ces pollutions non seulement tuent directement les animaux et les plantes, mais perturbent également la chaîne alimentaire, affectant l'ensemble des écosystèmes jusqu’à l’homme. La perte d'espèces et la réduction de la biodiversité entraînent une diminution des services écosystémiques essentiels, tels que la pollinisation des cultures, la purification de l'eau et le contrôle des parasites. La biodiversité lorsqu’elle est réduite fragilise le bon fonctionnement des écosystèmes, les rendant moins résilients aux changements climatiques et aux autres perturbations environnementales [5].
Solutions et prévention
Afin de limiter les pollutions de nombreuses techniques sont employées. La première et la plus efficace est celle de limiter la production de déchet à sa source en adoptant une consommation plus locale, sans emballage, en favorisant l’usage du vrac et des emballages cartonnés à la place des emballages plastiques. Ensuite il est nécessaire d’être acteur de la gestion de ses déchets en les triant et les recyclant au mieux, en favorisant le compostage, etc. Cela nécessite également un apprentissage.
En effet, l'éducation et la sensibilisation sont cruciales pour changer les comportements et promouvoir des pratiques durables. En éduquant les jeunes générations sur l'importance de la gestion des déchets et la protection de l'environnement, nous pouvons espérer un changement de mentalité à long terme. Les programmes scolaires, les campagnes de sensibilisation et les initiatives issues de la société civile sont essentiels pour atteindre cet objectif. En Algérie, la sensibilisation des femmes et des enfants joue un rôle clé dans cette dynamique. Les associations sur place observent qu’en impliquant activement les femmes et les enfants, il y a une multiplication des efforts de sensibilisation et une meilleure mise en pratique de la gestion des déchets au sein des foyers et des communautés.
Vient ensuite la phase de dépollution, elle peut s’effectuer par le ramassage des déchets sauvages, par la filtration des eaux pluviales, par le développement de techniques innovantes de dépollution. On peut notamment s’intéresser à la phytoremédiation qui consiste à utiliser des plantes pour dépolluer les sols et les eaux contaminés par les métaux lourds et autres substances toxiques [6]. Certaines plantes ont la capacité d'accumuler les métaux lourds dans leurs tissus, permettant ainsi de nettoyer les sols contaminés de manière naturelle et durable. Cette technique, très coûteuse, est particulièrement prometteuse pour les régions touchées par la contamination due aux lixiviats des centres d'enfouissement.
Légalement parlant, les états bordant la Méditerranée ont signé en 1976 la Convention de Barcelone, c’est le principal accord portant sur l’environnement en Méditerranée qui est juridiquement contraignant [7]. Les objectifs de cet accord sont la protection de la mer Méditerranée et la lutte contre la pollution. Cela se concentre sur la réduction de la pollution marine, la gestion durable des déchets et la sensibilisation des populations locales. Malgré une meilleure gestion et la mise en place de règlementations plus strictes, il reste encore beaucoup à faire en Méditerranée sur la question des déchets.
Cela ne peut se faire qu’avec les populations. De part et d’autre de la Méditerranée, de nombreuses initiatives citoyennes sont d’ores et déjà en cours. En Algérie, dans la ville de Tizi Ouzou, l’association pour le compostage et le recyclage œuvre à la sensibilisation et propose des évènements de ramassage de déchets sur les plages. En France, l’association Neede sensibilise les populations aux questions de transition environnementale et de gestion des déchets. D’autres initiatives comme Clean my calanques, Surfrider ou le mouvement Zero Waste participent à faire connaître la problématique des déchets. Ces acteurs sont retrouvés sur la plateforme ReMed initiée par l’association MerTerre permettant de fédérer toutes les organisations qui contribuent à la réduction des déchets sauvages en Méditerranée.
L'impact des déchets sur l'environnement et la biodiversité est un problème complexe et multidimensionnel qui nécessite une approche intégrée pour être résolu. Des initiatives locales et internationales, des efforts d'éducation et de sensibilisation, ainsi que des techniques innovantes comme la phytoremédiation sont essentiels pour réduire la pollution des déchets et protéger la biodiversité. En travaillant ensemble, nous pouvons espérer un avenir plus propre et plus durable pour la Méditerranée et au-delà.
Biographie

Melissa Kanane : Docteure en protection des écosystèmes spécialisée en gestion des déchets et enseignante vacataire à l’Université de Tizi-Ouzou en Algérie. Ses travaux sont consacrés à la quantification, identification, caractérisation et valorisation des déchets ménagers et assimilés.

Justine Viros : Scientifique spécialiste de la forêt méditerranéenne et des interactions chimiques forêt – atmosphère dans le cadre du changement climatique. Elle occupe actuellement un poste d’ingénieure de Recherche au sein de la mission Interdiscipinarité(s) d’Aix-Marseille Université où elle est chargée de mission développement pour l’association Neede Méditerranée.
Références :
[1] https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2019-03/20190305_Rapport_Pollution-plastique_a_qui_la_faute_WWF.pdf
[2] https://www.ifremer.fr/fr/microplastiques-et-nanoplastiques-quels-impacts-sur-la-vie-marine
[3] https://www.theseacleaners.org/fr/la-pollution-plastique/#:~:text=%F0%9F%90%A1%20Les%20animaux%20marins%2C%20la,%C3%A9touff%C3%A9s%2C%20affam%C3%A9s%2C%20mortellement%20bless%C3%A9s.
[4] https://www.ifremer.fr/fr/actualites/des-dechets-plastiques-de-la-surface-jusqu-aux-fonds-marins
[5] Oliver, T. H., Isaac, N. J., August, T. A., Woodcock, B. A., Roy, D. B., & Bullock, J. M. (2015). Declining resilience of ecosystem functions under biodiversity loss. Nature communications, 6(1), 10122. https://www.nature.com/articles/ncomms10122
[6] Jones, D. L., Williamson, K. L., & Owen, A. G. (2006). Phytoremediation of landfill leachate. Waste Management, 26(8), 825-837. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X0500190X
[7] https://www.unep.org/unepmap/fr/who-we-are/barcelona-convention-and-protocols
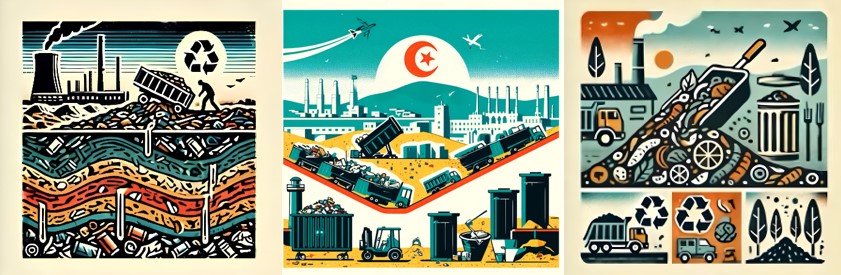
À partir de cette conversation, l’IA a généré un flot d’illustration. Stefan Muntaner l’a nourri avec les données éditoriales et a guidé la dimension esthétique. Chaque illustration devient ainsi une œuvre d’art unique à travers un NFT.
