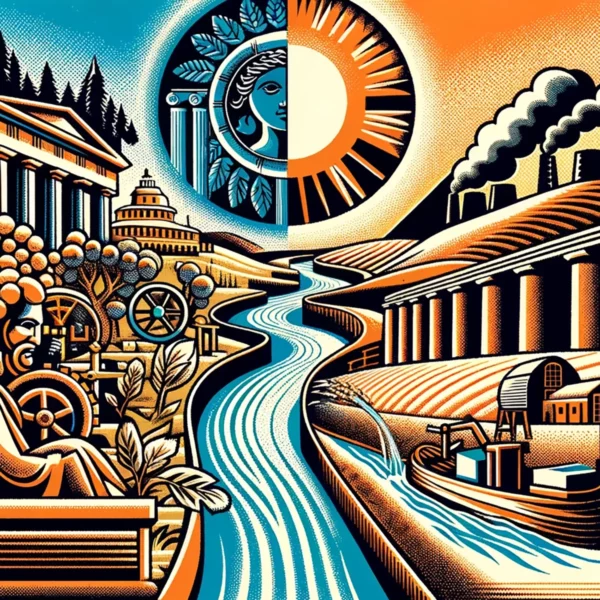Le réchauffement climatique dérègle le cycle de l’eau et l’activité humaine accentue la pénurie d’eau douce. Les tensions pour le contrôle et l’accaparation de cette ressource vitale s’accentuent. À l’exemple du pétrole au 20ème siècle, l’eau devient source de conflits. Peut-on trouver dans le passé, notamment dans les régions de culture fluviale, des dispositifs qui permettent de résoudre les tensions entre les différents acteurs ?
La thématique est abordée au cours de trois tribunes dans un dialogue entre les scientifiques Karl Matthias Wantzen* et Bernard Mossé**
#1 – L’impact de l’activité humaine sur le cycle de l’eau
Bernard Mossé : peux-tu donner une explication rapide du cycle de l’eau, en mettant en lumière le rôle des fleuves dans ce système ?
Karl Matthias Wantzen : Le cycle de l’eau comprend l’évaporation, la formation des nuages, les précipitations, l’écoulement à la surface ou sous la surface, et enfin le retour des eaux vers les océans, souvent via les fleuves. Dans certaines cultures, comme dans les Andes en Amérique du Sud, ce cycle est comparé au cycle de la vie, avec les fleuves représentant la naissance et la mort des âmes. Cependant, l’activité humaine perturbe ce cycle, notamment par l’imperméabilisation des surfaces, la réduction des zones inondables des fleuves, et la déforestation.
BM : On situe souvent l’impact négatif de l’homme au début de l’ère industrielle. Peut-on dire que l’activité humaine affecte ce cycle depuis bien plus longtemps ?
KMW : Oui, mais il faut savoir où et à quelle échelle. La coupure de fleuve à grande échelle par les barrages, a pour résultat l’absence de sédiments : les embouchures dites « Delta » se transforment en forme de « Beta » dû à l’érosion partout et en grande quantité (seulement un tiers des grands fleuves peuvent encore couler librement). Cela est un produit du dernier centenaire, et une catastrophe pour le fonctionnement écologique et leur soutien à la diversité bio-culturelle.
Si nous prenons, par exemple, le lien entre la végétation et l’eau, ce qu’on appelle les “flying rivers”, c’est-à-dire l’évapotranspiration par les plantes, qui produit une certaine humidité dans l’air local : suivant la quantité, elle peut avoir un impact très fort. Par exemple, pour la partie au-dessus de l’Amazonie, en Amérique du Sud, 15 à 20 % de la pluie dépend de ces “flying rivers”. La destruction de ces forêts primaires est arrivée à un point de bascule. Sa continuation serait une catastrophe d’abord pour l’Amérique du Sud et pour l’ensemble de la planète.
Autour de la Méditerranée, le déboisement des forêts a commencé avec les civilisations grecques, peut-être même avant avec les Phéniciens, et ensuite les Romains, pour construire leurs navires et leurs forteresses. Ils ont également construit des barrages et des aqueducs, et pollué des sites de minéralisation. Cela a certainement eu une influence sur le cycle de l’eau et le débit des rivières, mais avec un impact limité. Au cours des derniers siècles, et particulièrement depuis la révolution industrielle, l’impact de l’homme sur le cycle de l’eau s’est intensifié, avec l’urbanisation, la construction de barrages, et l’extraction excessive des ressources.
BM : Pour la chaire UNESCO sur les fleuves dont tu es responsable, tu fais le lien entre les sciences environnementales et les sciences humaines et sociales. La pénurie d’eau douce, qui va s’accentuer, est la source de tensions, voire de conflits, entre divers acteurs. Quelle solution proposes-tu pour les résoudre ? Peut-on trouver dans le passé, peut-être dans des régions de culture fluviale, des dispositifs qui permettent de résoudre les tensions entre les différents acteurs ?
KMW : Pour moi, la solution se trouve dans mon concept de « culture du fleuve ». Il faut transformer les bassins versants, c’est-à-dire les bassins hydrographiques qui réunissent toutes les eaux qui tombent dans une région, en territoires politiques. Si tu me permets ce néologisme, il faut transformer les territoires en « hydrotoires », c’est-à-dire des « bassins de responsabilité ».
Tous les humains et toute la nature qui se trouvent dans un bassin versant obéissent aux mêmes contraintes et ont les mêmes intérêts. Mais le plus souvent les territoires humains ne correspondent pas à cette géographie. Les fleuves ont un problème : ils sont longs, donc ils croisent plusieurs territoires qui ont souvent une forme arrondie. À partir d’une certaine longueur, les fleuves sont des sources de division entre plusieurs territoires. Et ça, c’est une erreur. Le fleuve est la victime de la territorialisation. Il faut mettre le fleuve au milieu du territoire, construire les paysages politiques autour de cette réalité hydrologique.
BM : Si j’entends bien, tu penses que l’intérêt de l’homme est de calquer son action sur celle de la nature ?
KMW : Tant que nos actions continuent à perturber le fonctionnement des paysages, oui, absolument. Nos décisions sur un bassin -barrage ou transfert d’eau entre deux bassins versants- ont en même temps un impact sur la survie des cultures, des espèces et sur la qualité des générations actuelles et futures. Quelle qualité de vie voulons-nous pour le futur ?
Allons-nous l’abimer par une stratégie des utilisateurs qui ne vise que les prochains 5 ans, ou voulons-nous que nos enfants aient à minima les mêmes conditions que nous, voire idéalement de meilleures conditions, en ce qui concerne l’abondance de l’eau, le niveau de pollution, la présence des espèces biologiques, etc. Si oui, il faut changer notre comportement de façon profonde…
Il y a dans le monde des populations avec des usages traditionnels qui sont tout à fait adaptés au rythme de l’eau, c’est-à-dire à la variation du débit, entre l’étiage minimal et les inondations naturelles. Mais surtout en Europe, il existe cette religion de la faisabilité et de l’ingénierie qui a fini par provoquer des impacts démesurés. On en revient à ta première question : les Romains ont déjà bouleversé la nature, mais ils ont quand même maintenu leurs activités en dessous d’un certain seuil. Aujourd’hui, ce seuil est dépassé. Les fleuves ont été dénaturés à un tel point que nous sommes confrontés à un cercle vicieux : plus la ressource devient rare, plus nous sommes gourmands. C’est la tragédie des communs. Il faut développer une responsabilité commune. C’est évidemment très difficile, parce que l’être humain, comme espèce biologique, réagit aux menaces immédiates. Il faut intégrer les prévisions du futur dans les actions présentes. Et il faut convaincre la communauté que chacun fasse sa part, y compris les personnes les plus fortes en situation de concurrence. Je reviens là aux bassins de responsabilité : si on a une nation hydrologique, on va agir ensemble, parce qu’on ne veut pas laisser les plus pauvres en arrière si on veut que cette communauté bénéficie d’un futur durable. Même s’il nous faut faire aussi des sacrifices aujourd’hui, ou abandonner certaines pratiques, sortir de sa zone de confort. C’est ce qui est le plus difficile : convaincre les gens, surtout ceux qui bénéficient le plus de la situation présente. Mais cela peut marcher avec une communauté basée sur la négociation, la compréhension des enjeux et le respect les uns des autres. J’ai trouvé quelques exemples autour de la planète, en Amérique du Sud, en Inde et en Afrique, et bien sûr aussi en Europe. Souvent, le déclencheur de cette communauté, malheureusement, c’est une catastrophe. C’est ce qui s’est passé pour la vallée du Rhin avec un accident chimique en 1986 : tous les pays riverains du Rhin ont alors entériné les conventions qui étaient sur la table depuis des années.
BM : Oui, c’est un parallèle que l’on peut faire avec les crimes de masse : les consciences s’éveillent quand la tragédie a eu lieu.
KMW : Au sujet des catastrophes, il faut faire attention, parce ce que ce qui est en train de se produire peut être tellement fort qu’on peut y survivre, mais peut-être pas. La question plus précisément, c’est : à quel niveau de qualité de vie voulons-nous vivre à l’avenir ?
La catastrophe de Sarnen en Suisse (la pollution du Rhin par les eaux des pompiers à la suite de l’incendie d’une usine d’industrie chimique) a éliminé une grande partie des poissons dans le fleuve et coupé l’eau potable pendant plusieurs semaines. Le problème s’est étendu jusqu’à la Mer. Avec des aménagements, on a pu résoudre plus ou moins le problème. Mais avec le trop grand déboisement des têtes de bassin, sans replantation, sans protection et avec la construction de barrages, les dégâts dépassent le cycle d’une vie humaine : il y a bien des solutions, mais nous ne les verrons pas. Nous condamnons les générations futures à vivre dans la pénurie d’eau pendant plusieurs générations ou pour toujours. Et ça, c’est la grande responsabilité de notre génération aujourd’hui. On ne peut pas se contenter de dire « il faut éduquer mieux les jeunes pour qu’ils fassent mieux ». Non, c’est aujourd’hui qu’il faut agir.
#2 – La méditerranéisation de l’Europe du Nord oblige à revoir la coopération Nord/Sud
Bernard Mossé : Parmi toutes les conséquences, sans doute irréversibles, du dérèglement climatique, on assiste à ce qu’on appelle la « méditerranéisation » de l’Europe du Nord. Peux-tu nous en dire un mot ? Où en est-on aujourd’hui et à quoi faut-il s’attendre dans les décennies à venir ?
Karl Matthias Wantzen : En effet. Les pays méditerranéens devraient inviter tous les maires des pays plus au nord à leur rendre visite et à regarder leur situation, surtout pendant les phases de pénurie, avec la sécheresse, les feux de forêt, et aussi des événements comme on a vu en Méditerranée, en septembre dernier : il est tombé en Libye en 48 heures le double de la pluviosité d’une année, avec pour conséquence 3500 morts. Et d’autres drames en Grèce et en Espagne. C’était vraiment catastrophique.
La méditerranéisation de l’Europe du Nord, ça veut dire que les conditions climatiques déjà connues depuis des centaines d’années, voire des millénaires, en Méditerranée, remontent vers le nord. Nous n’avons donc plus une pluviosité bien équilibrée pendant toute l’année, et en même temps nous avons de plus en plus des fleuves asséchés, avec un débit énormément réduit, un réchauffement de l’eau qui entraîne des maladies dues à la surproduction des bactéries, etc.
Et également des épisodes torrentiels catastrophiques comme on l’a vu en Allemagne, ou en Belgique, il y a deux ans, avec 134 personnes décédées dans un pays où on pensait que la prévention des crues fonctionnait. Mais les événements dépassent nos forces d’imagination et il faut développer une culture du risque notamment par des échanges Nord / Sud.
Les événements connus comme « singuliers » commencent à devenir « réguliers ». La normalité est en train de changer. Il faut non seulement que les populations plus au nord apprennent des populations du Sud pour prévenir les catastrophes mais il faut organiser la solidarité entre elles. Parce que les pénuries, frappent bien sûr beaucoup plus dur dans les pays méditerranéens.
Une chose qu’on ne dit pas assez est qu’il faut vraiment aussi prévoir des abandons : des abandons de certaines cultures et de certaines pratiques mais aussi de certaines régions agricoles. Ne plus cultiver, par exemple, fraises et framboises au Maroc pour les bouches européennes en hiver… En termes de gestion de l’eau, de pratique culturelle et de solidarité, c’est absurde.
Bernard Mossé : Dans cet échange de savoirs, en l’occurrence du Sud vers le Nord, vois-tu d’autres techniques, d’autres dispositifs dont le Nord pourrait s’inspirer ?
Karl Matthias Wantzen : Déjà, reconnaître que la ressource en eau n’est pas inépuisable et gérer la pénurie, c’est ce que le Nord peut déjà apprendre ; notamment en être beaucoup moins gourmand dans la production agricole voire industrielle. Les patrons des grandes entreprises ont pour la plupart déjà compris cela, mais je dirais que ce n’est pas encore intégré aux niveaux des cadres, managers et agents. Les usagers en général croient toujours que l’eau va toujours sortir de leur robinet et qu’ils peuvent la gaspiller à volonté.
Comme l’eau reste très bon marché dans ces régions-là, le gaspillage a très peu d’impact sur leur poche. Je ne dis évidemment pas qu’il faille rendre l’eau bien plus chère, mais peut- être faudrait-il punir le gaspillage. Ce serait une bonne idée. Mais cela signifie surtout qu’il faut que nous prenions conscience que, quelle que soit sa pratique, l’être humain a toujours un impact sur l’eau. Il faut mesurer cette empreinte écologique négative. Quelle masse je dois économiser pour contribuer à améliorer la situation de l’eau. Il faut toujours tenir compte des besoins de la nature concernant l’eau, ce qui a été complètement ignoré.
Mais maintenant que nous commençons à détruire les bases de notre survie, que les catastrophes se succèdent et s’accélèrent, nous commençons à réfléchir. Par exemple, dans les montagnes comme les Vosges et la Forêt Noire, on voit maintenant des hectares et des hectares d’arbres morts parce qu’il fait trop sec, parce qu’on a planté de mauvaises espèces.
Mais nous avons aussi d’autres problèmes, par exemple, le drainage qui entraîne l’eau vers le bas et la détourne des têtes de bassin qui sont primordiales pour le cycle de l’eau. Il faut maintenir, restaurer et rétablir les zones humides qui sont les vraies éponges du paysage, qui remplissent les nappes et qui fournissent de l’eau pendant les étiages. Il faut changer jusqu’à notre vocabulaire météorologique. À la télévision, on dit : “Il va faire mauvais temps, il va pleuvoir cette semaine.”
On devrait dire bien au contraire : « il va pleuvoir, alors profitons-en ! c’est une opportunité pour nous d’arroser les arbres à moindre coût, pour les trames vertes et bleues des espaces verts de nos villes »… la végétation y est en effet en
mauvais état. Il faut repenser cela complètement et se demander où se trouvent les éponges potentielles, surtout dans le périmètre urbain, et comment nous pouvons les utiliser.
Et surtout, ne pas croire qu’il suffit de construire un bassin : il faut surtout savoir où se trouve l’éponge naturelle qui a plusieurs milliards d’années d’expérience. Comment trouver de meilleures solutions que celles basées sur la nature ?
Bernard Mossé : A ce sujet, quelles leçons pouvons-nous en effet tirer de la polémique qui a lieu autour des méga-bassines ?
Karl Matthias Wantzen : C’est une posture que l’on voit malheureusement un peu partout. Il y a quelques temps le chef de la Chambre d’agriculture en Espagne m’a dit, alors même qu’il venait de déclarer que certaines régions ne pourront bientôt plus cultiver de vignes : “Il y aura toujours de l’eau, on ne doit rien changer dans la viticulture”. Mais si, il faut changer.
Et ce changement touche les différentes pratiques de l’être humain et surtout notre alimentation et notre agriculture. Une bonne partie de l’agriculture actuelle n’est plus compatible avec le changement climatique. Je n’accable pas des producteurs qui doivent réagir aux attentes des consommateurs, je me plains plutôt des consommateurs qui veulent toujours acheter de la viande à bas prix et la consommer sept jours sur sept. Vu l’empreinte de l’eau dans la production de viande, c’est impossible ! Il faut absolument réduire notre consommation de viande mais aussi réduire notre consommation des autres cultures. Je parlerais d’une consommation « hydrovore », comme la production en Espagne qui exporte une grande partie de ces légumes (et ainsi son eau) sur des camions vers le nord au lieu de les garder
pour les locaux. Mais comme la seule mesure est le gain immédiat, on vend peu à peu notre futur, c’est-à-dire celui de nos enfants.
#3 – La crise écologique nous oblige à bâtir une nouvelle éthique
Bernard Mossé : Tu dis souvent qu'il faut non seulement changer les comportements, mettre en place des dispositifs de coopération, notamment autour des bassins de responsabilité, etc., mais que tout cela devait être soutenu par une nouvelle éthique. Tu as même écrit dans nos échanges « une nouvelle (ancienne) éthique ». Pourrais-tu commencer à esquisser les contours de cette nouvelle éthique ou de ce retour à une ancienne éthique ?
Karl Matthias Wantzen : Dans les anciennes cultures, par exemple les cultures celtiques, la nature était considérée comme un partenaire. Mais il faut aussi dire que les Celtes n'étaient pas encore capables de dominer la nature de la même façon que l'être humain moderne peut le faire. Je ne veux pas revenir sur certains éléments culturels, les réviser, surtout en ce qui concerne le respect envers la nature, mais il faut aussi développer une nouvelle éthique à la fois basée sur notre science et sur notre conscience de l’impact très fort que nous avons sur la nature : surtout intégrer le futur dans la prise de décisions.
L'humanisme nous a apporté une idéalisation de l'être humain, pour vivre mieux. Mais en faisant cela, par notre course en avant, nous avons créé une situation où nous nous coupons du futur. À mon avis, il faut élargir l'amour que les êtres humains se portent entre eux à celui pour la nature. Je dois œuvrer pour le bien-être de mon « prochain », mais ce prochain ne doit pas être seulement l’être humain mais aussi la nature, je crois. C'est cela vers quoi il faut aller : avoir de la compassion pour la nature, être proactif envers elle, sachant qu’elle est notre père, notre mère, qui nous soutient.
Il faut donc effectivement s’inspirer, en partie, des cultures anciennes qui ont été systématiquement refoulées, notamment en Occident, avec, je dirais, l'idéologie cartésienne, c'est-à-dire la mécanisation et la rationalisation des processus naturels, les sciences et techniques en appui, négligeant les aspects émotionnels et spirituels de l’humain. Nous pouvons les retrouver sans tomber nécessairement dans cette nostalgie des anciennes spiritualités sacrées.
BM : Si je te comprends, il n'est pas forcément nécessaire de revenir à une spiritualité antique, à l'hypothèse Gaïa, développée par le climatologue Lovelock dans les années 1970, ou à l’archaïque Pacha Mama des Andes, la Terre Mère, inscrite dans la Constitution de l’Equateur en 2008. Cette nouvelle éthique que tu appelles de tes vœux peut se résumer par cette phrase que nous livre dans notre premier entretien ta compatriote et philosophe, Vanessa Weihgold : il faut savoir ce que la terre nous donne et ce qu'il faut lui donner en retour. Es-tu d'accord avec cette formule ?
KMW : Oui, pour moi, en tant qu'écologue, je connais le fonctionnement des écosystèmes, je sais que les interactions entre les différents éléments des écosystèmes sont très complexes. Mais avec les mécanismes de rétroaction, je peux quand même les évaluer et les comprendre mieux. C'est pour moi un exercice dépourvu de religiosité ou même de spiritualisme. Je dois comprendre quel levier je peux actionner pour avoir tel effet. Quels sont les tabous ? Scientifiques ? Si tu touches aux arbres des têtes de bassin, tu vas déclencher une catastrophe, une avalanche, une sécheresse, une inondation. Et on doit intégrer ce savoir dans cette nouvelle éthique. Nous avons besoin d'une éthique basée sur notre compréhension de la nature, et nous sommes très avancés. Le vrai problème est d’agir selon nos connaissances. Nous pouvons tout à fait effectuer la synthèse entre les données scientifiques d’un côté et les enseignements des anciens de l'autre. Cela a été un des résultats les plus structurants du livre que j'ai dirigé sur la culture des fleuves : écouter le chant des pêcheurs sur le fleuve Sénégal, c'est pratiquement comprendre sur le long terme la qualité de l'environnement du fleuve, son hydrologie, etc. Le rythme de la nature est là écrit non pas avec des données hydrographiques, mais dans le texte d’une chanson. Il n'y a plus alors d’opposition entre la tradition et la science moderne : cela fonctionne très bien ensemble.
BM : Ce que tu décris est passionnant non seulement pour comprendre comment bâtir une nouvelle éthique mais aussi comment rétablir la confiance dans le savoir scientifique.
Ou pour le dire autrement, quelle est la responsabilité du scientifique dans la promotion d’une nouvelle éthique ?
KMW : Les chercheurs doivent améliorer leur capacité de communication. Le nouveau master que je suis en train de construire comprendra au minimum 25% de soft skills, de capacité de communication entre les membres de l'équipe, de façon interdisciplinaires, entre chercheurs, mais aussi de façon transdisciplinaire, c'est-à-dire avec les acteurs de terrain, mieux comprendre le jeu des acteurs.
J'ai analysé la biosphère de la Dordogne et la réserve naturelle sur la Loire, travaillé avec les populations sur d’autres sites fluviaux un peu partout dans le monde, et c'est toujours la même chose : il faut d'abord produire de la confiance. Ce n'est pas seulement en lisant une publication en anglais qui décrivent la complexité des menaces qui les attendent que les gens vont me suivre, mais surtout en donnant des exemples positifs. Nous avons de nombreux exemples d’échecs où les bonnes mesures basées sur la science n'ont pas du tout été acceptées par les populations. Les gens n'étaient pas disposées à sacrifier leur confort pour un projet dont ils ne comprenaient pas le sens. Par exemple, des pêcheurs qui n’étaient pas d’accord pour l'abandon d'un barrage en faveur d'une rivière qui assurait pourtant la pérennité de la pêche pour les décennies à venir. La communication est très importante et je dirais que les chercheurs doivent être meilleurs dans ce domaine. De l'autre côté, la population devrait être en mesure de rechercher l’information pour une meilleure qualité de vie. Il faut organiser des dispositifs qui permettent d’organiser le donnant donnant, avec des projets développer ainsi ensemble par les différentes parties prenantes : nous appelons ça des living labs, des laboratoires vivants, où on peut montrer des exemples positifs opérationnels, et ensuite les transférer, les communiquer d’une population à une autre. Par exemple une ville qui a fait un projet qui a bien fonctionné peut communiquer à d’autres villes ce qui a bien fonctionné, quelles sont les contraintes et comment les dépasser... C'est ce que je fais dans tous mes projets. Nous avons gaspillé beaucoup de temps en refaisant les mêmes recherches sur les mêmes problèmes. Il faut que l'humain apprenne, et apprenne à transmettre et à échanger.
Pour l’ensemble du pourtour méditerranéen, un meilleur échange des bonnes pratiques est primordial, mais aussi entre la Méditerranée et les gens qui vivent plus au nord. C'est très important.
Face à la crise écologique, la nouvelle éthique à construire, basée sur les connaissances scientifiques, est une éthique de la compréhension mutuelle et de la coopération.
Biographie
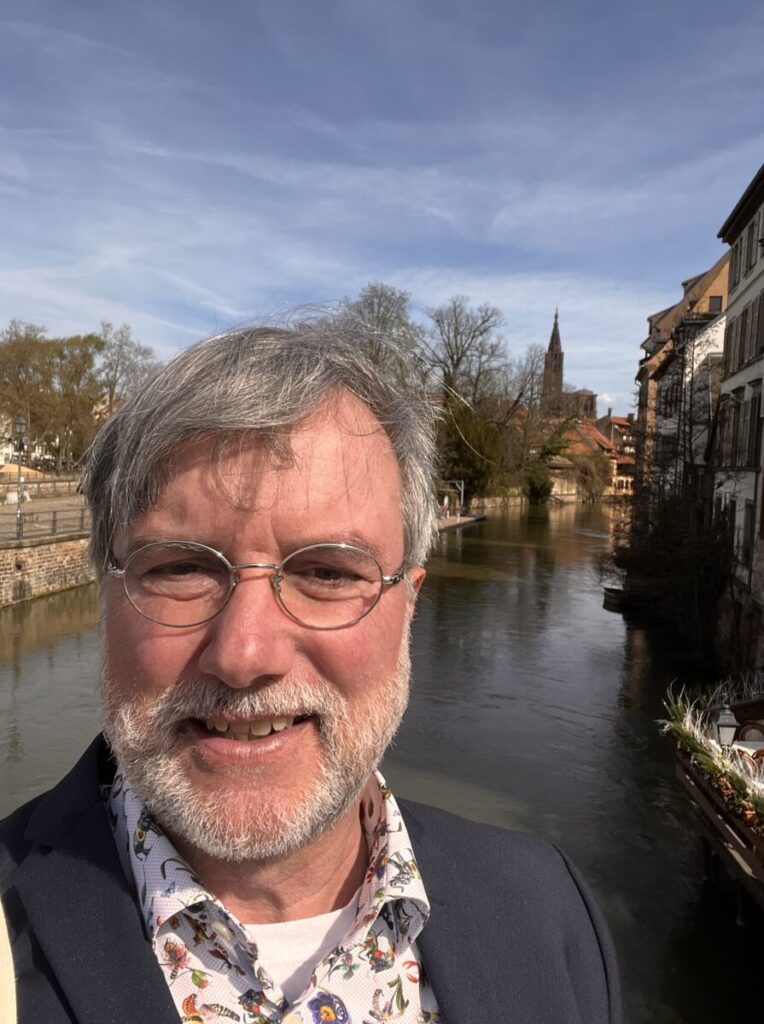
Karl Matthias Wantzen a étudié la biologie à l’Université de Constance, a passé son doctorat sur les eaux brésiliennes à l’Institut Max Planck et a obtenu son habilitation de recherche sur le thème « Biodiversité et protection de la nature des grands fleuves ». Pendant 8 ans, il a dirigé un projet de coopération internationale sur le Pantanal au Brésil, l’immense plaine inondable du fleuve Paraguay.
Depuis 2010, il est professeur dans des universités françaises, d’abord à Tours, depuis 2023 à Strasbourg. Outre une chaire UNESCO « Fleuves et Patrimoine “, il dirige également une chaire interdisciplinaire ” Water and Sustainability “ pour le partenariat universitaire trinational ” EUCOR- The European Campus ».
Plus d’informations sur https://ites.unistra.fr/recherche/equipes/bise/karl-matthias-wantzen, https://www.unesco-chair-river-culture.eu/

Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée.
Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).
Pour aller plus loin
Wantzen K.M. (editor), River Culture, Life as a dance to the rhythm of the waters, Ed. UNESCO, 2023.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382774
Wantzen, K. M. (2022): River culture: How socio-ecological linkages to the rhythm of the waters develop, how they are lost, and how they can be regained. The Geographical Journal, 00, 1–16. DOI: https://doi.org/10.1111/geoj.12476, free download
https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/geoj.12476
Wantzen, K.M., Ballouche, A., Longuet, I., Bao, I., Bocoum, H., Cissé, L., Chauhan, M., Girard, P., Gopal, B., Kane, A., Marchese, M. R., Nautiyal, P., Teixeira, P., Zalewski, M. (2016): River Culture: an eco-social approach to mitigate the biological and cultural diversity crisis in riverscapes. Ecohydrology & Hydrobiology 16 (1): 7-18
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecohyd.2015.12.003 free download
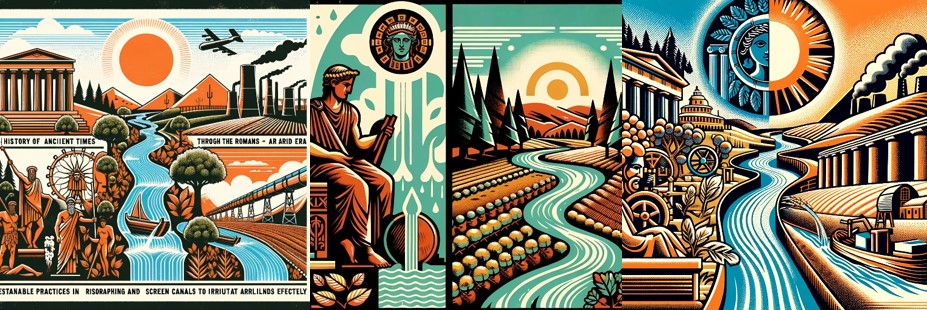
À partir de cette conversation, l’IA a généré un flot d’illustration. Stefan Muntaner l’a nourri avec les données éditoriales et a guidé la dimension esthétique. Chaque illustration devient ainsi une œuvre d’art unique à travers un NFT.